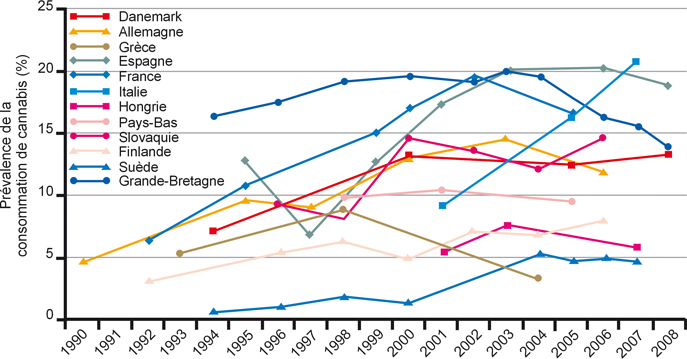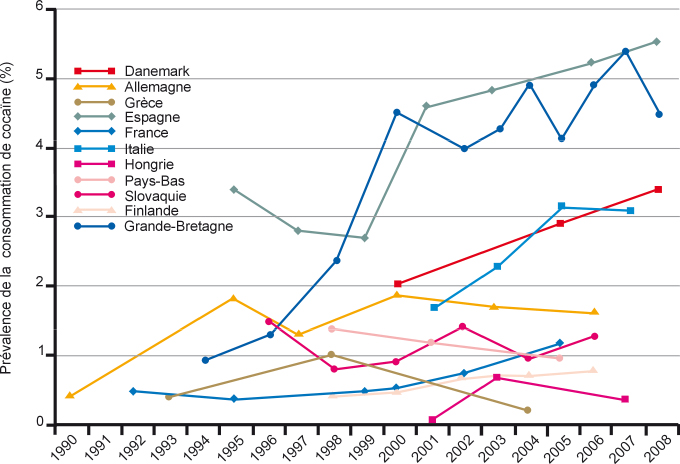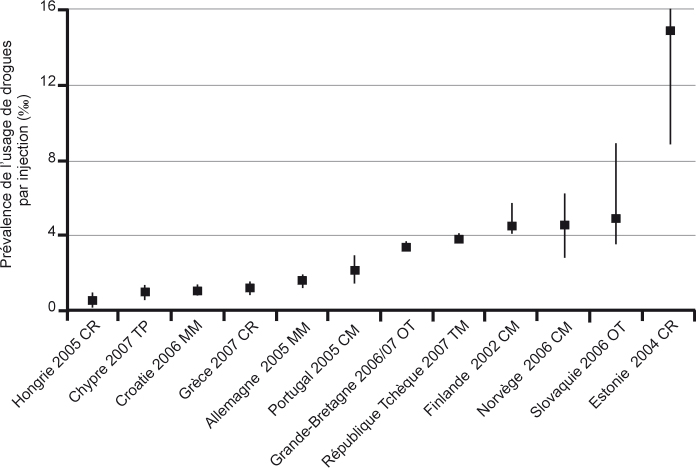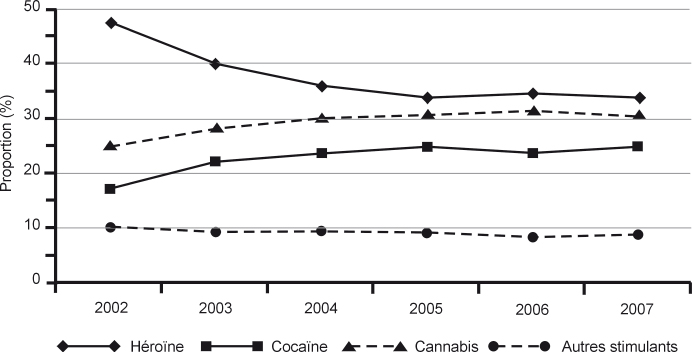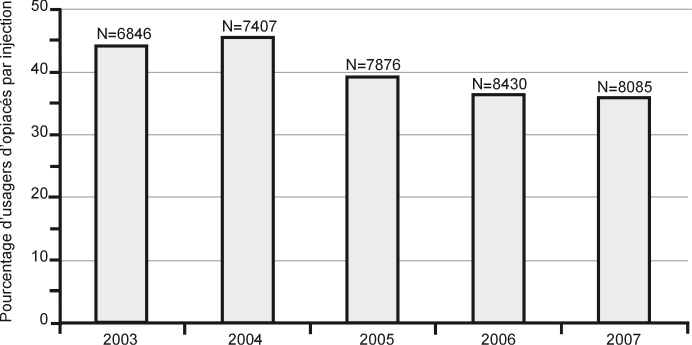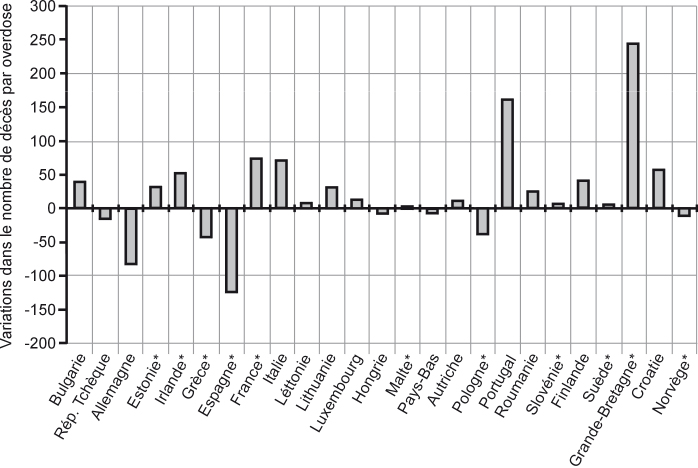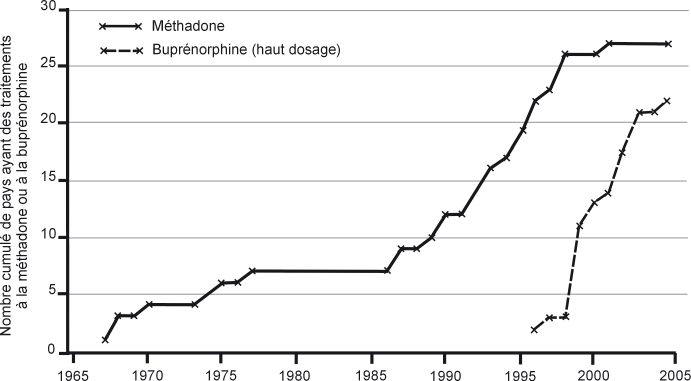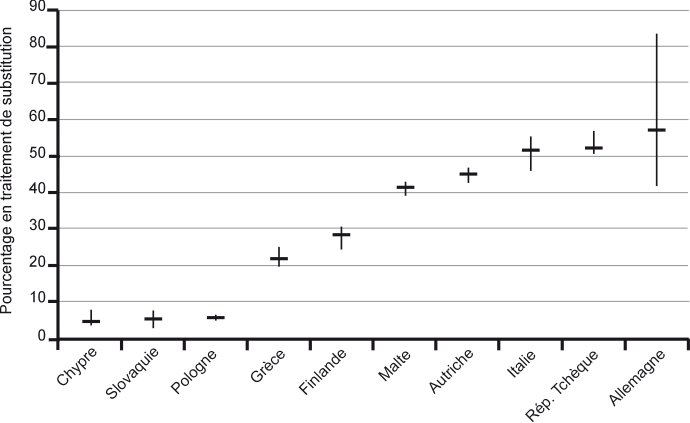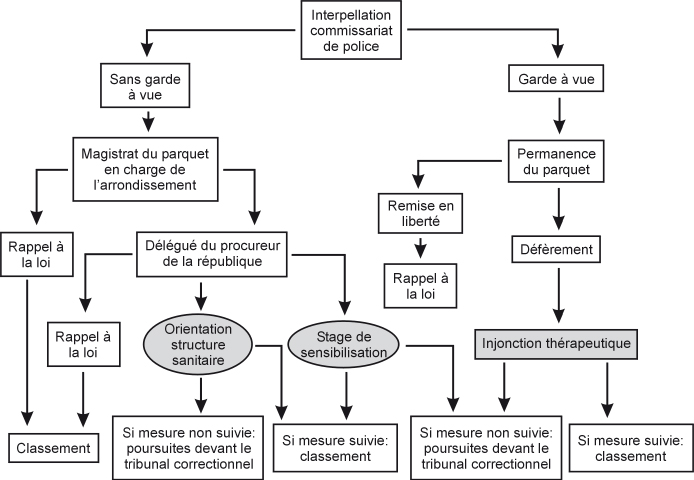2009
→ Aller vers ANALYSE→ Aller vers SYNTHESE
Usage de drogue et réduction des risques en Europe
L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) collecte et analyse des données provenant des 27 États membres de l’Union Européenne (UE), ainsi que de deux pays candidats (Croatie et Turquie) et de la Norvège. Des points focaux nationaux – comme l’OFDT en France – transmettent chaque année à l’OEDT des données standardisées ainsi que des informations plus qualitatives portant sur cinq indicateurs clefs épidémiologiques
1
, sur les interventions et politiques mises en place par les États européens pour répondre aux problèmes liés à la drogue, ainsi que sur le marché des substances illégales. L’ensemble de ces informations est synthétisé et publié dans le rapport annuel sur l’état du phénomène de la drogue en Europe (EMCDDA, 2009a

), ainsi que dans différentes autres publications accessibles sur le site Internet de l’OEDT
2
.
Les données présentées dans cette communication tracent un bref aperçu de la situation européenne dans quatre domaines :
• l’usage de drogue ;
• l’usage problématique de drogue tel que défini par l’OEDT
3
L’usage de drogue par injection ou l’usage de longue durée ou régulier d’opiacés, de cocaïne et/ou d’amphétamines.
;
• la mortalité et la morbidité liées à la drogue ;
• la réduction des risques.
Des sources de données différentes sont mises à contribution pour chacun de ces thèmes. Ainsi, la description de l’usage de drogue s’appuie sur les grandes enquêtes en population générale ou scolaire, ainsi que sur certaines données relatives au marché des drogues. L’usage problématique de drogue est décrit à l’aide des estimations indirectes de la prévalence de ce type d’usage ainsi que de données provenant des centres de traitement. La mortalité et la morbidité peuvent s’analyser à l’aide de registres de décès et de maladies, d’enquêtes de prévalence ou encore au travers d’études longitudinales, même si celles-ci restent rares en Europe. Finalement, les données concernant la réduction des risques s’appuient sur des collectes de données quantitatives et qualitatives sur le type et la quantité de mesures mises en place dans les pays européens. Le Bulletin Statistique de l’OEDT permet un accès direct à la majorité des données présentées dans ce chapitre ainsi qu’aux explications techniques et méthodologiques qui les concernent
4
.
Usage de drogue
Le cannabis est très largement la drogue illicite la plus consommée en Europe. L’OEDT estime qu’environ 74 millions d’Européens (22,1 %) en ont déjà consommé et que 22,5 millions (6,8 %) l’ont fait durant la dernière année. L’essentiel de ces consommateurs récents (17 millions) sont des jeunes gens âgés entre 15 et 34 ans, dont environ un sur huit (12,5 %) déclare avoir consommé du cannabis durant l’année.
Les données existantes montrent une rapide hausse de la consommation de cannabis chez les écoliers et jeunes adultes durant les années 1990 dans la majorité des pays européens. Cette hausse a ensuite cédé la place à une situation de stabilisation, suivie d’une progressive baisse notamment dans certains des pays affichant les taux de prévalence les plus élevés (figure 1

).
L’usage de cocaïne a lui aussi connu une hausse et il s’agit désormais de la seconde drogue illicite la plus consommée en Europe après le cannabis. La tendance à la hausse s’est produite un peu plus tard que pour le cannabis, vers le début des années 2000 (figure 2

), et elle a jusqu’ici été principalement limitée à l’Europe occidentale.
L’OEDT estime qu’aujourd’hui 13 millions d’Européens (3,9 %) ont déjà pris de la cocaïne et que 4 millions (1,2 %) l’ont fait durant la dernière année. L’essentiel de ces consommateurs (3 millions) se trouve ici aussi chez les jeunes gens âgés entre 15 et 34 ans où la prévalence annuelle atteint 2,2 %.
Environ 1,5 million de jeunes européens âgés entre 15 et 34 ans (1,1 %) ont consommé des amphétamines durant la dernière année et environ 2 millions d’entre eux (1,6 %) ont consommé de l’ecstasy. Ces chiffres sont stables ou en légère baisse depuis quelques années mais il est possible que cette situation reflète le remplacement de ces substances par d’autres (cocaïne, 1-benzylpipérazine ou BZP) et ne constitue donc pas en soi une baisse de la consommation de stimulants.
Le marché des drogues a aussi connu des transformations ces dernières années, notamment au travers du développement de commerces sur Internet proposant des substances présentées comme alternatives légales à certaines drogues existantes. Une simple recherche par mots-clefs a ainsi permis d’identifier en Europe 115 de ces commerces en ligne proposant plusieurs centaines de produits différents. Parmi ceux-ci figurent aussi des mélanges d’herbes comme
Spice, un produit qui a été identifié dans 21 pays européens et dont certains échantillons contenaient des cannabinoïdes de synthèse (EMCDDA, 2009b

). Ce développement reflète la volonté et la capacité technologique des producteurs et vendeurs de développer des produits qui ciblent les habitudes des consommateurs tout en tentant d’échapper aux mesures de contrôle. Il n’existe pas encore de données fiables sur la consommation ou la vente de ce type de produits, mais leur prix compétitif, la qualité du marketing (emballages, sites Internet) et le nombre de revendeurs pourraient indiquer que le marché n’est pas négligeable.
Usage problématique de drogue
L’usage problématique de drogues se définit comme l’usage de drogues par injection et/ou l’usage régulier sur une longue période d’opiacés, de cocaïne et/ou d’amphétamines. Une majorité de pays européens ont produit récemment, à partir de différentes méthodes (capture-recapture, multiplicateurs...), des estimations du nombre d’usagers d’opiacés à problèmes. Sur la base de ces données, il est possible d’estimer que la prévalence au niveau européen se situe entre 3,6 et 4,6 cas pour 1 000 habitants âgés entre 15 et 64 ans, soit entre 1,2 et 1,5 million d’usagers d’opiacés à problèmes au total. Certains groupes, principalement les usagers de drogue incarcérés, sont toutefois sous-estimés dans ce nombre.
Les estimations indirectes de la prévalence de la consommation de drogues par voie intraveineuse sont malheureusement moins nombreuses. Sur la base des études récentes disponibles (figure 3

), on peut estimer que la prévalence au niveau européen se situe entre 2,2 et 3 cas pour 1 000 habitants âgés entre 15 et 64 ans, soit environ entre 750 000 et un million d’usagers de drogue par injection, toutes drogues confondues (EMCDDA, 2010a

). Ici aussi, les usagers incarcérés sont sous-représentés.
Les estimations de prévalence, en raison de leur faible fréquence et des différences de méthodes, ne permettent qu’une analyse rudimentaire des tendances de l’usage d’opiacés et de l’injection de drogue. C’est pourquoi l’OEDT a aussi recours à d’autres indicateurs qui permettent d’aborder cette question de manière indirecte.
Les données relatives à l’usage d’opiacés montrent depuis 2003-2004, une inversion de tendance avec désormais une stabilisation ou une hausse de la plupart des indicateurs. Ceux-ci incluent le nombre et la proportion d’usagers d’héroïne parmi les personnes entrant en traitement pour la première fois (figure 4

), le nombre de décès par overdose (dont la grande majorité sont liés à l’usage d’opiacés), le nombre de saisies d’héroïne, ainsi que les interpellations liées à cette substance. Cette convergence de différents indicateurs a conduit l’OEDT à inviter les États européens à la vigilance et à ne pas réduire leurs efforts pour lutter contre les problèmes liés aux opiacés. Ces derniers constituent toujours la majeure partie des problèmes de drogue en Europe.
La situation concernant l’usage de drogue par injection est quelque peu différente. Ici, les données provenant des centres de traitement spécialisés indiquent une baisse ou une stabilisation de la proportion des usagers de drogue par injection parmi les usagers d’opiacés, de cocaïne et d’amphétamines qui entrent pour la première fois en traitement (figure 5

). Toutefois, la hausse de l’usage d’opiacés mentionnée ci-dessus implique aussi que, dans certains pays, le nombre absolu d’usagers d’opiacés par injection entrant en traitement pour la première fois est en réalité stable ou en hausse.
Des estimations de l’usage problématique de cocaïne, d’amphétamines et de méthamphétamines n’ont été faites que dans de rares pays et elles ne permettent pas de faire des extrapolations au niveau européen. Toutefois, l’usage de ces stimulants constitue un élément central de l’usage problématique de drogue dans certains pays. C’est par exemple le cas pour la consommation d’amphétamines en Suède et en Finlande, pour la consommation de méthamphétamines en République Tchèque et en République Slovaque, ou encore pour l’usage de cocaïne en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni. L’usage de crack a quant à lui été principalement rapporté au Royaume-Uni, mais aussi dans différentes villes européennes incluant Francfort, Paris et Dublin.
Le cannabis ne fait pas partie de la définition utilisée par l’OEDT pour aborder l’usage problématique de drogue mais il est possible de présenter une estimation de l’usage fréquent ou intensif de cette substance. Sur la base de différentes estimations nationales, il y a environ 4 millions d’usagers de cannabis en Europe qui consomment tous les jours ou presque, dont 3 millions sont des jeunes gens âgés entre 15 et 34 ans. Cela représente entre 2 et 2,5 % des individus de cette tranche d’âge.
Mortalité et morbidité
Cette section porte spécifiquement sur la mortalité et les maladies infectieuses chez les consommateurs de drogue. D’autres types de morbidité (accidents, blessures, autres problèmes de santé mentale...) ne sont pas abordés ou le sont seulement indirectement, notamment en raison de l’insuffisance des données standardisées qui les concernent.
Environ 7 000 à 8 000 décès par overdose sont rapportés chaque année à l’OEDT et des traces d’opiacés sont relevées dans 80 % des cas. Ces décès par overdose représentent environ 4 % de l’ensemble des décès chez les 15-39 ans en Europe. La grande majorité des personnes décédées sont des hommes et leur moyenne d’âge a augmenté au fil des ans.
En termes de tendances, le nombre d’overdoses, après avoir diminué au début des années 2000, affiche depuis 2003 une tendance à la hausse (figure 6

), qui pourrait être expliquée par différents facteurs incluant le vieillissement d’une population de consommateurs de longue date et une hausse de la polyconsommation. Différentes études ont aussi montré que les usagers de drogue sortant de prison et ceux interrompant un traitement ont un risque particulièrement élevé de décès (Davoli et coll., 2007

; Farrell et coll., 2008

).
Des études longitudinales de cohorte en Europe ont également montré que les décès par overdose pouvaient représenter entre un cinquième et la moitié de la mortalité totale chez les consommateurs de drogue. Dans les pays avec un taux de prévalence élevé du VIH/sida chez les usagers de drogue, la proportion de la mortalité représentée par les overdoses est souvent la plus faible
5
On estime que 2 100 décès liés au VIH/sida imputables à l’usage de drogue par injection ont eu lieu en 2006 en Europe.
. S’agissant des autres causes de décès, la littérature indique que les accidents, violences et suicides sont aussi susceptibles d’être responsables d’une fraction importante de la mortalité. Les suicides représentaient ainsi 6 % à 11 % des décès dans certaines études de cohorte récentes.
La mortalité totale chez les usagers de drogue à problèmes est généralement de l’ordre de 1 % à 2 %, avec des fluctuations selon la population étudiée. Une étude internationale dans sept zones urbaines en Europe a montré que 10 % à 23 % de la mortalité chez les 15-49 ans étaient imputables à la consommation d’opiacés (Bargagli et coll., 2005

).
Environ 3 000 nouveaux cas d’infections par le VIH imputables à l’usage de drogue par injection sont rapportés chaque année (Wiessing et coll., 2009

) et on estime qu’il y a environ cent à deux cent mille (ex-)consommateurs de drogue qui sont porteurs du virus dans l’Union Européenne. Depuis quelques années, le nombre de nouvelles infections est en baisse, notamment dans les pays rapportant les nombres et taux de contamination par le VIH les plus élevés (figure 7

), et les enquêtes de prévalence chez les usagers de drogues par injection montrent également une situation stable ou en baisse. À l’inverse, la situation dans certains pays frontaliers de l’Union Européenne, comme la Fédération de Russie (11 161 nouveaux cas d’infection rapportées chez des consommateurs de drogue par injection en 2006) et l’Ukraine (7 087 cas en 2007), reste très préoccupante.
Les enquêtes de prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) chez des usagers de drogue par injection rapportent des taux variant entre 18 % et 95 % selon les pays ; les taux sont supérieurs à 40 % pour la moitié de ces pays (figure 8

). Comme les données provenant des registres des maladies infectieuses sont de qualité inférieure à celles concernant le VIH, il est difficile d’estimer quelle est la tendance dans ce domaine. Ces données suggèrent toutefois que les usagers de drogue par injection sont, parmi ceux dont les facteurs de risque sont connus, le groupe avec l’incidence la plus élevée du VHC (Wiessing et coll., 2008

).
Réduction des risques en Europe
La réduction des risques a fait l’objet d’une recommandation du Conseil de l’Union Européenne
6
Recommandation 2003/488/CE du Conseil, du 18 juin 2003, relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie.
invitant les États Membres à se doter d’objectifs et de mesures dans ce domaine. L’actuel plan d’action « drogue » de l’Union Européenne (2009-2012) comporte également un objectif spécifique
7
Garantir l’accès aux services de réduction des dommages, afin d’endiguer la propagation du VIH/ sida, de l’hépatite C et d’autres maladies infectieuses transmissibles par le sang liées à la consommation de drogue, et réduire le nombre de décès.
et plusieurs actions visant à renforcer la réduction des risques en Europe. Au niveau national, la réduction des risques est aujourd’hui devenue une partie constitutive de la plupart des politiques de lutte contre la drogue, sous la forme d’un pilier spécifique ou d’un ensemble de mesures (Hedrich et coll., 2008

).
Les principales mesures de réduction des risques en Europe sont l’échange de seringues, ainsi que les traitements de substitution aux opiacés. D’autres mesures visant les usagers de drogue à problèmes ou les usagers de drogue en milieu festif ont aussi été mises en place mais avec des taux de couverture plus variables. La monographie sur la réduction des risques publiée par l’OEDT au début de l’année 2010 revient en détail sur l’ensemble de ces interventions (EMCDDA, 2010b

).
Des programmes d’échange de seringues existent dans tous les États de l’Union Européenne, en Croatie et en Norvège, et le nombre de seringues distribuées par ces programmes continue de croître dans la majorité des pays. Le nombre total de points d’échange et de seringues distribuées varie cependant fortement d’un pays à l’autre. Des comparaisons entre le nombre de seringues distribuées par des programmes spécialisés et le nombre estimé d’usagers de drogue par injection dans le pays indiquent que cela peut varier de moins de 50 seringues par individu à plus de 300 (Norvège). Dans quelques pays européens, les programmes d’échange de seringues ont été complétés par la mise en place de locaux de consommation supervisés (Allemagne, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège)
8
La Suisse, qui n’est pas membre de l’OEDT et ne fait donc pas partie des pays étudiés ici, a été la première à introduire ce type d’intervention au milieu des années 1980.
.
Les traitements de substitution aux opiacés constituent une mesure qui peut avoir, simultanément ou successivement, un objectif de réduction des risques et un objectif thérapeutique. Comme pour l’échange de seringues, cette mesure est désormais disponible dans tous les États de l’Union Européenne, en Croatie et en Norvège, et elle a connu une rapide expansion depuis le milieu des années 1980 (figure 9

). On estime qu’environ 670 000 consommateurs d’opiacés ont été en traitement de substitution en 2008, un nombre environ sept fois supérieur à celui estimé en 1993. La plupart des pays continuent d’ailleurs de reporter des hausses du nombre de ces traitements. Les substances prescrites sont avant tout la méthadone (environ 70 % des traitements) et la buprénorphine à haut dosage
9
Environ deux tiers des traitements utilisant la buprénorphine sont effectués en France.
(20 %), mais aussi la morphine à libération lente, la codéine et l’héroïne. Cette dernière est prescrite dans des cliniques spécialisées en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni
10
Trois autres pays de l’Union Européenne (Danemark, Luxembourg, Belgique) ont fait état de travaux préparatoires pour la mise en œuvre de cette forme de traitement. Comme pour les locaux d’injection, la Suisse a été la première à mettre en œuvre la prescription d’héroïne telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui alors que le Royaume-Uni le faisait déjà auparavant mais sous une autre forme.
.
La grande majorité des traitements de substitution sont prescrits dans les pays du Sud et de l’Ouest de l’Europe et ce type de traitement reste encore limité dans la plupart des pays d’Europe orientale. En termes de couverture, on peut estimer que plus de 40 % des usagers d’opiacés à problèmes en Europe ont recours à ce type de traitement, mais avec d’importantes différences nationales puisque, pour les pays disposant de données, cette proportion varie de 5 % à plus de 50 % (figure 10

). De manière générale, la prescription de ces traitements par les médecins généralistes semble souvent associée à un plus haut taux de couverture.
Les mesures de réduction des risques restent très limitées en milieu carcéral. Seuls 13 pays rapportent que des traitements de substitution sont mis en œuvre dans la plupart de leurs prisons, alors que la distribution de seringues existe, le plus souvent à très petite échelle, dans cinq États Membres de l’Union Européenne (Allemagne, Espagne, Roumanie, Portugal, Luxembourg). Des études ont pourtant montré que la consommation de drogue et même l’usage de drogue par injection existaient en milieu carcéral, parfois avec des prévalences élevées. C’est pourquoi le dernier plan d’action drogue européen (2009-2012) prévoit de « Concevoir et mettre en place des services préventifs, thérapeutiques, de réduction des dommages et de réadaptation à l’intention des détenus, qui soient équivalents aux services offerts en dehors des prisons. »
En conclusion, cette rapide vue d’ensemble de la consommation et des problèmes liés à la drogue en Europe, ainsi que de la mise en œuvre de la réduction des risques dans cette région, est loin d’être exhaustive mais elle permet de spécifier certains éléments importants qui permettent de comprendre la situation actuelle. La consommation de drogue en Europe est aujourd’hui dans une phase de stabilisation avec toutefois des niveaux de prévalence qui sont historiquement élevés. Ceci est la résultante de hausses successives de la consommation de substances comme le cannabis ou la cocaïne, mais aussi de développements antérieurs comme la diffusion de l’héroïne ou de l’ecstasy.
L’usage problématique de drogue, tel que défini par l’OEDT, n’échappe pas à ce constat d’une prévalence relativement élevée mais plutôt stable. Une analyse plus fine suggère toutefois que de multiples phénomènes s’entrecroisent : baisse relative de l’usage de drogue par injection, stabilisation ou légère hausse de l’usage des opiacés, diffusion de la polyconsommation (EMCDDA, 2009c

), vieillissement et fragilisation de certaines catégories d’usagers. Ces différentes tendances pourraient en fait, malgré une situation en apparence stable, être synonymes d’une hausse globale des risques associés à la consommation de drogue en Europe. Les tendances préoccupantes observées pour le nombre de décès par overdose pourraient en être un reflet.
La réduction des risques est désormais largement mise en œuvre en Europe et son implantation peut être directement rattachée, durant les années 1980 et 1990, au développement de l’épidémie du VIH/sida au sein d’une population croissante d’usagers de drogue par injection. Aujourd’hui, les principales mesures de réduction des risques – échange de seringues et traitement de substitution aux opiacés – ont fait la preuve de leur faisabilité mais aussi de leur efficacité. La substitution a généralement obtenu de meilleurs résultats que les autres types de traitement chez les usagers d’opiacés
11
alors que l’échange de seringues a permis de réduire certains comportements à risque. Ceci a sans doute contribué, au côté d’autres facteurs, à la progressive baisse du nombre de nouveaux cas d’infections par le VIH liés à l’usage de drogue par injection en Europe.
La mise en œuvre de la réduction des risques se fait toutefois à des degrés très divers en Europe. Dans certains pays, elle est devenue une composante très importante de la lutte contre les problèmes liés à la drogue. Dans ce cas, le catalogue des mesures est souvent plus vaste, par exemple en incluant des mesures comme les locaux d’injection supervisés ou la prescription d’héroïne. Dans d’autres pays, la réduction des risques est vue comme un élément transitoire qui se justifie parce que certains problèmes, notamment la transmission des maladies infectieuses, peuvent être difficilement abordés avec la prévention et les traitements requérant l’abstinence. Dans ce cas, la réduction des risques est souvent limitée en taille et en diversité. En pratique, la plupart des pays européens se situent aujourd’hui entre ces deux pôles : la réduction des risques y est devenue un élément constitutif des politiques de lutte contre la drogue où elle côtoie désormais la prévention, les traitements et la réduction de l’offre
12
L’auteur souhaite remercier les points focaux nationaux du réseau Reitox, qui fournissent des données à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ainsi que ses collègues à l’OEDT qui développent les instruments de collecte de données et analysent la situation Européenne.
.
Bibliographie
[1] bargagli am,
hickman m,
davoli m. Drug related mortality and its impact on adult mortality in eight European countries.
European Journal of Public Health. 2005;
16:198
-202

[2] davoli m,
bargagli am,
perucci ca. Risk of fatal overdose during and after specialised drug treatment: the VEdeTTE study, a national multi-site prospective cohort study.
Addiction. 2007;
102:1954
-1959

[3]emcdda. Rapport annuel 2009: L’Etat du phénomène de la drogue en Europe.
Luxembourg:Office des publications de l’Union Européenne;
2009a;

[4]emcdda. Understanding the ‘Spice’ phenomenon.
Luxembourg:Office for Publications of the European Communities;
2009b;

[5]emcdda. Polydrug use : Patterns and responses.
Luxembourg:Office for Publications of the European Communities;
2009c;

[6]emcdda. Trends in injecting drug use in Europe.
Luxembourg:Office for Publications of the European Communities;
2010a;

[7]emcdda. Harm reduction: evidence, impacts and challenges.
In: rhodes t, hedrich d (eds), editors.
Monograph 10, Luxembourg:Publications Office of the European Union;
2010b;

[8] hedrich d,
pirona a,
wiessing l. From margin to mainstream: the evolution of harm reduction responses to problem drug use in Europe.
Drugs: Education, Prevention and Policy. 2008;
15:503
-517

[9] farrell m,
marsden j. Acute risk of drug-related death among newly released prisoners in England and Wales.
Addiction. 2008;
103:251
-255

[10] wiessing l,
likatavicius g,
klempova d,
hedrich d,
nardone a,
griffiths p. Associations Between Availability and Coverage of HIV-Prevention Measures and Subsequent Incidence of Diagnosed HIV Infection Among Injection Drug Users.
American Journal of Public Health. 2009;
99:1049
-1052

[11] wiessing l,
guarita b,
giraudon i,
brummer-korvenkontio h,
salminen m,
cowan sa. European monitoring of notifications of hepatitis C virus infection in the general population and among injecting drug users (IDUs) – the need to improve quality and comparability.
Euro Surveill. 2008;
13:18884

(Available online:
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18884)
Frank Zobel
Rédacteur scientifique et analyste des politiques drogue
Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT), Lisbonne
Eléments d’histoire sur la politique de réduction des risques en France
Au Canada et en Suisse, on parle de réduction des méfaits, en France de réduction des risques. La France s’est centrée sur une réduction des risques infectieux et a promu une vision médicalisée de la réduction des risques. La réduction des méfaits englobe l’approche des risques sanitaires tels que les infections virales mais aussi les conséquences sociales de l’usage de drogues.
Il apparaît donc plus juste de parler de réduction des méfaits ou dommages que de réduction des risques. Le risque pris n’entraîne pas inéluctablement un dommage effectif. Les risques ne sont pas seulement sanitaires, ils sont aussi sociaux (violence, accidents, ruptures familiales ou sociales, perte d’emploi...).
Le concept de réduction des dommages suppose qu’il est acquis que le comportement qui entraîne les dommages ne peut être radicalement supprimé. Dès lors qu’un consensus existe sur ce point, mettre en place une politique publique qui a pour objectif de réduire autant que possible ces dommages relève du simple bon sens. Si cette question a fait débat en France mais aussi dans de nombreux autres pays, c’est qu’aucun consensus n’existait sur le caractère irréaliste d’une éradication totale de la consommation de drogues.
La prohibition reste en effet, et sans doute pour longtemps, le cadre législatif international sans d’ailleurs que les critères d’interdiction soient précisément définis : « est stupéfiant, tout produit classé stupéfiant » disent les conventions que la France a ratifié comme la plupart des pays du monde. En 1998, l’assemblée générale de l’Onu a adopté une résolution visant à réduire de façon substantielle, voire à « éliminer » avant 2008, la production, le trafic et l’abus des drogues. Malgré l’échec évident de cette politique éradicatrice, le discours a peu changé.
Dans un tel contexte, la politique de réduction des dommages a été vécue comme une manière de baisser les bras alors qu’elle n’est nullement contradictoire avec une politique déterminée visant à réduire le nombre des consommateurs et l’intensité de leur consommation.
Le risque ou le dommage n’est pas seulement pour le consommateur lui-même mais aussi pour autrui : risque de contamination mais aussi risque lié à certains comportements associés à la prise de produits (accidents de la route, violences ou agressions). Ainsi, l’interdiction de la consommation d’alcool au volant est une politique de réduction des risques. De même, le développement des programmes de substitution a entraîné entre autres effets bénéfiques une baisse très significative de la délinquance associée.
Le dommage peut être indirect : on peut calculer le coût pour la solidarité nationale de la consommation de drogues (personnel mobilisé, prestations versées...)
1
Voir les travaux de Pierre Kopp sur le coût social des drogues licites et illicites.
.Toute diminution de ce coût peut être considéré comme un bien pour la collectivité publique.
Système Français : un terrain peu propice à la réduction des risques
La France est caractérisée par une faible culture de santé publique et une approche plus individuelle que collective et plus curative que préventive. Pour notre système de santé, qu’il s’agisse des structures ou des acteurs, il était donc difficile d’imaginer des réponses préventives et collectives et non immédiatement curatives.
S’ajoute à cette première difficulté, une approche très moralisante de la politique de lutte contre les addictions qu’on pourrait résumer ainsi : chacun est responsable de sa consommation et de ses abus. Il est donc normal qu’il en subisse les conséquences.
Le terrain était donc peu propice à la mise en place rapide d’une politique de réduction des risques. Cette observation est d’ailleurs corroborée par les comparaisons internationales.
Deux catégories de pays se dégagent :
• les pays ayant une tradition de santé publique (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, pays nordiques). Dès l’apparition du sida, les mesures de réduction des risques se sont rapidement imposées aux professionnels de manière évidente et pragmatique et ont été mises en œuvre à partir de 1985 ;
• les autres pays (notamment France et États-Unis) qui n’ont pas de tradition de santé publique et une approche moralisante des questions d’addiction. Dans ces pays, ce sont les associations et les militants qui ont imposé la mise en œuvre des mesures de réduction des risques.
Bref rappel historique
L’histoire des politiques de lutte contre les drogues en France explique en grande partie cette situation.
Lorsque, au début des années 1970, le problème de la consommation des drogues a commencé à émerger comme un problème majeur de société, les pouvoirs publics n’avaient aucun savoir-faire. Ils ont donc fait confiance à quelques psychiatres, conduits par Claude Olievenstein, qui commençaient à s’intéresser aux usagers d’héroïne et ont été à l’origine de la création des premiers centres : Marmottan et l’Abbaye à Paris.
C’est ainsi que les pouvoirs publics se sont laissés convaincre que la toxicomanie était une pathologie spécifique qui nécessitait un dispositif de soins spécifique, totalement distinct de celui qui existait déjà pour les alcoolodépendants. C’est sur cette base que s’est construit un système de prise en charge entièrement financé par l’État et garantissant des soins anonymes et gratuits à tous ceux qui en faisaient la demande. L’action des centres de soins créés à partir des années 1970 reposait sur une approche essentiellement psychologique et psychanalytique fondée sur la recherche très exigeante de l’abstinence. Cette période a été marquée par le rejet absolu de toute autre forme de prise en charge (étaient exclus notamment les communautés thérapeutiques ou l’approche cognitivo-comportementale).
La culture professionnelle des intervenants en toxicomanie était forte et homogène. Dans la mouvance de l’anti-psychiatrie, elle cultivait également une certaine marginalité tant à l’égard de la psychiatrie traditionnelle que des intervenants sociaux.
Cette situation est assez singulière, si on la compare à celle d’autres pays européens : cloisons étanches entre les structures et intervenants en toxicomanie et tous les autres intervenants sociaux ou médicaux ; choix et défense d’un seul modèle de prise en charge pour les usagers de drogues illicites.
Histoire d’un aveuglement
Au début des années 1980, le système est conforté aussi bien par les pouvoirs publics qui font confiance aux experts que par les médias. Personne ne voit que de nombreux usagers échappent au système de soins, soit parce qu’ils sont trop pauvres, soit parce qu’ils vont trop mal pour formuler une demande, soit parce qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas devenir abstinents.
On ne voit donc rien venir. Pourtant, plusieurs éléments auraient du alerter. D’abord l’évolution du profil des usagers : ce n’était plus les rebelles des années 1970 mais de plus en plus, des exclus du système social en situation de grande précarité. Ensuite, on a vu arriver dans les hôpitaux et les prisons des usagers de drogues qui n’avaient jamais rencontré le système de soins
2
Étude Ingold dans les prisons, 2006.
.
Le modèle a explosé à la fin des années 1990 avec la catastrophe sanitaire qu’a représentée l’épidémie de sida. C’est à cette époque que sont arrivés dans les hôpitaux de nombreux héroïnomanes déjà malades et qui n’avaient jamais été pris en charge. Une partie des professionnels a alors pris conscience qu’il était urgent d’offrir aux usagers qui ne pouvaient ou ne voulaient pas devenir abstinents des programmes de prévention et de prise en charge à bas seuil d’exigence (des lieux d’accueil apportant aux usagers en grande difficulté une aide à la vie quotidienne, un accès au matériel stérile d’injection et une possibilité d’orientation sanitaire et sociale). Le milieu des intervenants en toxicomanie, jusque là assez homogène, s’est profondément et douloureusement clivé autour de ces orientations. Celles-ci se sont heurtées par ailleurs à de lourdes résistances dans tous les milieux : résistance des décideurs politiques qui craignaient qu’elles soient interprétées comme un encouragement à la consommation ; résistance de la police et de la justice qui estimaient que ces mesures étaient en contradiction avec la loi ; résistance enfin de certains intervenants en toxicomanie qui étaient convaincus que les usagers de drogues ne se serviraient pas des mesures proposées.
C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics ont pris les premières mesures de réduction des risques. Un décret de 1987 a autorisé la vente libre des seringues en pharmacie, abrogeant ainsi un décret qui limitait l’accès aux seringues et qui avait été adopté en 1972 sous l’impulsion de Claude Olievenstein. Des programmes d’échange de seringues et des structures d’accueil à bas seuil d’exigence ont été développés, de manière expérimentale et relativement inégale sur le territoire.
La suite est connue. Elle a largement donné tort aux sceptiques. D’une part, les usagers se sont immédiatement emparés de ces mesures de prévention. D’autre part, celles-ci n’ont entraîné aucune augmentation de la consommation.
Développement chaotique des traitements de substitution
Dans le même temps, et au nom des mêmes croyances, les traitements de substitution ont rencontré l’opposition d’une partie des intervenants en toxicomanie et d’une partie du corps médical. Ces derniers estimaient en effet qu’on ne pouvait sérieusement soigner en substituant un produit à un autre et sans demande explicite d’abstinence de la part du patient.
Pourtant dès 1987, plusieurs études étrangères démontraient sans ambiguïté l’intérêt et l’efficacité des programmes de substitution. Le premier projet en France, celui de la clinique Liberté porté par Didier Thouzeau débute en 1989 mais il faut attendre 1992 pour que la Direction générale de la santé sollicite les structures de soins (CSST) afin qu’elles mettent en place des « programmes méthadone ». Le développement de ces programmes, fondé sur le volontariat est inégal et limité, malgré la décision de la Direction générale de la santé d’assouplir les contraintes, à partir de 1994. À titre d’exemple, en Seine-Saint-Denis, département marqué par une surreprésentation d’usagers d’héroïne en grande précarité, il n’y avait toujours en 1996 aucun « programme méthadone ».
La lenteur du développement des « programmes méthadone » a conduit, dans le même temps, un certain nombre de médecins généralistes militants à prescrire de la buprénorphine faiblement dosée (Temgesic) en dehors des indications usuelles de prescription. Un laboratoire pharmaceutique s’est rapidement saisi de cette opportunité et a développé un produit de substitution à base de buprénorphine fortement dosé, le Subutex. C’est grâce à ce produit, mais surtout grâce au militantisme des médecins pionniers que les traitements de substitution ont concerné rapidement la très grande majorité des héroïnomanes.
Aujourd’hui, le bénéfice du développement des traitements de substitution, qui a changé durablement la vie des usagers d’héroïne, n’est plus contesté.
Réduction des risques : des mesures d’aménagement à la marge plus qu’une politique publique
Les résultats des mesures de réduction des risques ont été spectaculaires : baisse des overdoses, amélioration de l’état de santé des usagers, baisse de la délinquance associée, diminution de la contamination par le VIH...
Cependant, si quelques responsables politiques ont porté ces mesures, ils étaient à l’exception des Verts, assez marginaux dans leur formation. Dans l’ensemble, elles sont restées mal comprises des non spécialistes et n’ont pas fait l’objet du large consensus qu’on aurait pu attendre au regard des résultats.
Les réticences et oppositions qui ont entravé le début du développement des mesures de réduction des risques ont marqué durablement l’organisation du système. Ces mesures sont restées des mesures d’aménagement isolées, à la marge, liées dans l’imaginaire collectif à un certain militantisme. Elles ne se sont pas intégrées dans le système de santé publique, de prévention et de soins de droit commun, qui n’en a donc pas été durablement modifié.
Quelques exemples
En 1986, une circulaire du ministère de la Santé recommande de ne pas prendre en charge les soins liés au VIH sur les crédits toxicomanie. Elle précise que le « traitement du sida et la prise en charge des toxicomanes sont deux objectifs de santé publique distincts ».
Dans le même temps, la plupart des intervenants en toxicomanie refusent d’intégrer les programmes de réduction des risques dans les CSST (Centres de soins aux toxicomanes), préférant les laisser à la marge du dispositif de soins, sans que les pouvoirs publics ne songent à imposer quoi que ce soit.
Les lieux d’accueil à bas seuil reposent pendant longtemps sur le militantisme de quelques uns sans bénéficier de la programmation et des moyens habituellement consacrés à des programmes de santé publique.
Les médecins qui ne veulent pas prescrire de traitement de substitution revendiquent l’application d’une « clause de conscience » sans que personne ne songe à le contester.
Les expériences de coopération avec la police pour éviter les interpellations à proximité des dispositifs de réduction des risques sont restées expérimentales et discrètes alors justement qu’elles auraient dû faire l’objet d’un engagement fort des pouvoirs publics.
Plan triennal de lutte contres les drogues et la toxicomanie de 1999 : une reconnaissance institutionnelle de la politique de réduction des risques
Le plan triennal de 1999 que j’ai préparé lorsque j’étais présidente de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies (Mildt) a tenté d’intégrer la politique de réduction des risques dans une politique interministérielle plus globale. Il était fondé sur les principes suivants :
• les programmes de réduction des risques se sont mis en place « à bas bruit » sans faire l’objet d’un soutien politique affirmé. Il est donc essentiel de les intégrer clairement dans la politique publique de prévention et de soins aux usagers de drogues ;
• il faut élargir la notion de réduction des dommages au-delà du risque infectieux et envisager tous les dommages liés à la consommation de tous les produits (notamment l’alcool et les psychotropes), ce qui implique de s’intéresser aux violences liées à la consommation de produits ou à l’insécurité routière ;
• les usagers les plus marginalisés ne demandent rien et ne sont pas connus du système de soins. Il faut donc aller au devant de ces usagers en leur offrant des services à bas seuil d’exigence.
L’approche « réduction des risques » doit être intégrée dans tous les lieux fréquentés par les usagers de drogue : médecins généralistes, structures de soins, hôpitaux, prisons... C’est donc plus une « approche », une « méthode » qui doit irriguer tous les acteurs qu’un dispositif.
La politique pénale de lutte contre le trafic et la détention de stupéfiants doit être compatible avec les exigences de la réduction des risques. Une circulaire du ministère de la Justice de juin 1999 a demandé aux parquets d’éviter les interpellations à proximité des lieux d’accueil des usagers et de ne pas retenir le port d’une seringue comme une présomption d’usage.
Les usagers doivent être consultés sur les politiques qui les concernent et associés aux messages de prévention.
Cette approche n’a pas été réellement remise en cause par les deux plans suivants et la réduction des risques est aujourd’hui un acquis consacré par la loi. Les programmes en résultant restent cependant accessoires à la politique de soins et ne sont pas totalement intégrés à la politique globale de santé publique.
En conclusion, le développement rapide d’une politique de réduction des risques dépend en grande partie de l’environnement : existence ou non d’une politique de santé publique ; existence ou non d’un consensus sur les politiques de lutte contre les drogues ; existence ou non d’une politique de prévention.
La législation n’est pas le principal obstacle à la mise en œuvre d’une politique de réduction des risques. D’abord parce que, compte tenu des conventions internationales, la marge de manœuvre législative est limitée. Ensuite et surtout parce que les procureurs de la république ont la possibilité de faire une application de la loi qui privilégie l’approche de santé publique pour les usagers et réserve les poursuites pénales aux faits de trafic. Si ce n’est pas le cas aujourd’hui, c’est plus parce qu’il n’existe pas de consensus autour d’une telle politique que parce que la loi ne l’autorise pas. C’est aussi pour des raisons qui ont peu de liens avec la politique publique de lutte contre les drogues et notamment parce que la pression statistique qui pèse sur les services de police les conduit à multiplier les interpellations d’usagers.
Plus la culture de santé publique est développée, plus les mesures prises prennent du sens et sont donc efficaces. Les programmes de réduction des risques ne peuvent être conçus dans un ghetto.
C’est parce qu’elle avait des réflexes de santé publique que la Grande-Bretagne a développé dès 1985 des mesures de réduction des risques. Dès 1987, cette politique a d’ailleurs été portée politiquement puisque le Premier Ministre déclarait « le sida est plus dangereux que l’usage de drogues ». Une telle déclaration était impensable en France.
Plus la culture de prévention est développée, plus le consensus autour des mesures prises est fort. Or, en France la prévention primaire autour des questions d’éducation à la santé, de citoyenneté et d’usage des substances psychoactives reste embryonnaire. Les Pays-Bas ou les pays scandinaves qui développent une prévention systématique et continue dès la maternelle ont de bien meilleurs résultats que la France en terme de prévention de l’usage nocif et même de l’usage simple (les jeunes néerlandais consomment moins de cannabis que les jeunes français).
La transparence et la fiabilité des informations contribuent à la construction des consensus. Elle permet à chacun de se réapproprier rapidement les messages de réduction des risques. En France, la méfiance reste encore grande à l’égard des messages émis par les pouvoirs publics faute d’un effort de communication cohérent et continu qui se poursuit au-delà des alternances politiques.
On ne peut pas mener de politique de réduction des risques efficaces à l’égard des usagers sans les écouter, dialoguer avec eux et les associer aux mesures prises. En France, nous avons tardé à le comprendre alors que les néerlandais avaient encouragé une représentation des « junkies » dès 1985.
Il est nécessaire d’aller au devant des usagers les plus fragiles sans attendre qu’ils fassent une demande. Même si cette idée a progressé dans les dix dernières années, elle n’a pas encore transformé l’organisation de la prévention et des soins autant que nous aurions pu l’espérer. Et cette question ne concerne pas seulement les usagers de drogues mais d’une manière générale les populations les plus démunies qui ne bénéficient d’aucune mesure de prévention et ne sollicitent des soins qu’en urgence lorsqu’ils sont gravement malades.
Il est indispensable d’articuler les politiques sanitaires avec les politiques sociales. Un individu ne se résume pas à sa consommation de produits : il a des problèmes de logement, de ressources, de travail, de délinquance... Sa consommation n’a pas que des conséquences sanitaires. Elle a aussi des conséquences sociales. Or, cette articulation est faible en France. La mise en place des Agences Régionales de Santé risque d’accroître encore le cloisonnement entre le social et le sanitaire.
Enfin, de telles politiques pour être durablement efficaces ne peuvent reposer que sur un consensus large, au-delà des clivages politiques. Elles ne peuvent pas être remises en cause à chaque alternance au risque d’entraîner méfiance, scepticisme et désengagement.
Nicole Maestracci
Présidente de la Fédération nationale des associations d’accueil
et de réinsertion sociale
Magistrat, Présidente de la chambre à la Cour d’appel de Paris
Présidente de la Mission interministérielle de lutte contre la drogueet la toxicomanie de 1998 à 2002
Situation de la politique de réduction des risques en France
L’usage des drogues devient un problème social, repéré et identifié comme tel au XIX
e siècle sous le prisme de l’une de ses figures particulières : la toxicomanie. À tel point que la prise de stupéfiants et la toxicomanie vont être durablement perçues sinon comme des synonymes, du moins comme liées dans une relation nécessaire de cause à effet. Les premières tentatives de médicalisation des usages compulsifs et dépendants de drogues sont réalisées dans le dernier quart du XIX
e siècle... Il faudra attendre le début des années 1910 pour que les vocables de toxicomane et toxicomanie soient finement élaborés et que cette dernière soit conçue comme un concept englobant toutes les manies à base de substances (morphinomanie, cocaïnomanie...) dans un même ensemble... La toxicomanie reste longtemps une entité nosologique aux frontières incertaines oscillant entre intoxication et démence dans l’ombre d’un contrôle judiciaire et policier dominant. Jusqu’à ce que dans les années 1960 et plus certainement 1970 les lois de certains pays reconnaissent au toxicomane plus ou moins explicitement le double statut de délinquant et de malade et prévoient la possibilité de mesures thérapeutiques alternatives à une condamnation ou parties intégrantes d’une condamnation... Des politiques sanitaires et des dispositifs de soins spécialisés ou intégrés aux hôpitaux se développent... Le choix des options curatives fut essentiellement déterminé par des variables politiques et culturelles, en ce que les solutions de soins retenues durent être compatibles avec les valeurs politiques et les normes culturelles des États qui les décident et les mettent en œuvre.
1
Texte extrait de : BERGERON H. Sociologie de la drogue. Édition La Découverte, Collection Repères, Paris, 2009.
Sanitarisation du problème des drogues
Les États occidentaux ont initialement opté pour une politique principalement curative de traitement des toxicomanes : de même qu’il faut extirper du corps social le fléau qui menace la collectivité, il faut traiter les corps malades et s’attaquer, dans le cadre de la clinique des toxicomanies, aux causes individuelles du mal même si certains États, comme les Pays-Bas, ont agrémenté leur offre thérapeutique de services de traitement des conséquences liées à l’usage (hépatite C puis VIH, septicémie...).
La majeure partie des pays a également mis en œuvre une politique de diversité en matière d’offre de soins, combinant différentes options thérapeutiques. Mais certains d’entre eux, au premier rang desquels les États-Unis, ont préféré investir massivement sur la distribution de méthadone, dès les années 1970. La France a choisi une option particulière : les années 1970 et 1980 sont marquées par une psychologisation quasi exclusive des soins aux toxicomanes et le rejet concomitant d’alternatives thérapeutiques (communautés thérapeutiques, pratiques de substitution, soins des conséquences de la toxicomanie) en d’autres lieux parfaitement acceptables.
Si les pays occidentaux adoptent des modèles différents de traitement des problèmes de drogues, l’irruption du sida au milieu des années 1980 va bouleverser considérablement le paysage qui s’était stabilisé pendant près de vingt ans : le seul traitement curatif de la toxicomanie, et en particulier la recherche parfois forcenée de l’abstinence, ne peut plus être le pilier essentiel des stratégies sanitaires. Militent ainsi, un peu partout dans les pays occidentaux, des « coalitions de cause » (Kübler, 2000

), des réseaux de politiques publiques, regroupant des acteurs d’origines diverses mais dont les croyances sont convergentes (médecins humanitaires, associations d’usagers, professionnels du sida...) et pour lesquels il convient de réorganiser la hiérarchie des objectifs des politiques sanitaires. S’il est louable de vouloir traiter les causes de la toxicomanie et de prévenir les usages, il est urgent, argument-ils, en ces temps de menace planétaire pour la santé publique, de traiter les conséquences des usages et de prévenir les risques qui leur sont associés. C’est ainsi que le modèle dit de la « réduction des risques », développé originellement aux Pays-Bas (Boekout Van Solinge, 2004

), se trouve inscrit sur l’agenda politique. Profitant de la médiatisation sans précédent et de l’importance politique qu’a prise le problème du sida (Favre, 1992

) bénéficiant du soutien décisif des militants anti-sida qui ont acquis des positions clefs d’influence politique, les défenseurs de la réduction des risques vont réussir, partout en Europe, à imposer cette politique qui prévoit la mise en place de lieux de soins de première urgence, la distribution de matériel d’injection stérile et la fourniture extensive des produits de substitution. La méthadone est en effet réputée favoriser l’arrêt de l’injection intraveineuse d’héroïne et permettre au toxicomane de ne plus être prisonnier d’un mode de vie où la recherche du produit et des moyens de l’obtenir peuvent devenir une activité à plein temps. La méthadone fut ainsi conçue comme un instrument permettant non seulement de limiter la diffusion des virus du sida et de l’hépatite C mais aussi de favoriser une réinsertion sociale et sanitaire, jugée de plus en plus nécessaire pour certains toxicomanes toujours plus désocialisés et dans des situations médicales de plus en plus désastreuses (hépatite C, maladies opportunistes du sida...).
Les principes, priorités, outils et pratiques s’inscrivant dans le cadre de la « réduction des risques » ont ainsi « déferlé » en Europe comme autant de normes, solutions cognitives et professionnelles « appropriées » (au sens du néo-institutionnalisme sociologique) à la gestion des problèmes sanitaires et sociaux, que les différents experts nationaux s’accordent désormais à définir de manière relativement comparable. Au point qu’une recommandation du conseil de l’Union Européenne datant du 18 juin 2003 reconnaît politiquement, à l’unanimité des États membres (y compris la Suède, pays réputé le plus longtemps hostile à ce type d’approche ; Tham, 1995

), la valeur et l’importance de cette politique et de certaines interventions qui la composent (certaines mesures comme la distribution contrôlée d’héroïne restent cependant sujettes à controverse entre États membres et ne font pas partie des mesures visées par cette recommandation). Certains auteurs affirment ainsi que se dessine une tendance à la convergence des réponses sanitaires dans tous les pays de l’Union, tendance que la Commission européenne aurait amplement favorisée (Grange, 2005

; Bergeron, 2005

). Le Canada, le Brésil et l’Australie ont également adopté ce modèle. Seuls les États-Unis, en particulier à l’initiative des administrations Bush (père et fils), résistent à la mise en œuvre de ce qu’ils considèrent être une forme de renoncement moral et une porte ouverte à d’occultes manœuvres visant la levée de l’interdiction.
Ces mesures composent une politique qui suppose une reconnaissance, plus ou moins assumée politiquement selon les États, de l’usage de stupéfiants comme d’un fait anthropologique commun aux sociétés occidentales : il n’est plus cette poussée de fièvre que l’on pensait pouvoir étouffer dans les années 1970. L’utilisation des vocables « usage » et « usager », qui tendent à remplacer ceux de consommation, de consommateur ou de drogué, si elle procède de la progressive domination du vocabulaire des classifications internationales des maladies (CIM : Classification internationale des maladies ; DSM :
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), signerait, en outre, l’avènement de la représentation d’un individu capable de rationalité, non tout entier dominé par des causes psychiques qui court-circuitent son entendement, prompt à développer des stratégies de prise en charge de sa santé tout autant que de gestion de ses usages. Arguments de militants et résultats d’une certaine recherche sociologique entrent ainsi en résonance dans le combat politique en faveur de la réduction des risques. La montée de la réduction des risques marque donc une réelle sanitarisation des politiques des drogues. Elle s’inscrit dans le cadre de transformations de plus grande ampleur (qui dépassent le seul champ de la drogue et de la toxicomanie), qui témoignent du passage de ce que Goffman appelait le « schéma de réparation » (visant principalement la correction des défaillances ou des dysfonctionnements pathologiques) à un « schéma de croissance » dans lequel il s’agit, pour l’essentiel, de préserver sa santé et de prévenir les risques qui peuvent peser sur elle avant qu’ils ne surviennent (Castel, 1993

). Dans ce contexte, l’usage risqué de drogues risquées serait le propre d’individus mal socialisés aux normes et techniques d’optimisation du « capital santé », d’individus déviants à l’ordre sanitaire nouveau et à sa médecine de surveillance (Armstrong, 1995

).
La France a connu un destin resté longtemps singulier au regard de ces évolutions d’ensemble. En 1994, la politique publique française est encore principalement orientée vers des objectifs curatifs d’abstinence. On dénombrait ainsi alors quelques 9 500 places pour le traitement par la méthadone en Espagne ; 17 000 en Grande-Bretagne ; 15 650 en Italie ; 10 300 en Suisse ; 8 400 aux Pays-Bas. À la même époque, le dispositif français ne comptait, lui que 77 places. Il a fallu attendre le milieu des années 1990 pour qu’une telle politique soit mise en œuvre et que la méthadone soit introduite de manière extensive en France. Comment comprendre pareille singularité ? On explique souvent que la majorité des acteurs qui ont longtemps présidé aux destinées de la politique française ont progressivement constitué un paradigme particulier – mélange de considérations contre-asilaires et psychanalytiques – comme grille de lecture principale du phénomène de la toxicomanie, et que ce paradigme n’était guère favorable à une politique préventive et palliative et à l’introduction de la méthadone. La toxicomanie y était en effet interprétée comme le symptôme d’une souffrance psychique profonde née de traumatismes subis dans la plus tendre enfance, et l’usage de méthadone était par conséquent perçu comme un simple remplacement d’un produit addictif par un autre. Telle a été, en effet et en substance, l’argumentation principale développée par la communauté soignante et les représentants de l’État français pour motiver leur refus des produits de substitution pendant tant d’années. Mais comment est-on parvenu à une telle uniformité des opinions et de l’expertise ?
À partir d’une étude historique inscrite dans la tradition d’étude des politiques publiques, Bergeron (1999

) a cherché à identifier quels ont été les groupes d’acteurs qui ont progressivement exercé une influence déterminante dans la définition de ce que devait être la politique publique de soins aux toxicomanes. Il conclut qu’une « communauté de politique », composée d’acteurs d’origines diverses mais partageant des opinions convergentes concernant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre, s’est lentement constituée. Au sein de la Direction générale de la santé (DGS) du ministère de la Santé, un petit nombre de fonctionnaires nouent ainsi des alliances durables avec les représentants professionnels les plus influents du secteur spécialisé (en majorité des psychiatres), qui ont su s’imposer comme les seuls interlocuteurs légitimes du champ spécialisé. Ce couple d’acteurs s’est progressivement autonomisé vis-à-vis des autres instances administratives et politiques, qui auraient pu pourtant émettre un avis sur le contenu de la politique de soins. Comme l’ont montré Jobert et Muller (1987

) en analysant d’autres politiques publiques, on assiste pendant les années 1970 et 1980 au développement simultané d’un double leadership, professionnel et administratif, chacun ayant su s’octroyer la représentation légitime du segment concerné. Mais la seule mise en lumière de l’existence d’un couple d’acteurs autonomes et aux opinions convergentes ainsi que l’analyse des systèmes d’interdépendances durables qui ont lié ces acteurs laissaient une question importante sans réponse : comment pareilles opinions collectives ont-elles pu se maintenir dominantes aussi longtemps en France ? Cette question a porté Bergeron à considérer en particulier les problèmes ayant trait à la formation, au maintien puis à la transformation des croyances des acteurs et à mobiliser le modèle « cognitiviste » d’analyse des croyances collectives développé par Boudon (1986

, 1990

). Nous montrons ainsi que l’adoption d’une doctrine thérapeutique aux origines composites comme
corpus cognitif d’interprétation majoritaire dans le champ de la toxicomanie peut s’expliquer comme le résultat d’actions individuelles qui s’appuient sur de « bonnes raisons », compréhensibles (au sens de Weber) quand on les rapporte au contexte socio-historique et culturel dans lequel elles sont situées. En particulier, l’auteur montre que les acteurs en question ne voyaient qu’une frange particulière de toxicomanes (effet de position), qui ne présentait guère les caractéristiques (désocialisation extrême et situation sanitaire très dégradée) sur lesquelles s’échafaude précisément l’argumentation en faveur du développement de la méthadone dans les autres pays ; et que quand ils en rencontraient en effet, les théories qu’ils avaient progressivement faites leurs et qui s’étaient installées en « cadres cognitifs » (effet de disposition) induisaient une interprétation singulière guère favorable à la politique de la réduction des risques. Le modèle cognitiviste focalise donc l’attention sur le fait que le maintien d’une croyance (en l’espèce, le rejet de la méthadone) ne tient pas tant à un respect aveugle de certaines doctrines qu’au fait que l’acteur idéal-typique a des raisons solides de croire que le paradigme adopté et le dispositif institutionnel s’en inspirant sont adaptés à la population qu’il traite.
La survenue du sida a donc été l’événement déclencheur majeur d’un phénomène de sanitarisation (et de médicalisation pour la distribution de médicaments de substitution) dans l’approche du problème de l’usage, qui est de plus en plus saisi en termes de santé publique qu’en termes de violation des lois, d’atteinte à l’ordre public, d’aliénation mentale ou de déchéance sociale. Deux distinctions fondamentales s’opèrent à cette occasion :
• la distinction entre des usages présentant des risques variés et, en particulier, entre usage simple, abus (DSM III) ou usages nocifs (CIM-10) et dépendance ;
• la distinction, ensuite, entre les drogues : le vocable « drogue » perd peu à peu son caractère générique pour laisser apparaître des drogues plus ou moins risquées et plus ou moins dangereuses pour la santé, même si les droits de beaucoup de pays européens ne prennent pas acte de ces distinctions médicales et scientifiques.
Dans les deux cas, comme il en est de nombreux autres sujets (Borraz, 2008

), le risque est devenu l’unité à l’aune de laquelle se distinguent, se hiérarchisent et se classent les drogues. L’usage de drogue fait désormais partie de ce vaste continent des « conduites à risques », dont les déterminants sont, malgré les précautions prises, souvent présentés comme essentiellement individuels et que l’on isole, souvent à tort, du contexte social dans lequel ils s’expriment et qui peut en modifier singulièrement l’efficacité (Perreti-Watel, 2004

). Les usagers de drogues « rentrent dans le rang » : ils sont conçus, dans cette perspective, comme des individus autonomes, capables d’estimer les risques qui pèsent sur leur vie future, à l’image de l’homme moderne analysé par Giddens.
Sanitarisation et naissance de l’addictologie
Cette sanitarisation de l’approche des drogues, à la fois cause et conséquence de la mise en œuvre d’une politique extensive de réduction des risques, pourrait être renforcée par la naissance récente de l’addictologie et par la volonté politique croissante de penser (au moins dans le champ sanitaire) les usages de drogues illicites, de médicaments psychotropes, d’alcool et de tabac comme tous susceptibles de conduire à des usages risqués, voire à la dépendance. Pour une part toujours plus grande de la communauté savante et des experts, le terme générique d’addiction doit désormais, en effet, subsumer les concepts d’alcoolisme, de toxicomanie ou de tabagisme : « addictologie », « addiction » et « pratiques addictives » sont ainsi les termes qu’il convient aujourd’hui d’utiliser dans les arènes professionnelles et politiques constituées autour des problèmes de drogues (Bergeron, 2003

). Au fondement de ce mouvement, la percée, sur le marché scientifique comme en politique, des explications neurobiologiques des phénomènes d’addiction : théories qui montreraient l’existence de voies communes neurobiologiques à l’ensemble des pratiques addictives. La montée des explications d’ordre neurobiologique, qui fondent autant l’avènement de l’addictologie comme discipline clef de l’offre clinique que les orientations nouvelles des politiques publiques (Bergeron, 2003

), accentue ainsi la médicalisation et la sanitarisation que nous évoquions plus haut. Trois arguments principaux peuvent être avancés pour soutenir cette hypothèse (Bergeron, 2006

) :
• le regroupement des divers produits en une seule classe, celle des produits psychoactifs pouvant conduire à des pratiques addictives (plus ou moins risquées) est une opération cognitive qui gomme ou dilue l’épaisseur sociale et culturelle qui différencie encore symboliquement ces mêmes substances et la consommation ;
• en considérant, de plus, l’addiction comme la conséquence de dysfonctionnements neurobiologiques chroniques (qu’ils se réalisent sur la base d’une vulnérabilité innée ou acquise), la recherche en addictologie pointe désormais la possible découverte de médicaments ou de vaccins (comme pour la cocaïne), comme horizon raisonnable souhaitable ;
• enfin, les politiques publiques sectorielles qui se sont longtemps focalisées sur le versant curatif de l’intervention thérapeutique, en s’adressant principalement aux toxicomanes avérés, se transforment en des politiques qui visent tous les comportements de consommation, de l’usage simple à la dépendance. Autrement dit, ce qui relevait autrefois essentiellement d’une régulation morale et d’un contrôle juridique (l’abus et l’usage simple) tombe désormais également dans la juridiction d’une politique de santé publique globale.
Ces trois mouvements contribuent à inscrire la légitimité des politiques de contrôle et de régulation de l’usage dans des nécessités plus proprement sanitaires et médicales.
Finalement, c’est au moment de l’histoire des politiques de drogues où la compréhension biomédicale des déterminants de leurs usages (et en particulier de la dépendance) semble progresser que la réponse coercitive, dans certains États, trouve les conditions de son plus grand épanouissement. Comme l’indique Pharo (2006

), l’addiction est devenue la seule maladie dont on punit les conséquences (c’est-à-dire l’usage).
Sanitarisation et rapprochement des politiques européennes de stratégie anti-drogues
Le contrôle des usages et bien sûr du commerce des drogues sont longtemps restés principalement d’ordre judiciaire et policier, même si les toxicomanes se sont vite vu offrir des traitements de toutes sortes. Progressivement, et de manière plus évidente dans le dernier quart du XXe siècle, les problèmes liés aux drogues ont été toutefois de plus en plus manifestement définis en référence à une grammaire sanitaire et aux conséquences pour la santé publique qui pouvaient leur être liées.
Longtemps, les politiques publiques ont paru se définir dans le cadre de logiques et de spécificités essentiellement nationales : elles semblaient être marquées par les particularismes sociaux, institutionnels et culturels de chacun des États. Cattacin et Lucas (1999

) distinguaient ainsi, en Europe, trois types d’États-providence constitués dans les différents pays européens. L’on peut se demander aujourd’hui si la médicalisation et la sanitarisation des problèmes de drogues n’ont pas contribué à effacer les différences les plus saillantes entre pays européens. Ce progressif rapprochement des politiques européennes doit certainement beaucoup à la reconnaissance croissante du caractère fondamental de la réduction des risques dans les stratégies anti-drogues, tout autant qu’au refus de considérer la prison comme la peine devant sanctionner l’usage simple. Il est remarquable qu’il s’agisse là de deux pommes de discorde qui divisaient profondément les États membres il y a encore dix ans, et qui sont aujourd’hui des sujets suscitant sinon un froid consensus, du moins des discussions plus techniques et moins passionnées. Il est, bien sûr, trop tôt pour affirmer que les politiques des États européens connaissent des trajectoires parfaitement convergentes, mais l’on peut toutefois légitimement se demander si un modèle européen de politique des drogues n’est pas en train d’émerger, sur un sujet où l’Union européenne n’a pourtant guère de compétences communautaires. Les ressorts précis des dynamiques présidant à ce supposé processus de convergence politique restent encore à explorer, même si certains auteurs forment déjà quelques hypothèses sur le rôle clef de la Commission européenne et de certaines de ses institutions (Grange, 2005

; Bergeron, 2005

).
Phénomène de juxtaposition de l’État social et de l’État pénal en Europe
On remarquera également avec intérêt que les politiques européennes se distinguent de celles menées aux États-Unis, où l’État pénal aurait, d’après certains auteurs (Wacquant, 1998

), remplacé l’État social. Ce que l’on pourrait appeler le « modèle de la fonction inverse » et qui suppose que la réponse pénale s’accroît à mesure que l’offre sociale décline ne s’applique guère à la situation européenne : contrairement à ce qu’avance Wacquant pour les États-Unis (et en le paraphrasant), le traitement pénal sévère (par l’emprisonnement en particulier) de l’usage simple de drogues a progressivement, en Europe, été doté d’une charge symbolique négative, tandis que l’approche médicale et sociale (donc par le
welfare) s’est vue gagner progressivement une connotation positive. Toutefois, si l’État pénal, décrit par Wacquant, cet État qui enferme plutôt qu’il ne traite (ou qui traite en enfermant), ne s’est pas épanoui en Europe, l’on ne peut manquer de relever l’augmentation des interpellations massives pour usage dans un grand nombre de pays, les tentatives de maximisation de la réponse judiciaire à l’usage, dans un certain nombre d’autres, et le maintien généralisé du principe de la prohibition. Ainsi est-il plus juste de constater l’existence d’un phénomène de juxtaposition de l’État social et de l’État pénal en Europe, que d’avancer l’hypothèse d’une relation de compensation.
En conclusion, on ne peut s’empêcher de pointer l’existence d’une tendance à réprimer les « atteintes au bon agencement des relations en public » (Wacquant, 1998

) : législation sur la drogue au volant, mesures de lutte contre les nuisances publiques (en particulier en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique et en Grande-Bretagne), interdiction des rassemblements de jeunes qui boivent de l’alcool dans les lieux publics (Espagne), dispositions réglementaires encadrant l’organisation de
rave parties et leur isolement dans des espaces fermés, ou encore tentations grandissantes de contrôle de la consommation sur le lieu de travail et du développement consécutif de l’utilisation des tests (Crespin, 2004

)... Voilà autant de mesures, diverses certes, mais qui cherchent la « civilisation » de conduites nuisibles pour la collectivité, leur maintien à distance de l’espace partagé ou tout bonnement leur interdiction (Bergeron, 2009

). Il n’est pas déraisonnable de vouloir y discerner une volonté de protection de l’espace public et de la collectivité, protection qui était un des arguments clefs de la campagne de promotion de la réduction des risques. À n’en pas douter, comme dans le cas de la formation d’autres politiques publiques, les associations de « victimes » de ces usages et usagers auront un rôle plus important dans l’élaboration de l’action publique si pareille tendance venait à s’affirmer, comme ce fut le cas en France lors du vote de la loi sur les stupéfiants au volant en 2003 (loi dite Marilou, du nom de l’association créée par les parents d’une victime d’un accident de la route où le conducteur d’un des véhicules avait été testé positif au cannabis). Médicalisation, souci de sécurité sanitaire et contrôle de l’espace public, voilà les trois axes de développement de la régulation politique et du contrôle social de l’usage de drogues.
Bibliographie
[1] armstrong d. The rise of surveillance medecine.
Sociology of Health and Illness. 1995;
17:393
-404

[2] bergeron h. L’État et la toxicomanie. Histoire d’une singularité française.
PUF, Sociologies;
Paris:1999;

[3] bergeron h. Dispositifs spécialisés « alcool » et « toxicomanie », santé publique et nouvelle politique publique des addictions.
OFDT, Collection Rapport de Recherches;
Paris:2003;

[4] bergeron h. Europeanisation of drug policies: from objective convergence to mutual agreement.
Health Governance and Theories. In: STEFFEN M (Dir.), editors.
Routledge, Londres:2005;

[5] bergeron h. Les politiques publiques en Europe: de l’ordre à la santé publique.
Médecine et addictions. In: REYNAUD M (Dir.), editors.
Éditions Masson;
Issy-les-Moulineaux:2006;

[6] bergeron h. Sociologie de la drogue.
Éditions La Découverte, Collection Repères;
2009;

[7] boekout van solinge t. Dealing with drugs in Europe. An investigation of European Drug Control Experiences: France, the Netherlands and Sweden.
Bju Legal Publishers;
La Haye:2004;

[8] borraz o. Les politiques du risque.
Presses de Sciences Po, Gouvernances;
Paris:2008;

[9] boudon r. L’idéologie ou l’origine des idées reçues.
Le Seuil, Points;
Paris:1986;

[10] boudon r. L’art de se persuader, des idées douteuses, fragiles ou fausses.
Fayard;
Paris:1990;

[11] castel r. Une préoccupation en inflation.
Informations sociales. 1993;
26:87
-96

[12] cattacin s,
lucas b. Autorégulation, intervention étatique, mise en réseau. Les transformations de l’État social en Europe. Les cas du VIH/sida, de l’abus d’alcool et des drogues illégales.
Revue française des sciences politiques. 1999;
49:379
-398

[13] crespin r. De la prévention à la répression : le parcours social des tests de dépistage des drogues. Une étude comparative France-États-Unis.
Rapport pour la Mildt;
2004;

[14] favre p (dir). Sida et politique. Les premiers affrontements (1981-1987).
L’Harmattan, Dossiers sciences humaines et sociales;
Paris:1992;

[15] grange a. L’Europe des drogues. L’apprentissage de la réduction des risques aux Pays-Bas, en France et en Italie.
L’Harmattan, Logiques politiques;
Paris:2005;

[16] jobert b,
muller p. L’État en action. Politiques publiques et corporatisme.
PUF, Recherches politiques;
Paris:1987;

[17] kübler d. Politique de la drogue dans les villes suisses. Entre ordre et santé.
L’Harmattan, Logiques politiques;
Paris:2000;

[18] peretti-watel p. Du recours au paradigme épidémiologique pour l’étude des conduites à risque.
Revue française de sociologie. 2004;
45:103
-132

[19] pharo p. Plaisir et intempérance : anthropologie morale de l’addition.
Rapport de recherche Mildt;
2006;

[20] tham h. Drug control as a national project: the case of Sweden.
The Journal of Drug Issues. 1995;
25:113
-128

[21] wacquant l. L’ascension de l’État pénal en Amérique.
Actes de la recherche en sciences sociales. 1998;
124:7
-26

Henri Bergeron
Centre de sociologie des organisations, Institut de Sciences politiques, CNRS
Paris
Approche judiciaire française
En matière de politique anti-drogue, l’approche judiciaire française insiste sur la coordination des stratégies pénales, sanitaires et sociales, ainsi que sur le primat accordé à la prévention et aux soins.
Encadré par un dispositif légal spécifique et fondé sur la nécessité d’une politique partenariale, le système français apporte une réponse judiciaire systématique adaptée et diversifiée à l’usage de produits stupéfiants.
Cadre légal propice à un traitement effectif
Devant les nouveaux enjeux de santé publique auxquels doivent désormais répondre les pouvoirs publics, la loi du 31 décembre 1970 qui constitue le cadre légal dans lequel s’inscrit la politique française de lutte contre les drogues a dû évoluer.
Loi du 31 décembre 1970
La loi du 31 décembre 1970 a posé le cadre légal de la politique française de lutte contre la toxicomanie et a introduit l’article L 3421-1 du Code de la Santé Publique qui sanctionne l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Par la suite, cette loi a été complétée par plusieurs circulaires, qui ont constamment mis l’accent sur la prévention sanitaire. En effet, il apparaît nécessaire pour la justice de tenir sa place au carrefour des politiques sanitaires et sociales d’une part, et répressives d’autre part.
Opportunité des poursuites
En outre, le cadre procédural, en consacrant le principe de l’opportunité des poursuites, permet une prise en charge plus efficace de la toxicomanie. En effet, aux termes de l’article 40-2 du Code de Procédure Pénal, lorsque le Procureur de la République territorialement compétent estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne, celui-ci décide s’il est opportun, soit d’engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites.
Réponse judiciaire systématique adaptée et diversifiée
Le système judiciaire français a su développer une politique spécifique de prise en charge des usagers de stupéfiants. Celle-ci est avant tout axée sur la coordination des autorités répressives et sanitaires, et privilégie la prévention et le soin (figure 1

). Le but est, d’une part, de prendre en considération la relation qu’entretient la personne avec le produit, et, d’autre part, de donner la priorité à l’intervention des professionnels du réseau sanitaire.
Mesures alternatives aux poursuites
Le recours aux mesures alternatives aux poursuites a pris une place grandissante dans la politique pénale. Plusieurs critères interviennent lors du choix de la mesure alternative. Tout d’abord, il s’agit de prendre en compte la personnalité de l’intéressé. Par ailleurs, il convient de s’intéresser au mode de consommation de ce dernier. Enfin, le contexte général dans lequel il évolue (famille, activité professionnelle, domicile...) doit également être analysé.
Il existe plusieurs types de mesures alternatives aux poursuites :
• les rappels à la loi : ils sont effectués, soit par l’officier de police judiciaire ou par le délégué du procureur de la République, soit par courrier. Cette approche est pertinente dans le cadre d’un usage occasionnel de cannabis ;
• les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants : ils ont été créés en application de la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007. Ces stages visent à faire prendre conscience aux usagers de produits stupéfiants des dommages sanitaires et des incidences sociales causés par leur consommation. Il s’agit également de modifier, sur un mode collectif, les habitudes d’usage des stagiaires. Au-delà de ce travail de sensibilisation, le stage représente également une sanction pédagogique pécuniaire à la charge de l’usager, en ce qu’il lui coûte 100 euros ;
• les classements avec orientation : ils s’adressent à des consommateurs souvent non dépendants et sans problèmes socio-familiaux ou psychologiques notables. Ils consistent en une obligation, pour l’auteur des faits, de se rendre à la structure qui lui est indiquée par le délégué du procureur de la République. La structure ainsi désignée assume une triple mission. Il s’agit d’abord d’effectuer un bilan de la situation de l’intéressé, puis d’évaluer les démarches nécessaires en termes d’accès aux services médico-sociaux, et enfin d’organiser la prise en charge de ces démarches ;
• les injonctions thérapeutiques : elles constituent un instrument essentiel de traitement des personnes en état de dépendance avérée, ce type de mesure associant soins et coercition. La situation des personnes considérées, se traduisant souvent par des difficultés d’insertion sociale, les modalités de mise en œuvre des injonctions thérapeutiques et leur suivi doivent contribuer à favoriser la réussite d’un processus de réinsertion construit sur la durée.
Poursuites
Si les exigences posées par les mesures alternatives ne sont pas respectées, l’usager de produits stupéfiants sera poursuivi devant le tribunal correctionnel. Néanmoins, la prise en charge sanitaire demeure la préoccupation principale. Ainsi, la plupart des condamnations sont des peines d’emprisonnement assorties d’un sursis, avec mise à l’épreuve consistant en une obligation de soins suivie par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.
Par ailleurs, il est important de noter que, même dans les cas d’emprisonnement ferme, l’usager ne doit pas se trouver privé d’une prise en charge sanitaire adaptée lors de sa détention. Il existe ainsi des centres de soins spécialisés en toxicomanie en milieu pénitentiaire.
Nécessaire politique partenariale
La prise en charge sanitaire de l’usager de drogues reste la préoccupation principale des services judiciaires. Pour qu’elle soit effective, il est nécessaire qu’un partenariat efficace s’installe entre les autorités judiciaires, sanitaires et sociales.
Conventions Départementales d’Objectifs Justice/Santé
Actuellement, la majorité des décisions prises par le ministère public c’est-à-dire par l’ensemble des magistrats chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale en requérant l’application de la loi, est mise en œuvre par le biais des Conventions Départementales d’Objectifs Justice-Santé.
Les conventions départementales d’objectifs (CDO) ont été créées par la circulaire interministérielle du 14 janvier 1993. Elles définissent localement les priorités de la politique judiciaire à l’égard des usagers de substances psychoactives (drogues illicites, alcool, polyconsommations) et proposent des réponses adaptées aux besoins identifiés dans les départements. Elles appuient financièrement les structures socio-sanitaires susceptibles d’accueillir les publics orientés par les instances judiciaires.
Chef de projet départemental
La Préfecture de Paris met en œuvre des politiques gouvernementales en matière de répression de l’usage des drogues illicites et un chef de projet départemental « drogues et dépendances » anime le réseau des services déconcentrés de l’État chargés de mettre en œuvre ces politiques. Sous l’autorité du Préfet, il coordonne les actions des services déconcentrés sur l’ensemble du champ des drogues. Il élabore un programme départemental pluriannuel et interministériel fixant les axes prioritaires destinés à améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes placés sous main de justice et à mieux prévenir la récidive. Une délégation annuelle de crédits de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Mildt) lui permet ensuite de financer l’application des orientations envisagées.
En conclusion, la loi du 31 décembre 1970, qui réprime le simple usage d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, est toujours en vigueur, il n’y a pas légalisation ni dépénalisation. La réponse judiciaire doit participer à la lutte contre la récidive en évitant l’engrenage de la délinquance et l’exclusion des toxicomanes mais elle doit aussi orienter les usagers de drogues vers un interlocuteur compétent dans le champ sanitaire et social. Action de la justice et action sanitaire et sociale sont articulées par des conventions entre les services de soins et les procureurs de la République afin que tous les usagers en difficulté avec les substances psychoactives, puissent bénéficier de prévention et soins.
Françoise Guyot
Vice-Procureure
Chargée de mission au cabinet du Procureur de Paris
Rôle des associations dans la politique de réduction des risques en France
Cette contribution reprend pour l’essentiel la synthèse présentée lors de l’audition du 8 juin 2009. Trois questions m’avaient été posées :
• Quel rôle les associations ont-elles joué dans l’initiation et la mise en œuvre d’une politique de réduction des risques en France ? Quels ont été les obstacles ? Comment ont-ils été surmontés ?
• Quelle est leur situation aujourd’hui ? Quels sont les grands objectifs à atteindre ?
• Comment se situe la France par rapport aux autres pays ?
Le diagnostic que je pose ici est partiel. Il repose sur mes différentes pratiques : pratiques de militante associative, pratique de terrain, pratique de recherche. Aussi est-il inégal selon les questions posées. Si je me sens tout à fait à l’aise en ce qui concerne l’origine du dispositif, il n’en est de même de l’état des lieux du dispositif actuel. Je connais indirectement la situation en Île-de-France, mais pour ce qui concerne le territoire national, j’ai fait un premier diagnostic en 2004 à partir d’une recherche initiée par le Dr Pierre Goisset pour l’AFR. La mise en commun de nos données avec l’association Safe a abouti à un rapport qui ne peut prétendre à un état des lieux rigoureux, compte tenu des conditions de recueil et de traitement des données, mais il reflète les difficultés auxquelles le dispositif était confronté en 2004
1
COPPEL A, DUPLESSY C. Les enjeux de l’institutionnalisation du dispositif national de RDR. Une mise en perspective à partir de trois sources de données. Projet européen « Rezolat », 2004. Voir le site Internet de l’AFR et
http://www.reductiondesrisques.fr/annecoppel/.
. Ma dernière pratique de recherche remonte à 2006. Elle porte sur la diffusion de l’usage de stimulants par de jeunes habitants des cités populaires en banlieue parisienne
2
COPPEL A. Consommation de stimulants et jeunes des cités : nouvelles représentations, nouvelles pratiques. Rapport remis à la Direction Générale de la Santé, Décembre 2006.
. Ce travail a été effectué sur la base d’un double constat : la plupart des équipes, y compris les mieux implantées, ne parviennent pas à nouer des relations avec les nouvelles générations d’usagers de drogues. Pour ce qui concerne les banlieues en Île-de-France, la difficulté est redoublée : personne ne parvient à savoir ce qui se passe exactement. La répression et la stigmatisation ont rompu les liens entre les générations d’usagers.
Je ne suis pas en mesure de faire un état des lieux systématique quant à la position de la France. J’ai toutefois participé à une recherche sur les politiques menées dans différentes villes européennes, impulsées souvent à partir des problèmes soulevés dans le voisinage des scènes ouvertes. Je n’ai pas développé ici cette approche, très différente de la politique nationale française de réduction des risques, politique strictement sanitaire. Je me suis contentée d’une rapide synthèse de ce travail qui se traduit en recommandations pour le développement du partenariat avec les élus locaux
3
COPPEL A. Usage de drogues, services de 1res lignes et politiques locales, guide pour les élus locaux. Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), Programme Démocratie, Villes & Drogues, février 2008.
.
Je n’ai pas référencé les nombreux travaux que je cite ni donné les références de tous les textes réglementaires ou rapports officiels. Chaque phrase ou presque aurait exigé une ou plusieurs références bibliographiques. Le plus souvent, je me suis contentée de renvoyer aux revues de la littérature que j’ai effectuées. J’ai ajouté quelques notes, en particulier lorsqu’il s’agit de publications qui ne sont pas citées dans la bibliographie de cette expertise. Tous les textes que j’ai rédigés sont accessibles sur le site
http://www.reductiondesrisques.fr/annecoppel/.
À l’origine du dispositif, la mobilisation des associations
Émergence de nouveaux acteurs de terrain
Avant d’être une politique, la réduction des risques a été un ensemble de pratiques d’acteurs qui se sont engagés, pour les uns dans la prévention du sida pour les autres dans les soins somatiques ou même dans la recherche de traitement de la toxicomanie
4
Sur l’histoire du dispositif, voir : COPPEL A. Peut-on civiliser les drogues, de la guerre à la drogue à la réduction des risques. La Découverte, Prologue 2002 : 7-52.
. Les premières initiatives ont été peu nombreuses, elles ont été impulsées par des acteurs isolés, à l’extérieur du système de soin ou à ses marges. La toute première action remonte à 1986, elle a été mise en œuvre par Aides. C’est une brochure de prévention du sida dont Daniel Defer, Président de Aides, avait voulu qu’elle soit réalisée avec des usagers de drogues. Jusqu’en 1989, c’est la seule action de terrain, mais entre 1989 et 1990, une première série d’initiatives est mise en œuvre :
• programme d’échange de seringues (PES) de Médecins du Monde (MDM) ;
• test VIH et prévention du sida auprès des toxicomanes par une équipe de rue d’ex-toxicomanes de Seine-Saint-Denis par l’association Arcades, qui héritera du premier programme d’échange de seringues en Seine-Saint-Denis ;
• prévention du sida auprès des femmes prostituées avec le Bus des Femmes (Centre collaborateur OMS-Sida) ;
• prévention du sida auprès des prostitués transsexuels (Aides) ;
• programme méthadone-insertion au Centre Pierre Nicole (12 places expérimentales) ;
• sensibilisation de pharmaciens et premières expérimentations du stéribox (centre municipal de santé Ivry) ;
• premières réunions d’usagers de drogues actifs (Appart).
L’année 1989 est l’année de la création de l’Agence française de lutte contre le sida (AFLS) dont une des missions était le développement d’actions auprès des groupes particulièrement exposés au risque de contamination. Cette nouvelle mission marque un tournant : désormais la démarche de santé communautaire est encouragée. Jusqu’en 1989-1990, les actions spécifiques étaient suspectes de « communautarisme ». C’est la raison pour laquelle la seule mesure prise en direction des usagers de drogues pendant cette première période est la mise en vente libre des seringues en 1987, mais au niveau international, les actions de prévention du sida auprès des usagers de drogues ont fait la preuve de leur efficacité dès la fin des années 1980. Sous la pression d’organisations internationales (OMS, Lutte contre le sida), le ministère de la Santé veut impulser des actions expérimentales ; encore faut-il trouver des volontaires. Lorsque MDM propose son projet de PES, la DGS, inquiète du risque de disqualification du système de soin traditionnel, s’efforce de convaincre les spécialistes. Elle parvient à négocier deux programmes rattachés au système de soin, l’un à Marseille, l’autre en Seine-Saint-Denis, mais aucun de ces programmes ne parvient à échanger une seule seringue. Les spécialistes ne connaissent qu’une seule pratique, la cure de désintoxication. Il faut changer les façons de faire, changer les façons de penser et pour le moment, il n’en est pas question
5
COPPEL A. Les intervenants en toxicomanie, le sida et la réduction des risques en France. Vivre avec les drogues. Le Seuil, Communications n°166, 1996 : 75-108.
. Tous ceux qui s’engagent dans ces premières expérimentations avaient commencé à nouer des liens avec des usagers hors institution : Aides dans ses accueils, MDM dans ses consultations précarité, le médecin généraliste dans sa consultation du centre santé. Arcades et le Centre Pierre Nicole sont les seuls acteurs issus du système de soins spécialisés ; leur engagement est lié en partie aux liens tissés antérieurement avec le terrain
6
Trois sites ont donné lieu à une recherche-action : le Forum des Halles, le XVIIIe (EGO) et Orly en Île-de-France. Voir : COPPEL A. Pour une réponse communautaire au défi de la drogue, 1989, Centre Pierre Nicole, Comité départemental de la Croix-Rouge, DRASS Île-de-France, Sous-Direction de l’action sanitaire et sociale de la CRAMIF, 1989. Voir aussi le colloque « Politique locale et toxicomanie » FIRST, 1990. Voir également « ARCADES, une action communautaire en Seine St Denis », Chapitre 10, In : Peut-on civiliser les drogues, de la guerre à la drogue à la réduction des risques. COPPEL A. La Découverte, Prologue 2002.
mais pour ce qui concerne l’expérimentation du programme méthadone, les Dr Charles-Nicolas et Didier Touzeau étaient tous deux attentifs aux résultats obtenus au niveau international.
Expérience française et influences internationales
Tous ces acteurs sont en lien avec des organisations internationales soit par leur participation aux conférences internationales de lutte contre le sida soit par des recherches subventionnées par l’OMS (Arcades, le Bus des Femmes), mais l’influence internationale s’exerce d’abord de façon limitée. Dans les conférences internationales, les Français constatent la participation de groupes minoritaires, mais ils considèrent que cette démarche, fondée sur la notion de « groupe à risque », serait propre au monde anglo-saxon. Dès 1986, lors de la seconde Conférence internationale de lutte contre le sida organisée à Paris, une recherche menée à New York par l’équipe de Don Des Jarlais démontre le changement de comportement des toxicomanes, mais l’information est inaudible
7
DESJARLAIS DC. 1989, cité dans la revue de la littérature que j’ai effectuée en 1993 dans « Stratégies collectives et prévention de l’infection par Ie VIH chez les toxicomanes », Sida, Toxicomanie, Une Lecture documentaire, Le Crips/Toxibase, novembre 1993 : 95-105.
. À l’exception de quelques chercheurs, le refus de cette information est général. Ainsi la plupart des médecins qui, en France, expérimentent la prescription d’opiacés ignorent la littérature internationale sur la méthadone. Ils savent qu’ailleurs, ces traitements sont prescrits, mais a priori, les recherches ne sont pas plus crédibles que celles de psychiatres russes justifiant la médicalisation d’opposants politiques.
Dans un premier temps, l’information est minimale, elle peut seulement inspirer ou conforter les premiers engagements : « À l’étranger, il y a des associations d’usagers de drogue ». Ou bien, « des distributions de seringues sont organisées ». L’information internationale jouera un rôle majeur à chaque étape du développement du dispositif, mais les acteurs ne seront en mesure de la solliciter qu’à partir du moment où cette information leur sera directement utile. Pour que les acteurs se saisissent de l’information internationale, il faut qu’elle corresponde ou qu’elle éclaire l’expérience de terrain.
Des prescriptions médicales sauvages à la notion de traitement
S’il n’y a pas eu d’actions menées sur le terrain entre 1986 et 1989, quelques médecins ont commencé à prescrire des médicaments substitutifs. Leur rôle va être déterminant à la fois dans le changement des croyances et dans les résultats. Le médicament le plus souvent prescrit est le Temgésic (buprénorphine), un antalgique qui, au contraire des morphiniques, n’exige pas l’utilisation du carnet à souche. La toxicomanie étant considérée comme le symptôme d’une souffrance psychique, ces prescriptions n’ont pas le statut de traitement de la toxicomanie ni d’un point de vue de leur statut officiel ni pour le médecin qui les prescrit ni même pour les usagers qui les réclament. Ces prescriptions se veulent ponctuelles, par exemple le temps d’une hospitalisation ou pour traiter une maladie somatique. Ces médicaments sont aussi demandés par les usagers « pour décrocher progressivement » disent-ils. Malgré les mises en garde, quelques médecins acceptent de répondre à la demande, mais ils se gardent bien de revendiquer ces prescriptions sauvages. Les médecins prescripteurs ne se connaissent pas entre eux, même s’il s’agit souvent de médecins relevant des réseaux ville-hôpital, mis en place dès 1986 dans la lutte contre le sida.
Ces prescriptions sont régulièrement dénoncées par les spécialistes. Au 1er septembre 1992, après deux années de débat, la commission des stupéfiants impose le recours au carnet à souches pour la prescription du Temgésic avec les mêmes contraintes que les morphiniques. La plupart des médecins renoncent à ces prescriptions, et les usagers en manque se bousculent dans les rares cabinets des médecins qui acceptent d’utiliser leur carnet à souche. C’est aussi le moment d’une prise de conscience : l’arrêt brutal des prescriptions médicales a des conséquences graves (retour à une vie de galère, dépression, suicides, overdoses observées par quelques médecins). Ces prescriptions protègent la santé de ces nouveaux patients, il s’agit bien d’un traitement.
Ouverture du débat public et développement des premiers réseaux
Le 9 septembre 1992, un appel aux médecins généralistes est publié dans le Monde, signé par les premiers prescripteurs, médecins généralistes pour la plupart, mais également les spécialistes du premier programme méthadone créé en 1990
8
Le repère du toxicomane. Le Monde, 9 septembre 1992, Texte collectif, Appel adressé aux médecins généralistes rédigé après le passage du Temgésic sur carnet à souche.
. Si l’article est publié dans le Monde, c’est qu’aucun journal médical n’avait accepté de le publier. Pour s’engager dans le débat public, il nous a fallu prendre conscience à la fois de la gravité de la situation et des réponses qui permettaient d’y faire face. La Conférence de lutte contre le sida de juillet 1992 à Amsterdam a été un moment clé de cette prise conscience. Une trentaine de Français engagés dans les premières expérimentations y participaient. Chacun de son côté développait des pratiques dont nous apprenons qu’elles relèvent d’une politique de santé publique dite de « réduction des risques » ou plus précisément des dommages «
harm reduction ».
Jusqu’alors, nous pensions qu’en France, les réponses nécessaires allaient se développer progressivement, mais lorsque la porte entrouverte par les prescriptions sauvages se referme brutalement, la gravité de la situation nous contraint à rompre le silence. Impensable jusque-là, le débat s’enflamme. Le consensus français sur le statu quo tenait au silence, il vole brutalement en éclats. Une à une, les croyances collectives sont remises en cause : il y a bien une situation d’urgence, les usagers doivent pouvoir protéger leur santé même s’ils consomment des drogues. Protéger la santé de tous, c’est précisément la mission de la santé publique.
Tandis que les médecins prescripteurs créent un réseau, le Repsud, les échanges entre les différents acteurs se multiplient. En octobre 1992, Kouchner, ministre de la Santé, s’engage à ouvrir 250 places pour un traitement par la méthadone et à développer des PES. Il ne parvient pas à convaincre son gouvernement qui, avec Paul Quilès au ministère de l’Intérieur, déclare « la guerre à la drogue ». Le plan de lutte contre la drogue qu’il élabore en décembre 1992 sera poursuivi par Pasqua, ministre de l’Intérieur du gouvernement suivant. Les interpellations se multiplient. La situation des usagers s’aggrave de jour en jour, mais contrairement aux années 1980, où des milliers d’usagers sont morts dans le silence, désormais il y a des témoins de cette « catastrophe sanitaire », diagnostic que posera la commission Henrion en 1994
9
Rapport de la commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie. Commission présidée par le Pr. Roger Henrion, 1994. La Documentation Française.
. Avec le développement des prescriptions médicales en médecine de ville, les patients de plus en plus nombreux surgissent dans les hôpitaux. Durant l’hiver 1993, de nouveaux acteurs se mobilisent dans plusieurs villes de province. Lorsqu’ils sont trop isolés pour créer leurs propres projets, ils rejoignent les associations nationales, Aides ou Médecins du Monde, qui acceptent de porter ces nouveaux projets.
Usagers de drogues, acteurs de terrain et médecins : la confrontation des expériences dans « Limiter la casse »
En avril 1993, à l’initiative d’Arnault Marty Lavauzelle, Président de Aides, avec Asud et moi-même, nous regroupons tous les acteurs dont nous savons qu’ils sont engagés sur le terrain, militants associatifs, médecins, psychiatres ou intervenants en toxicomanie. Des journalistes et des chercheurs s’impliquent également, sans compter de simples citoyens, proches, étudiants, ou philosophes. Le pluriel ne doit pas faire illusion : l’engagement est individuel, mais chacun va diffuser ce qu’il vient de comprendre dans son champ propre. Pour la première fois, les usagers de drogues sont au cœur de ce regroupement : il leur appartient de définir leurs besoins. Ils vont démontrer l’utilité des prescriptions médicales de substitut qui, a priori, étaient loin de faire consensus. Manifestement, il faut se faire entendre, mais l’enjeu ne se limite pas au débat public. Que faut-il demander au juste ? Comment évaluer les besoins ? Faute de recherches, on ne dispose d’aucun outil d’évaluation. Au-delà de la santé, le débat porte sur la politique des drogues : faut-il changer la loi ? Faut-il arrêter la prohibition ? L’association « Limiter la casse » devient un lieu de débat théorique et politique, mais elle est aussi un lieu d’expérimentation : quelles relations entre les usagers de drogues et leur environnement ? Que faut-il accepter ? Quelles limites se donner ? Les nouveaux savoir-faire se bricolent au jour le jour dans le plus grand empirisme, ils se diffusent dans les réseaux relationnels, portés par l’exaltation des temps d’expérimentation.
Mise en place d’un dispositif expérimental
Le 23 septembre 1993, le Conseil National du Sida préconise des mesures de prévention du sida auprès des usagers de drogues, mais le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et la toxicomanie, présenté le même jour s’attache pour l’essentiel à renforcer le dispositif existant, dont la création de 1 000 lits de cure de désintoxication. Simone Veil, ministre des Affaires sociales et de la santé, alertée par des experts, prend rapidement conscience que la santé publique n’est nullement un prétexte : le scandale du sang contaminé prouve qu’elle doit être prise au sérieux. Pour Simone Veil, l’obstacle est d’abord d’ordre législatif : on ne peut à la fois distribuer des seringues et en interdire l’usage. C’est la raison pour laquelle elle crée la commission présidée par le Pr. Henrion qu’elle charge de répondre à une question : « Faut-il changer la loi ? ». La commission ne parvient pas à un consensus sur la dépénalisation. En revanche, au fur et à mesure des auditions, l’urgence de santé publique ne fait plus de doute. En 1993, la toxicomanie est devenue la première cause de la mortalité des 18-44 ans en Île-de-France, avec deux indicateurs, la mortalité due au sida et les overdoses mortelles, c’est-à-dire uniquement celles qui sont identifiées sur la voie publique par la police, autrement dit avec une toute petite part de la mortalité effective
10
.
Le 21 juillet 1994, Simone Veil rend public la mise en place du dispositif expérimental de réduction des risques infectieux. Elle n’a pas perdu de temps. Le programme est déjà en partie réalisé. Dix huit PES sont déjà créés sur les 25 financés par le dispositif expérimental. Ce dispositif mobilise les médecins dans 12 réseaux ville-hôpital et les pharmaciens qu’il dote d’une trousse de prévention, le stéribox. À chaque fois, les financements viennent en complément de la mobilisation bénévole. En revanche, dans les programmes méthadone, les places sont subventionnées une à une. Durant l’hiver 1994, 13 programmes méthadone ont été ouverts. Chacun de ces projets a été négocié un à un et Simone Veil a veillé personnellement à ce que tous les obstacles administratifs soient surmontés. En juillet, 1 647 places méthadone sont financées. Nous sommes très au delà des 250 places promises en octobre 1992, puis en septembre 1993. Et pourtant, une nouvelle question se pose : est-ce suffisant ?
Changement de pratiques, changement de croyances
Les nouvelles pratiques vont peu à peu ébranler le système de croyances, car le changement des pratiques précède le changement des croyances. Encore faut-il pouvoir se référer à un nouveau cadre d’interprétation. « Le traitement de la toxicomanie » n’est pas encore devenu le traitement de la dépendance, mais les médecins savent que leurs prescriptions sont justifiées et ils les revendiquent. Reste une question non résolue : les patients en médecine de ville seraient plus d’une dizaine de milliers. Que vont-ils devenir ? Les contraintes de la prescription de méthadone interdisent d’espérer qu’ils puissent tous être intégrés dans des programmes. La mobilisation de la médecine de ville est précieuse à plus d’un titre. Eux seuls sont en mesure de traiter en même temps les pathologies somatiques. Comment tirer profit de l’expérience qu’ils ont acquise en prescrivant de la buprénorphine ?
Plutôt que d’élargir le cadre de prescription de la méthadone, Simone Veil se décide à expérimenter un nouveau médicament, le Subutex. En 1995, ce nouveau médicament obtient son autorisation de mise sur le marché. Il peut être prescrit par n’importe quel médecin et le cadre est particulièrement libéral. L’usager dépendant est devenu un patient comme les autres. En moins de trois ans, on comptabilise près de 90 000 patients. La France est devenue le pays le plus prescripteur en Europe. C’est aussi celui où les résultats de cette nouvelle politique ont été les plus tangibles
11
Ch. 17, « Genèse d’un médicament » et Ch. 18 « Médecins ou dealers en blouse blanche » p237-262. In : Peut-on civiliser les drogues, de la guerre à la drogue à la réduction des risques. COPPEL A. La Découverte, Prologue 2002.
.
Obstacles au développement de la réduction des risques
Éthique du soin aux valeurs universelles
Dans la plupart des pays, la politique de réduction des risques s’oppose aux partisans de la répression, mais un apparent consensus réunit ceux qui traditionnellement s’opposent à la répression des usagers de drogues et ceux qui la réclament. Cet étrange consensus invoque des valeurs consensuelles : la lutte contre le sida ne doit pas tomber dans le piège du communautarisme. Le sida « concerne tout le monde » affirme la première campagne de prévention du sida. Il n’en reste pas moins qu’une information généraliste ne suffit pas ; certains − pour ne pas dire de « groupe à risque », formulation considérée comme stigmatisante − étant plus exposés que d’autres. Pour le milieu homosexuel, inconnu des services sanitaires et sociaux, le développement de nouvelles associations est indispensable, mais pour les toxicomanes, la prise en charge par les soignants est à l’évidence la plus légitime. L’éthique du soin se réclame de valeurs universelles : « Libertés, droits de l’Homme et démocratie ». Les intervenants en toxicomanie dénoncent l’enfermement des toxicomanes, les traitements soi-disant médicaux qui répondent à une fonction de normalisation sociale et enfin le risque de ghettoïsation avec les mesures spécifiques.
Santé publique « outil de contrôle social »
« Le toxicomane n’est pas un malade », « la toxicomanie n’est pas un problème de santé publique » répétaient à l’envi les spécialistes. Voilà des assertions pour le moins paradoxales pour des soignants. Pour les comprendre, il faut revenir aux origines du dispositif de soin créé par la loi de 1970. Ces années-là, l’usage de drogue est considéré comme une forme de contestation. La menace qui pèse sur la santé publique est agitée pour justifier la sévérité de la loi, mais les débats parlementaires ne laissent aucun doute : l’objectif premier est de restaurer l’autorité de l’État
12
Sur la loi de 1970, voir : BERNAT de CELIS J. Drogue : consommation interdite. L’Harmattan, 1996. Voir aussi : EHRENBERG A. L’Individu incertain, Calmann-Lévy, 1995 : 102-106.
. C’est là un enjeu politique que les experts médicaux se gardent de discuter, mais ils s’inquiètent des conséquences néfastes de la pénalisation de l’usage. La prison n’est pas la bonne réponse pour ces jeunes en pleine crise d’adolescence. L’injonction thérapeutique, alternative à l’incarcération, est négociée entre justice et santé. Elle offre une porte de sortie à ceux qui, acceptant de se considérer comme des malades, renoncent à consommer des drogues, mais elle pose un redoutable problème au médecin : ces usagers relèvent-ils d’un traitement ?
La hantise du Dr Olievenstein, chef de file de l’école française, c’est l’imposition de traitements médicaux à des gens qui ne sont pas des malades. Les traitements de l’homosexualité ou de la masturbation ou pire encore les traitements psychiatriques imposés aux opposants politiques servent de repoussoir. Le Centre Marmottan a beau être le premier dispositif de soin prévu par la loi, il ne répond pas aux impératifs de la loi : le centre accueillera les toxicomanes qui demandent de l’aide et seulement ceux-là.
Le système de soin est le produit d’une contradiction non résolue entre médecine et justice. Aujourd’hui, avec l’addictologie, la médecine a développé ses propres concepts qui opposent l’usage à la dépendance, qui seule relève du traitement médical, mais en 1970, le terme « toxicomanie », laisse penser que médecine et justice ont la même définition de la toxicomanie. Ce n’est pas le cas, mais faute d’avoir pu se faire entendre, les experts médicaux se contentent de délimiter leur territoire.
Système construit pour se protéger des menaces extérieures
La médecine ne doit pas être au service de la justice ou se soumettre à la demande sociale ; elle ne doit obéir qu’à elle-même. Aussi le système de soin a-t-il été construit comme une véritable citadelle qui doit résister aux différentes formes de pression qui pèsent aussi bien sur le toxicomane que sur ses soignants :
• contre les contrôles judiciaires : avec l’anonymat, exigé par les experts du ministère de la Santé, la justice n’a pas les moyens de contrôler ni l’effectivité du traitement ni ses résultats ;
• contre la médicalisation de la toxicomanie : que l’usage de drogues soit considéré comme une déviance ou comme le symptôme d’une souffrance psychique, le traitement médical n’a pas de justification. On ne guérit pas de la toxicomanie par une cure et encore moins par la prescription de drogues comme la méthadone ;
• contre les traitements coercitifs : le soin ne doit pas avoir pour objectif la normalisation des comportements ; il doit faire appel à la liberté de choix ;
• contre la demande sociale : la famille, l’environnement, l’opinion publique, tous réclament des cures, qu’ils imaginent urgentes. Le médecin ne doit prendre en compte que la demande du patient. « Il n’y a pas d’urgence en toxicomanie », affirment-ils ;
• contre la demande sécuritaire : les élus locaux peuvent être tentés d’adopter des mesures purement répressives. Aussi le système de soin est-il mis sous la protection de l’État.
En acceptant d’ouvrir le Centre Marmottan, le Dr Olievenstein se veut le garant de la liberté du toxicomane ; il veille personnellement à ce qu’aucun traitement qui ne respecte pas la liberté du sujet ne puisse se développer. Sont ainsi boutées hors de France, toutes les thérapies qui veulent « normaliser les comportements », que ce soit au nom de la science en référence à la biologie ou au comportementalisme ou bien au nom de la morale et de la religion comme les communautés thérapeutiques. Le système de soins a beau se prétendre « diversifié », l’offre de soin est essentiellement psychologique en référence plus ou moins revendiquée à la psychanalyse
13
BERGERON H. L’État et la toxicomanie. PUF, 1999.
.
Jusqu’au milieu des années 1980, cette analyse fait consensus aussi bien dans la classe politique que dans l’élite intellectuelle. Quant au corps médical, il se garde de toute intrusion dans ce champ spécialisé. Les toxicomanes ont mauvaise réputation, les médecins se contentent d’orienter ces patients difficiles dans les centres spécialisés. Ils le font d’autant plus volontiers que ces intervenants prennent à cœur leur travail, dans le respect de l’éthique médicale. Tout au plus, ces derniers sont-ils suspects d’une trop grande proximité avec leurs patients.
Remise en cause des institutions
Si le système de soin a été mis en place pour garantir la protection des toxicomanes, c’est bientôt le système lui-même qui doit se protéger.
Il se protège d’abord contre ses propres patients. Les héroïnomanes des années 1980, plus violents et moins fascinants que la génération contre-culturelle, n’ont, semble-t-il, rien d’autre à dire que la souffrance du manque. Le fossé se creuse entre des usagers de plus en plus dépendants et une offre de soins de plus en plus psychologique. Des règlements intérieurs sont institués : les usagers doivent démontrer leur motivation, ceux qui rechutent sont systématiquement exclus. Le soin est réservé aux plus méritants.
Le dispositif de soin se protège surtout contre la montée de la demande sécuritaire. Tandis que la consommation d’héroïne se diffuse dans les quartiers populaires, le sentiment d’insécurité ne cesse de progresser. À l’exception de l’extrême-droite, la classe politique fait front ; elle résiste d’abord par le silence, mais en 1986, pour la première fois, le système de soin est officiellement remis en cause : la toxicomanie étant définie par la perte de la volonté, il serait absurde d’exiger une demande volontaire. De gré ou de force, les toxicomanes doivent être punis ou soignés. C’est d’ailleurs ce que prévoit la loi de 1979 que le ministre de la Justice, Alain Chalandon, entreprend d’appliquer à la lettre. Des services psychiatriques fermés doivent prendre la relève d’un système de soin défaillant. Cette tentative de réforme échoue, mais le système de soin se referme sur lui-même, il interdit toute critique. Désormais, les ennemis du système de soin sont les ennemis de la liberté.
Contre l’amalgame « toxicomanie-sida »
En 1986, les spécialistes ont résisté à la demande sociale de traitements obligatoires, mais les années suivantes, ils s’efforcent de reconstruire le consensus qui a protégé le système de soin. Ce consensus se construit sur le refus de l’amalgame « toxicomanie-sida »
14
COPPEL A. Les intervenants en toxicomanie, le sida et la réduction des risques en France. Vivre avec les drogues. Le Seuil, Communications n°166, 1996.
. En affirmant que « La lutte contre le sida ne doit pas servir de prétexte à l’abandon de la lutte contre la toxicomanie », les spécialistes rassurent tous ceux qui sont convaincus que la répression de l’usage est la seule prévention efficace. 1986, c’est l’année où la Grande-Bretagne adopte cette nouvelle politique de santé qui prône la distribution de seringue et la prescription de méthadone. Toutes ces mesures sont interprétées à l’aune du débat français construit sur l’opposition « laxisme ou répression ». Pour les Français, nos voisins ont cédé à la panique. Face à la menace du sida, ils ont « baissé les bras ». Le compromis entre positions libérales et positions répressives se construit sur le
statu quo. Le système de soin français serait « le meilleur au monde », argumentent les intervenants en toxicomanie, précisément parce qu’il a su préserver la liberté du toxicomane sans renoncer à la lutte contre la toxicomanie. C’est ce que s’efforce de démontrer le rapport Trautmann, deuxième rapport officiel sur la lutte contre la drogue et la toxicomanie, publié en 1989. Trois pages sont consacrées au sida : la lutte contre le sida et la lutte contre la toxicomanie relèvent de services soigneusement cloisonnés. La DGS-sida et la DGS-toxicomanie ont chacune leurs missions propres. La lutte contre le sida ne doit pas être menée aux dépens de l’éthique du soin : il faut résister à la tentation de « la médicalisation de la toxicomanie », qui, pour le système de soin, reste le danger principal – puisque « la toxicomanie n’est pas une maladie ».
Contre la dramatisation, le refus de l’évaluation
Dans le domaine de la toxicomanie, ni les spécialistes en toxicomanie ni les médecins chargés de mission de santé publique ne prennent au sérieux la menace qui pèse sur la santé publique. En 1978, le rapport Pelletier, premier rapport officiel sur la loi de 1970, avait abouti à la conclusion qu’il n’y avait pas véritablement de problème de santé publique, du moins, avait précisé Monique Pelletier, « tant qu’il n’y aurait pas au moins 100 000 grands toxicomanes ». La progression de la consommation d’héroïne reste invisible dans les rares enquêtes quantitatives menées par l’Inserm. Ces résultats sont utilisés pour répondre au sentiment d’insécurité mais en 1986, le ministre de la Justice, Alain Chalandon, rompt le consensus de la classe politique : il y aurait au moins 500 000 toxicomanes, affirme-t-il, refusant, conformément à la loi, de distinguer cannabis et héroïne. Faire peur ou rassurer, telle semble être l’unique fonction des recherches que personne ne prend véritablement au sérieux, comme le démontre un rapport publié en 1992. L’évaluation répond à une demande de contrôle qui provoque des résistances d’autant plus vives que l’expertise fait défaut. Quels sont les résultats des traitements ? Dans les pays anglo-saxons, des études ont été menées, mais les spécialistes français ne veulent pas en entendre parler : évaluer le traitement suppose qu’il y a maladie. Il faudrait d’abord lever les ambiguïtés sur lesquelles repose le système de soin. Il faudrait aussi reconnaître les résultats catastrophiques des cures de sevrage : plus de 80 % de rechute selon les études anglo-saxonnes. Voilà qui risque de condamner à une maladie mortelle des usagers qui, même s’ils le veulent, ne parviennent pas à « sortir de la toxicomanie ». Les spécialistes affirment : « Nous avons une obligation de moyens, pas de résultats ». À défaut de convaincre, certains n’hésitent pas avancer les chiffres les plus fantaisistes, persuadés qu’on peut faire dire tout ce qu’on veut aux chiffres, des « foutaises bureaucratiques » selon le Dr Olievenstein.
Leviers du changement
Croyances collectives et réalités de terrain : une confrontation difficile
Si la réduction des risques a eu tant de mal à se développer, c’est que les premiers acteurs ont dû se confronter à leurs propres croyances. Toutes les premières initiatives commencent par solliciter le Dr Olievenstein : Aides dès 1986, Médecins du Monde l’année suivante, et c’est également le cas de nombre de petits projets. L’exclusion des soins est un des premiers constats de terrain qui va contribuer à ébranler certaines certitudes, sans pour autant que les acteurs soient en mesure de remettre en cause la logique d’ensemble. Il faut comprendre les logiques d’exclusion et déconstruire l’argumentaire qui le justifie : « Il n’y a pas d’urgence en toxicomanie », « il faut apprendre à dire non, il ne faut pas se laisser manipuler », « Il faut entendre la souffrance et non pas l’écraser avec une camisole chimique », « Il ne faut se focaliser sur les produits », « Il ne faut pas enfermer les toxicomanes dans leur toxicomanie ». Tel acteur a pu constater qu’il y a bien des usagers en situation d’urgence, mais il n’y a aucun outil pour évaluer l’ampleur des problèmes. La mort est un puissant tabou qui conjugue le déni, la culpabilité ou le jugement moral et enfin la crainte d’alimenter la demande sécuritaire, la pudeur. Sans Act-Up, nous n’aurions jamais osé écrire « Des toxicomanes meurent tous les jours. Ces morts peuvent être évités »
15
Appel pour « Limiter la casse », Octobre 1993.
.
Alliance avec les usagers de drogues
L’alliance entre les usagers de drogues est le premier levier du changement. Elle se construit sur le terrain. Pour constater l’exclusion des soins, il faut accepter de recevoir ces patients difficiles, que ce soit dans l’accueil des précaires de MDM ou dans les cabinets de médecine générale. Tous s’affrontent à un consensus qui encourage le refus de soin : « Il faut savoir dire non ! », répète la presse médicale alors même qu’elle traite de la prise en charge des patients VIH en médecine de ville. Si la lutte contre le sida bouleverse ce système de représentation, c’est qu’elle rappelle que le soin est toujours fondé sur une alliance entre le médecin et son patient. C’est dans le cadre de cette alliance que vont s’expérimenter les premières prescriptions médicales de substitut.
Au-delà des relations patient-médecin, la lutte contre le sida est à l’origine d’un changement de représentations plus radical : parce qu’elle fait appel à la responsabilité individuelle, la prévention du sida fait de chacun l’acteur de la protection de sa santé, l’usager de drogue au même titre que n’importe qui. C’est là une évidence : seul l’usager peut décider s’il utilise ou non une seringue stérile, s’il met ou non un préservatif mais dans le domaine de la toxicomanie, les messages de prévention ont toujours fait appel à la peur et à la menace de sanction plutôt qu’à la responsabilité. Au contraire, la lutte contre le sida a développé tous les outils qui peuvent contribuer à l’appropriation des comportements de prévention. Premier de ces outils, les associations dites d’auto-support (aide par les pairs ou peer support, self help) qui regroupent des usagers qui n’ont pas renoncé à la consommation de drogues. Ces associations se développent rapidement. En 1994, Asud recense 14 associations. Toutes sont subventionnées, et pourtant le dispositif officiel de la réduction des risques se garde bien de les revendiquer : le dispositif d’urgence se réclame de l’autorité médicale et non de la responsabilité des toxicomanes.
À défaut d’une auto-organisation spontanée, que la marginalisation sociale et la répression rendent difficiles, d’autres modalités sont expérimentées dans le cadre d’équipes qui associent militants associatifs ou professionnels et usagers de drogues. Ces équipes de rue ou de proximité se donnent pour mission d’entrer en relation avec des usagers hors du cadre institutionnel
16
COPPEL A. L’outreach, l’art difficile de toucher les exclus. Peddro, numéro spécial, UNESCO et ONU-Sida, décembre 2001 : 98-99.
. L’alliance est nécessaire pour pénétrer un milieu fermé sur lui-même. Lorsque ces liens auront été noués, le contact s’avéra aisé et les difficultés initiales seront oubliées mais il aura fallu passer au crible toutes les croyances collectives : on pensait que le toxicomane, « maniaque du toxique », devait nécessairement être suicidaire ou souffrir d’une pathologie mentale. Acteur de sa santé, il devient « un usager de drogue », qui se veut citoyen comme les autres. Le changement d’identité s’accompagne d’un changement de comportement des héroïnomanes mais plus encore d’une nouvelle génération d’usagers de drogue qui revendique un usage festif, en rupture avec l’usage « toxicomaniaque »
17
Ch. 22, Usagers de drogue ou patients ? p297-310. In : Peut-on civiliser les drogues, de la guerre à la drogue à la réduction des risques. COPPEL A. La Découverte, Prologue 2002.
.
Élaboration et diffusion de nouveaux savoirs et savoir-faire
Les nouveaux savoir-faire s’élaborent dans la confrontation des expériences personnelles et professionnelles. La connaissance des usages de drogues est directement issue des expériences personnelles que les usagers apprennent à confronter entre eux. L’évaluation des risques exige la confrontation des pratiques de l’usage avec des savoirs scientifiques sur les types de risques selon les usages et les produits. Chercheurs, praticiens et usagers de drogues doivent confronter expériences et connaissances. Des liens se tissent entre des militants associatifs et le milieu médical, avec l’accompagnement des malades ou le soutien des familles. Autre bouleversement, les professionnels socio-sanitaires sont également conduits à confronter les pratiques propres à chaque spécialité. Médecins hospitaliers, médecins de ville et pharmaciens vont apprendre à collaborer. Ces nouveaux savoirs et savoir-faire se diffusent dans les réseaux qui contribuent à les enrichir.
Résultats tangibles
Les réseaux se développent rapidement parce que les acteurs qui s’y impliquent constatent par eux-mêmes que les actions sont à la fois faisables et utiles. En traitement de substitution, les usagers d’héroïne se stabilisent, leur comportement se modifie, les relations changent. Aucun des premiers acteurs n’imaginait obtenir la baisse de la mortalité que démontre l’évaluation nationale dès 1999, mais l’amélioration de la santé est immédiate. C’est aussi ce que constatent les intervenants en toxicomanie au fur et à mesure qu’ils acceptent de prescrire ces traitements. L’amélioration de leurs relations avec leurs patients est le premier de ces constats : les usagers sous traitement ne sont pas devenus des esclaves, ils ont beaucoup de choses à dire, et les spécialistes beaucoup à apprendre.
Mobilisation collective
L’évaluation a porté sur les outils de la réduction des risques, mais elle n’a pas pris en compte la mobilisation des acteurs. Or, ces résultats tangibles sont le résultat d’une mobilisation collective. La mobilisation des usagers des drogues a déterminé la baisse spectaculaire des nouveaux cas de sida. Des études internationales ont démontré que les changements de comportements se diffusent d’usager à usager. L’expérience française montre que le soutien de l’environnement proche peut y contribuer. La baisse de la mortalité atteste de la mobilisation des acteurs de santé et cette mobilisation est elle aussi interactionnelle. Avec des accompagnements individualisés, médecins généralistes et militants associatifs ont ouvert les portes de l’hôpital. Les résultats des traitements de substitution sont eux aussi dus à cette mobilisation collective
18
COPPEL A. Dans quel contexte historique et institutionnel ont été mis en place les traitements de substitution en France et comment notre pays se situe-t-il par rapport aux pays comparables ? Conférence de consensus sur les traitements de substitution, Alcoologie, addictologie, décembre 2004, Tome 26 supplément au n°4, p17-26.
. Si nos partenaires étrangers se sont montrés sceptiques devant nos résultats, c’est que la prescription de buprénorphine avait donné des résultats catastrophiques, par exemple en Écosse. Le traitement par le Subutex n’aurait pu obtenir de tels résultats, sans la diffusion des bonnes pratiques médicales dans les réseaux. Dans les premiers temps, les réunions, les formations, les échanges d’information de personne à personne se multiplient. Il ne faut pas oublier non plus le soutien du laboratoire, que ce nouveau médicament a d’abord inquiété, en termes de soutien individuel aux médecins, d’outils de formation, de recherches et de participation aux conférences internationales. Les médias vont rendre compte de cette mobilisation inattendue, contribuant à conforter cette mobilisation collective. Le rôle de l’État enfin devient rapidement déterminant. Les pratiques de réduction des risques s’inscrivent désormais dans un dispositif expérimental tandis que méthadone et Subutex obtiennent leur AMM en 1995. La réduction des risques est bien devenue une politique publique, même si cette politique reste curieusement quasi-clandestine
19
COPPEL A. Politiques des drogues : peut-on changer de politique sans le dire ? Cosmopolitiques, République cherche démocratie et plus si affinités, Editions de l’Aube, n°3, 2003, p53-68.
.
Appropriation de l’information internationale
L’information se diffuse au fur et à mesure que nous la sollicitons. Je connaissais les travaux de recherche en sciences sociales. Entre 1991 et 1992, je découvre son développement sur les prises de risques. Je découvre aussi que les évaluations internationales ont tranché le débat sur les résultats des traitements méthadone : les bonnes pratiques donnent de bons résultats
20
COPPEL A. L’efficacité des programmes méthadone mesurée par l’évaluation des expériences étrangères. Journal du sida, n°46, janvier 1993.
. Ces recherches vont nourrir le débat, mais peu de Français lisent l’Anglais et ces articles n’ont jamais été traduits. De plus, au-delà du champ des drogues, l’appropriation de l’information internationale implique l’appropriation d’une culture de santé publique, elle implique aussi une autre conception des relations sociales qui repose sur la reconnaissance des groupes en présence. Cette nouvelle conception de la citoyenneté s’introduit en France par le biais du militantisme. Dès sa création, Act-Up avait rompu le silence de bon aloi que les associations de lutte contre le sida s’imposaient : les homosexuels revendiquent haut et fort leur identité. Indirectement, ils ont contribué à la mobilisation des usagers de drogues, qui n’ont plus honte de s’affirmer pour ce qu’ils sont.
Entre 1992 et 1993, nous participons à de nombreuses conférences internationales et à partir de janvier 1993, nous commençons à solliciter les experts que nous avons identifiés dans des rencontres et conférences internationales. Dans le champ du soin, les experts suisses et belges ont joué un rôle déterminant de médiateur parce qu’eux-mêmes se sont affrontés à l’idéologie française
21
MINO A, ARSEVER S. J’accuse les mensonges qui tuent les drogués ? Calmann-Lévy, 1996.
. Dans les médias, les journalistes se mobilisent à leur tour. En janvier 1993, Le Monde inaugure une série de reportages sur les politiques de drogues en Europe. D’autres enquêtes vont suivre : le tabou imposait le silence, cette fois le débat public s’ouvre largement.
Nouvelle culture de santé publique
Le déficit de santé publique n’était pas limité au domaine de la toxicomanie, il est général en France
22
MORELLE A. La Défaite de la santé publique. Flammarion, 1996.
. Le sida fait émerger ce nouveau domaine d’expertise. Dans l’opinion, il contribue à une sensibilisation nouvelle des menaces qui pèsent sur la santé. Cette nouvelle culture de santé publique va bouleverser la conception de la lutte contre la toxicomanie et la drogue. Il faut tout revoir, redéfinir les concepts, évaluer la réalité des risques selon les usages et les produits. En 2000, la Mildt en prend acte et met en place un dispositif de recherche, comprenant l’ensemble des outils. Il s’agit d’améliorer les statistiques issues des services, de mener régulièrement les enquêtes quantitatives qui sont au reste exigées par l’Europe. De plus, un nouveau dispositif est créé : le dispositif Trend. On sait désormais que les nouvelles tendances en matière de consommation échappent aux enquêtes quantitatives. En liaison avec les équipes qui interviennent sur le terrain, le dispositif est chargé de recueillir une information qualitative qui permette d’éviter que la catastrophe sanitaire des années 1980 se répète.
Institutionnalisation du dispositif de réduction des risques
Contexte de l’institutionnalisation
En 2003, la décision de l’institutionnalisation du dispositif de réduction des risques est prise dans un contexte de remise en cause du dispositif. En décembre 2002, une commission d’enquête du Sénat s’était proposée « d’y voir plus clair dans la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre les drogues illicites et surtout de relever ses carences »
23
Drogue, L’autre cancer. Les rapports du Sénat, Olin N. Présidente et Plasait B. Rapporteur, commission d’enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites, n°321, 2002-2003.
. La politique de réduction des risques a ceci de particulier qu’elle n’a jamais été discutée par les parlementaires. Les débats qu’elle a suscités sont restés en grande part limités au milieu professionnel. Si la distribution de seringues, justifiée par la menace du sida, a été acceptée par l’opinion, la plupart des outils de la réduction des risques vont à l’encontre des croyances collectives, ils vont aussi à l’encontre du dispositif de lutte contre la drogue puisqu’ils impliquent que l’usage de drogues soit reconnu comme un fait, autrement dit toléré.
Lorsque Simone Veil donne au dispositif un statut expérimental, elle est persuadée que son officialisation exigerait le changement de la loi de 1970. Compte tenu de ses résultats, la réduction des risques est officiellement intégrée au dispositif de lutte contre les toxicomanies en 1999. Cette logique de santé publique conduit à intégrer également l’alcool et le tabac au dispositif de lutte contre les toxicomanies, mais le gouvernement refuse le débat parlementaire sur le cadre législatif. En 2003, les sénateurs s’attachent à résoudre la contradiction : si le dispositif est justifié, il doit acquérir un statut légal. Rapidement, les rapporteurs découvrent qu’aucun expert ne conteste les résultats de cette politique, comme la baisse de 80 % des overdoses mortelles
24
. Ils découvrent également qu’il n’y a plus de spécialistes qui s’opposent publiquement aux traitements de substitution. Les experts médicaux sont unanimes pour défendre cette politique de santé. Les critiques n’en sont pas moins nombreuses : des médicaments sont détournés de leur usage, injectés ou revendus sur le marché noir. Les actions menées en milieu festif sont particulièrement remises en cause : les brochures d’information sur le sniff à moindre risque, sur les mélanges ou pire le
testing qui permet de savoir si le produit est effectivement de l’ecstasy (ou MDMA), tous ces outils sont suspects d’incitation à l’usage de drogue. En prenant acte du dispositif, la loi de santé publique de 2004 lui assigne des objectifs purement sanitaires : baisse des overdoses mortelles, lutte contre les maladies infectieuses, prise en compte des conséquences sociales. L’institutionnalisation doit « donner un cadre aux pratiques à travers un référentiel national », ce qui doit permettre d’éviter des dérives qu’avait dénoncées avec véhémence le rapport « La Drogue, L’autre cancer »
25
Circulaire N°DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C/2006/01 du 2 janvier 2006 relative à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) et à leur financement par l’Assurance maladie.
.
Normalisation souhaitable
Intégré dans le champ des établissements médico-sociaux, le dispositif de réduction des risques perd son caractère d’exception qui contribue indirectement à l’exclusion des usagers de drogue des services de droit commun. L’usager de drogue devient un patient comme les autres, ce qu’ont demandé tous les acteurs de la réduction des risques.
L’institutionnalisation du dispositif en permet la survie. Issu de la mobilisation de la lutte contre le sida, le dispositif est fragilisé par la démobilisation de militants associatifs bénévoles, à l’origine de nombreuses initiatives. Les militants associatifs ont obtenu que la réduction des risques devienne une politique, ceux qui refusent de devenir de nouveaux spécialistes considèrent que désormais, il appartient aux services publics de prendre la relève. Avec l’institutionnalisation, le dispositif de réduction des risques répond désormais à des missions de service public. Il échappe ainsi à l’emprise de politiques qui pourraient être tentés par des mesures démagogiques. L’institutionnalisation offre au dispositif les garanties qui sont celles de tous les services sanitaires et sociaux : les missions sont définies, les règles de fonctionnements sont explicites, le contrôle administratif peut s’exercer. Pour les acteurs de terrain, l’institutionnalisation offre l’avantage de garantir la pérennité des financements, dont ont souffert en particulier toutes les petites associations. Une première question reste en suspens : les moyens attribués au dispositif sont-ils à la mesure des objectifs qui lui sont assignés ? En 2004, l’État s’était engagé à maintenir son engagement antérieur, mais il n’est pas question de relayer le bénévolat qui avait fait la remarquable efficacité du dispositif. Les actions les moins professionnalisées, qui s’étaient fragilisées au cours des deux ou trois dernières années, se retrouvent de fait exclues du dispositif institutionnel.
Entrer en relation avec des usagers hors institution : une mission négligée
Les actions de réduction des risques ont pour objectif premier de donner aux usagers qui ne sont pas en relation avec les institutions les moyens de mieux protéger leur santé, puisque ce sont précisément ceux qui sont exposés au risque de contamination par le VIH. Voilà qui n’est pas pris en compte dans la définition institutionnelle du dispositif.
Le dispositif institutionnel s’inscrit dans des centres d’accueil et d’accompagnement des usagers de drogues (Caarud). La normalisation administrative se fait sur le modèle des centres d’accueils. Quant aux actions menées sur le terrain hors institution, elles relèvent de « l’accompagnement ». De quoi s’agit-il exactement ? Le terme est suffisamment général pour intégrer toutes les pratiques de terrain, mais quand la logique institutionnelle l’emporte, l’action de terrain tend à se limiter à l’accompagnement des usagers vers les services. L’objectif n’est pas seulement l’institutionnalisation des services, c’est aussi celle des usagers qui, grâce à l’accompagnement, doivent accéder aux services
26
COPPEL A. De l’usager de drogue à l’usager des services socio-sanitaires, l’action de proximité face aux logiques de services. Sciences sociales et santé, Mars 2005, Vol 23 n°1, revue trimestrielle, pp. 69-77.
.
Logiques institutionnelles et santé communautaire
Les actions de réduction des risques relèvent d’une démarche de santé communautaire qui associe les personnes concernées à la protection de leur santé. La définition des « personnes concernées » varie en fonction des projets ; au-delà de l’usage, elle peut inclure l’environnement, défini par l’appartenance à une même culture ou à un même territoire. Les projets sont différents selon les modalités d’association :
• les associations d’auto-support (aide par les pairs, peer-support) regroupent des acteurs qui ont une expérience de l’usage de drogue. Des professionnels peuvent être recrutés sur des compétences techniques particulières, mais les usagers ont la responsabilité de l’organisation ;
• quelques projets associent professionnels socio-sanitaires et « personnes concernées » ;
• selon des modalités formalisées qui doivent garantir une participation égale dans le choix des orientations, l’organisation et la mise en œuvre de l’action et enfin dans l’évaluation des résultats. Certains projets associent professionnels et bénévoles tandis que d’autres constituent des équipes salariées mixtes
27
Sur la démarche de santé communautaire associant à parité professionnels diplômés et acteurs issus du terrain dans la prostitution, voir : Prostitution et santé communautaire, Essai critique sur la parité. WELZER D, SCHUTZ SAMSON M. 1999, Cabiria, Lyon, Le Drong Lune Edition.
;
• le plus souvent, les équipes de réduction des risques sont constituées essentiellement de professionnels socio-sanitaires tout en intégrant individuellement des acteurs qui ont l’expérience de l’usage de drogues. Ces acteurs peuvent être recrutés à plusieurs titres, par exemple « accueillant », « animateur », « médiateur de santé », « adultes relais »... Ils peuvent être recrutés ponctuellement sur des actions précises.
La démarche relève plus ou moins de la santé communautaire selon le statut donné aux compétences issues de l’expérience ou savoir profane, soit essentiellement les connaissances suivantes :
• connaissance des populations d’usagers de drogues, du contexte de l’usage, des groupes en présence et au-delà de l’usage, du milieu d’appartenance ;
• connaissance des pratiques d’usage et des prises de risques ;
• savoir-faire relationnel, savoir entrer en relation, savoir soutenir les changements de comportement ;
• savoir-faire de médiation et de négociation ; savoir-faire de mobilisation et de participation.
Dans les services, ces savoirs et savoir-faire peuvent être appréciés, mais il s’agit de qualités personnelles qui ne correspondent à aucune qualification. Quelle que soit la bonne volonté des acteurs, ces nouvelles compétences se heurtent aux logiques institutionnelles :
• les professionnels doivent être diplômés : les professionnels sont recrutés sur la base de leur statut et au mieux de leurs motivations ; les acteurs en mesure de nouer des alliances hors institution ne sont recrutés qu’à la marge, avec des statuts précaires ;
• les accueils doivent répondre à des normes administratives précises : la logique institutionnelle impose d’entrée de jeu des moyens suffisants, ce qui limite l’émergence de nouvelles modalités d’accueils expérimentées dans les différents contextes de vie ;
• l’institution doit programmer ses actions : l’adaptation de l’offre de service au fur et à mesure de l’évolution des besoins n’est pas prévue. L’expérimentation n’est pas intégrée aux pratiques quotidiennes, elle exige l’élaboration de projets spécifiques. Or, c’est souvent à partir de pratiques expérimentées au quotidien que s’élaborent de nouvelles stratégies d’intervention ;
• le contrôle des procédures fait office d’évaluation : il ne permet pas de savoir si le service est adapté aux besoins actuels. Faute d’une prise en compte du contexte de l’offre de service, les résultats ne sont pas connus, les effets et les impacts ne sont pas pris en compte.
Fonctionnement institutionnel et réductions budgétaires
De façon paradoxale, le dispositif de réduction des risques a été institutionnalisé sur un modèle dont les dysfonctionnements sont connus : les institutions sont fermées sur elles-mêmes, les services offerts sont inadaptés à l’évolution des besoins. Les normes de standardisation ne prennent pas en compte la diversité des besoins, elles contribuent à l’exclusion de tous les groupes dont les besoins sont spécifiques. Ces dysfonctionnements ont bien été identifiés en particulier dans la sociologie des organisations, mais ces nombreux travaux n’ont pas abouti à un changement profond des modes de fonctionnement des services. Faute de parvenir à les réformer, les pouvoirs publics se contentent de réduire progressivement leurs budgets.
Les conséquences de ces réductions budgétaires sont nombreuses :
• définis à minima sur la base des normes administratives, ces budgets limitent la qualité de l’offre de service. Ainsi, dans les accueils, les professionnels ont rarement les moyens d’accompagner individuellement les usagers hors institution. Aussi, les relations à l’usager sont-elles moins satisfaisantes. La motivation des professionnels en souffre ;
• mis en demeure de justifier leurs budgets, les services ont tendance à dissimuler leurs difficultés ;
• le contrôle administratif porte sur des données quantitatives telles que le nombre de clients et le nombre d’actes ; les services vont privilégier le plus grand nombre au détriment de groupes minoritaires. La chronicisation de la population est un des effets de cette contrainte : il est plus facile de recevoir ceux que l’on connaît déjà ;
• une des fonctions des services de première ligne est d’identifier les obstacles des usagers hors institution dans l’accès aux services de droit commun. Dans un contexte de remise en cause des services, identifier les fonctionnements et les pratiques inadéquates est nécessairement mal vécu par des services en question et ne favorise pas le partenariat.
Limites du dispositif actuel
Les usagers ont tendance à s’installer dans une maladie de longue durée sans espoir damélioration : la moyenne d’âge est élevée ; faute de nouveaux recrutements, les files actives sont stables, voire ont tendance à diminuer. Près de 60 % des usagers sont en traitement de substitution ; autrement dit, il s’agit d’usagers déjà pris en charge.
Les usagers relèvent très souvent de la grande exclusion, mais il n’est pas prévu de réponses spécifiques aux différents problèmes pourtant bien identifiés : précarité de l’hébergement ; importance des troubles psychiatriques ; situation au regard de la justice (casiers judiciaires, sortants de prison) ; état de santé précaire dont particulièrement la fatigue (hépatites) ; ressources liées à des pratiques déviantes ou délinquantes (emploi au noir, prostitution, recel, revente de drogues et de médicaments...) ; isolement, qui peut être lié aux situations familiales, au genre, à l’appartenance à des groupes minoritaires, à une maîtrise insuffisante du Français...
L’articulation avec les services de droit commun est prônée, mais elle n’est pas dotée de moyens spécifiques.
Nombre de territoires sont inexplorés : c’est le cas des périphéries des zones urbaines et jusqu’aux campagnes où il n’y a pas de Caarud. Même lorsqu’ils existent, les Caarud n’ont pas toujours les moyens de pénétrer dans certains milieux ou certains sites. En banlieue parisienne, par exemple, nombre de cités restent impénétrables, y compris des équipes les mieux implantées. La diversification de milieux où les produits psychotropes sont consommés exigerait des dispositifs spécifiques, avec à chaque fois une offre de service qui corresponde à une demande.
Les jeunes générations échappent en grande part au dispositif : on a toutes les raisons de penser que l’usage de drogues, loin de se concentrer dans la grande exclusion, s’est développé dans toutes les classes sociales, des plus privilégiées aux petites classes moyennes.
Le dispositif n’est pas en mesure de remplir pleinement sa fonction d’alerte : au-delà du milieu festif techno, les nouveaux usagers ne sont connus que par des études statistiques. Les limites de ces études, bien identifiées, sont d’ailleurs à l’origine de la mise en place du dispositif Trend. Or ce dispositif dépend étroitement des données recueillies par les équipes. Au milieu des années 1990, les alliances avec le mouvement techno ont permis de recueillir des données validées par la bonne implantation des équipes. Ainsi, on a pu constater :
• la progression des consommations de stimulants dont particulièrement la cocaïne ;
• l’émergence de nouveaux injecteurs ;
• la consommation d’opiacés (dont l’héroïne) lors de la descente après la prise de stimulants.
Dans le milieu festif techno, l’injection et la consommation d’héroïne sont des phénomènes marginaux. Quant à la progression de la consommation de cocaïne, elle est très loin de se limiter à ce milieu. Qu’en est-il ailleurs ? Aujourd’hui, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer :
• les processus de diffusion et l’ampleur de ces trois phénomènes hors milieu festif techno ;
• le statut et la signification de ces usages ; le type de réseaux relationnels entre usagers et avec les autres modes d’usage ;
• les prises de risques spécifiques à ces nouveaux usages ; les produits associés, dont particulièrement l’alcool.
La connaissance des nouvelles tendances en matière d’usage se heurte aujourd’hui à des obstacles redoublés par :
• la diversification des milieux où les produits psychotropes sont consommés : s’il existe des usagers qui circulent d’un milieu festif à l’autre, d’autres témoignages attestent de petits réseaux de consommateurs beaucoup plus hermétiques ;
• la stigmatisation et la répression accrues de l’usage : avec le mouvement techno, l’usage festif a été revendiqué ; aujourd’hui, même l’usage de cannabis peut être dissimulé ;
• la rapidité des évolutions : les phases de diffusion sont connues en fonction des produits, mais la rapidité des évolutions tient en partie à l’évolution du contexte propre aux produits (offre, stigmatisation et répression, offre de service comme les traitements de substitution). Elle tient aussi au contexte général économique, social, culturel. Il y a tout lieu de penser que la crise économique actuelle va profondément modifier les modes de consommation.
Villes européennes face aux drogues : des réponses associant la prise en compte de la santé et de la sécurité
En France, la réduction des risques répond à des objectifs purement sanitaires, définis dans le cadre d’une politique nationale. Aussi, les réponses sociales telles que l’hébergement ne participent pas du dispositif ; tout au plus ces réponses sont-elles bricolées à la marge des services. Désormais les équipes sont chargées de veiller aux troubles de voisinage. C’est d’ailleurs la principale mission de la plupart des équipes de rue associées aux accueils, mais leurs moyens se limitent à la médiation. Au contraire, dans les autres pays d’Europe du Nord, les collectivités locales sont à l’origine de véritables politiques locales en matière à la fois de drogue et de toxicomanie
28
Voir COPPEL A. Usage de drogues, services de 1res lignes et politiques locales, guide pour les élus locaux. Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), Programme Démocratie, Villes & Drogues, février 2008.
. C’est ainsi que les élus locaux y ont des compétences larges aussi bien termes de prévention qu’en termes de soin ou de répression. À Berlin, comme à Rotterdam ou Londres, les élus locaux ne doivent pas appliquer une politique, ils doivent résoudre les problèmes qui se posent sur le terrain. L’insécurité est plus souvent leur première préoccupation, elle n’en a pas moins abouti à des politiques locales négociées entre les acteurs concernés, habitants et élus, services sanitaires et sociaux et services répressifs. Ainsi, les villes allemandes ou suisses ont-elles surmonté les problèmes posés par les scènes ouvertes en offrant toute la gamme des services nécessaires, dans le champ des drogues avec des équipes de rue, des salles de consommation, des programmes expérimentaux de prescriptions médicalisées d’héroïne ainsi que toute la gamme des réponses de traitement plus classiques comme les post-cures et les communautés thérapeutiques. De plus, des réponses systématiques d’hébergement ont été offertes, quelquefois associées à des réponses d’insertion par le travail.
Ces dispositifs associent les services répressifs, police et justice, avec un échange d’information entre tous les partenaires, par exemple avec l’utilisation d’un système informatique nominatif généré par les municipalités. Cet échange d’information est inacceptable en France. Il ne peut s’envisager qu’avec un changement des pratiques de tous les acteurs concernés. Signalons toutefois que ces nouvelles stratégies ne contribuent pas seulement à la paix sociale, elles peuvent aussi contribuer à améliorer la santé et l’insertion des usagers concernés. À Rotterdam, par exemple, les élus locaux se sont interrogés sur la pérennité de la scène ouverte malgré le développement de réponses. Une recherche a identifié nominativement 700 usagers particulièrement problématiques à l’origine des troubles. Ces usagers chroniques souffraient également de graves troubles psychiatriques ; les antécédents judicaires étaient presque systématiques. Aussi a-t-il été possible de faire appel aux compétences de professionnels issus de chacun des champs. Je ne connais pas les résultats obtenus dans le cadre de ce projet, qui a été initié en 2006, mais c’est un exemple d’une démarche expérimentale et négociée qui peut inspirer la politique française. Une recherche évaluative menée en Seine-Saint-Denis a déjà mis en évidence l’importance du soutien des élus locaux dans l’implantation et les résultats
29
BARRE MD, BENEC’H-LE ROUX. Approches sociologiques des acteurs de première ligne travaillant dans le cadre de la politique de réduction des risques liés à la toxicomanie. CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales). 2004, n°95.
. Sans leur implication, il est illusoire d’espérer un développement du dispositif à la mesure des besoins.
Objectifs à atteindre
En l’absence d’une hiérarchisation des objectifs
Il y a quelques priorités de santé publique qui s’imposent à l’évidence, mais au sein même de ces priorités, la hiérarchisation des objectifs à atteindre impliquerait des outils d’évaluation, qui en partie font défaut. Nous retiendrons ici les axes d’intervention suivants.
Lutte contre les hépatites
La prévention et l’accès au traitement des hépatites font partie de ces priorités indiscutables dont témoignent les quelques 4 000 décès par an. De l’information aux salles de consommation, les différents outils sont bien identifiés
30
Le plan Hépatites 2009-2012, Mais où sont les actions de terrains ? Voir le site Internet de l’AFR :
http://www.a-f-r.org.
, mais il faut rappeler que :
• l’efficacité de chacun de ces outils tient à leur inscription dans le cadre d’une mobilisation de tous les acteurs : ainsi, l’expérimentation de salles d’injection peut témoigner de l’engagement des pouvoirs publics, elle a valeur d’exemple, mais à elle seule ne peut prétendre à une réelle diminution de l’incidence ;
• en termes de prévention, il serait nécessaire de mieux connaître les contextes actuels de contamination, ce qui implique d’entrer en relation avec les jeunes exposés au risque en associant action et recherche qualitative ;
• en termes d’accès au traitement : l’accès au logement ou à un hébergement stable est un pré-requis indispensable. Pour les usagers les plus marginaux, la réponse aux besoins sociaux est souvent prioritaire.
Lutte contre la mortalité et la morbidité liées aux drogues
À l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’une évaluation précise ni de la mortalité ni de la morbidité liées aux drogues. Les médecins savent désormais diagnostiquer les pathologies liées à l’injection ou encore celles qui sont liées à la précarité mais ni les prévalences ni leur incidence ne sont connues. Il est impossible, par exemple, d’évaluer l’impact de l’abus des stimulants sur les maladies cardiaques.
Santé mentale
Dans le dispositif de réduction des risques, tous les acteurs témoignent de l’augmentation inquiétante des usagers souffrant de troubles mentaux. Sans doute, ces usagers utilisent-ils les accueils de première ligne à défaut d’une offre mieux adaptée à leurs troubles. La prison fait aussi office de refuge, mais c’est un refuge dangereux ce dont témoigne le taux de suicides. La prise en compte des troubles psychiques est une priorité nationale à laquelle le dispositif de réduction des risques pourrait contribuer.
Réduction des risques en prison
Les usagers incarcérés doivent pouvoir protéger leur santé. Mais au-delà du droit, les actions menées dans ce cadre permettent d’entrer en relation avec des usagers qui ne sont pas en relation avec les dispositifs actuels de soin et de réduction des risques. Il reste que ce qui se passe avant et après l’incarcération est sans doute tout aussi prioritaire en termes de protection de la santé. On sait en effet que :
• la clandestinité augmente la prise de risques ;
• les risques sont démultipliés à la sortie de prison.
L’impact des casiers judiciaires sur les processus d’insertion n’a pas été étudié. Ce qui a été démontré en revanche, dans des études menées aux États-Unis comme aux Pays-Bas, c’est que plus la répression est systématique, plus les usagers sont enfermés dans des carrières délinquantes, plus les comportements sont violents, sans que pour autant ni les niveaux de consommation de drogue ni le trafic soient mieux contrôlés
31
. En Europe, nous avons jusqu’à présent évité les conséquences graves de la consommation de crack, contrairement aux États-Unis, parce qu’il restait des opportunités d’insertion dont les usagers pouvaient se saisir. Qu’en sera-t-il demain, alors que la crise économique va nécessairement réduire encore ces portes de sorties ? L’efficacité de la démarche de réduction des risques tient à ce qu’elle pose les problèmes sur la table, dont le constat de la prise de risques en prison – autrement dit de la circulation de drogues – est symbolique.
Élaborer un guide de bonnes pratiques
Il s’agit là d’une priorité ; ce guide de bonnes pratiques devrait aboutir à des formations qualifiantes des équipes, que les acteurs soient ou non diplômés. Il devrait également permettre de construire des outils d’évaluation qualitative. Au niveau international, il existe déjà des guides de bonnes pratiques recommandées par l’OMS
32
WHO, UNODC, UNAIDS. Technical Guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users, 2009. La définition de la RDR donnée par l’OMS est reprise pour la première fois par le secrétariat de l’ONU et l’ONU-Sida, Lettre du 21 Août 2009.
. L’adaptation de ces guides au contexte français doit s’élaborer dans la pratique, sans se contenter des acquis actuels. Il serait inopérant de prôner une démarche de réduction des risques que nous ne pourrions mettre en œuvre.
C’est pourquoi j’ai choisi de développer deux objectifs pouvant illustrer la démarche d’expérimentation et de négociation sur laquelle est fondée la réduction des risques liés à l’usage de drogues :
• entrer en relation avec les nouvelles générations d’usagers de drogue ;
• lutter contre les processus d’exclusion.
Ces objectifs devraient participer de pratiques habituelles. Manifestement, il faut impulser une nouvelle dynamique, mobiliser de nouveaux acteurs et donc mobiliser de nouveaux moyens en s’attachant aux résultats. Les projets doivent avoir un statut expérimental. Ils doivent être associés à une recherche qualitative qui aide les acteurs à objectiver leurs pratiques et contribue ainsi à un pilotage de l’action. Les partenaires doivent être associés à cette démarche de recherche participative, et contribuer à la mobilisation des services existants.
Ces pratiques expérimentales doivent aboutir à l’élaboration de standards de bonnes pratiques, en identifiant également les moyens humains, matériels et financiers nécessaires.
Création d’équipes d’outreachexpérimentales à la rencontre des nouvelles générations d’usagers de drogues
La création d’une dizaine d’équipes expérimentales permettrait d’explorer les nouveaux modes de consommation des plus jeunes dans différents contextes (urbain, périphérie, petites villes et campagnes) ainsi qu’auprès de populations spécifiques (squatters, jeunes en errance, étudiants, migrants, gitans...). Le statut expérimental de ces projets permettrait d’associer intervenants de terrain et recherche qualitative afin d’aboutir d’une part à un diagnostic précis des nouveaux usages, des prises de risques associées et d’autre part à l’expérimentation d’outils et de messages adaptés à ces différents contextes. Ces projets contribueraient à l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs de réduction des risques liés à l’usage en associant les acteurs actuellement en lien avec ces jeunes. Ces projets expérimentaux pourraient également contribuer à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques.
Aussi convient-il :
• d’identifier les différents sites et les différentes populations à explorer dans les milieux festifs et urbains, les acteurs en relation avec ces jeunes ainsi que les associations de jeunes qui peuvent être partenaires ;
• de constituer des équipes mixtes avec différents profils, de l’expérience de l’usage aux compétences sanitaires, sociales, éducatives ;
• de donner une formation commune à tous les membres de l’équipe sur les fondamentaux de la réduction des risques ;
• d’associer à chacun des projets une recherche qualitative avec une fonction d’évaluation des prises de risques et des pratiques d’intervention.
Les équipes doivent être en mesure de :
• intervenir à la demande dans différents contextes : par exemple, lors d’hospitalisation d’urgence, dans des sites où les relations entre jeunes et adultes posent problème...
• offrir un service qui réponde à la demande des jeunes dans le domaine de l’usage de drogues : à cet égard, l’utilisation du testing dans un cadre contrôlé pourrait être expérimentée. Au-delà de l’usage de drogue, les besoins sanitaires et sociaux émergeant en cours d’expérimentation doivent être pris en compte en partenariat avec les différents services concernés ;
• élaborer au fur et à mesure un matériel de prévention et de réduction des risques adapté, en associant les publics cibles à leur élaboration.
Les équipes expérimentales doivent être en mesure de confronter régulièrement leurs résultats, par exemple dans un séminaire trimestriel. Une dizaine de projets pourraient être impulsés en même temps au niveau national.
Les projets peuvent être construits à partir des pratiques déjà en cours en donnant à des acteurs déjà mobilisés les moyens nécessaires à un diagnostic (par exemple dans le milieu des squatters, auprès de jeunes en errance...). Il serait souhaitable que les acteurs qui portent ces projets soient issus de différents champs d’intervention : dispositif de réduction des risques, clubs de prévention, associations culturelles et sportives, souffrances psychiques, suivi judicaire, précarité
33
À titre d’exemple, citons, pour la précarité le blog http://sanschezsoi.sante.gouv.fr/.
...)
Certains projets doivent être spécifiques à une population, ou encore à un contexte institutionnel, par exemple, service d’urgence hospitalière, Samu, sortants de prison ou suivis judiciaires... Des associations de jeunes doivent être associées à la démarche.
Prise en compte des processus d’exclusion
Les accueils ne doivent pas se contenter d’accueillir des usagers en grande exclusion ; ils doivent devenir un lieu d’identification des processus d’exclusion, et de mobilisation des partenaires concernés. Les différentes problématiques doivent être identifiées : usagers souffrant de troubles psychiatriques ; jeunes femmes isolées ; jeunes en errance, en particulier d’origine étrangère ; usagers non stabilisés par leur traitement de substitution ; sortants de prison.
Dans chacune des problématiques, le diagnostic doit associer les partenaires concernés : services psychiatriques, protection maternelle et infantile, aide sociale à l’enfance, ainsi que les associations intervenant sur les violences faites aux femmes ; associations culturelles ou ethniques, Csapa (centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) et médecins généralistes, administration pénitentiaire...
Dans une démarche d’expérimentation, il serait utile d’identifier les acteurs déjà mobilisés sur ces différentes problématiques, par exemple les équipes de rue expérimentées aujourd’hui en psychiatrie.
Ces projets expérimentaux doivent aboutir à de nouveaux projets qui peuvent prendre différentes formes, par exemple : doubles prises en charge ; offre de service dans le contexte de vie ; projets « passerelles » associant des acteurs issus de chaque champ concernés (par exemple, lits dans l’hébergement social, lits hospitaliers...)
Implication nécessaire des élus locaux
L’implication des collectivités locales doit être recherchée : cette implication est indispensable pour le développement d’un dispositif à la mesure des moyens.
Elle est nécessaire pour articuler le dispositif avec les différentes politiques locales, santé, insertion, sécurité.
Les problèmes liés aux troubles de voisinage doivent être pris en compte. Il ne s’agit pas seulement de rassurer l’opinion, il faut aussi que les habitants et leurs élus soient associés à la recherche de réponses. Ce sera le cas, si par exemple, certains des projets expérimentaux répondent à une demande sociale.
Anne Coppel
Présidente d’honneur de l’Association française pour la réduction des risques (AFR),
Paris
Prévention de la délinquance et réduction des risques et dommages sociaux au Canada
Poser la question de l’articulation des stratégies de prévention de la délinquance et de la réduction des dommages sociaux liés aux usages de drogues au Canada, c’est soulever une série d’enjeux infiniment complexes, à commencer par la définition de chacun des termes de la question. Quelle prévention ? Pour quelles formes de délinquance ? Quelle définition de la réduction des risques ? Ou des dommages sociaux ?
S’agissant du Canada, la question est d’autant plus complexe, comme on le verra, que les responsabilités sont réparties entre les trois ordres de gouvernement, local, provincial et fédéral, répartition qui, on s’en doute, ne se fait pas sans chevauchements ni parfois aussi contradictions.
Parler de l’articulation entre ces domaines de politique publique, c’est aussi prendre le risque de chercher une cohérence entre ces domaines, voire au sein même de chacun d’eux, cohérence qui demeure souvent un objectif davantage qu’une réalité.
Afin de mettre en contexte la discussion sur leur possible articulation, il conviendra d’abord de décrire quelques développements récents des cadres de politique et d’intervention en matière de délinquance et de drogues au Canada, précisant au passage les compétences des paliers de gouvernement et brossant un tableau des évolutions des phénomènes. La seconde partie examinera certains lieux de convergence.
Répartition des pouvoirs et responsabilités
Les acteurs du domaine des drogues et tout particulièrement de la réduction des risques auront certainement entendu parler du site d’injection supervisé Insite à Vancouver. Ouvert en 1983, ce programme accueille des consommateurs de drogues injectables qui, pour la vaste majorité, ont déjà une longue trajectoire d’utilisation d’héroïne, ont souvent un passé criminalisé ou de maladie mentale ou les deux, et ont résisté à d’autres formes de traitement. Ce programme est issu de la conjonction de divers facteurs :
• la concentration depuis au moins une vingtaine d’années de sans-abris injecteurs de drogue et de prostituées de rue, dans un quartier central de la ville de Vancouver, le Downtown EastSide ; le nombre élevé de morts par overdose en Colombie-Britannique, et tout particulièrement à Vancouver même, qui dépassait la centaine par année à la fin des années 1990 et qui avait mené à un rapport cinglant du médecin chef de santé publique de la province en 2001;
• l’élaboration en 2001, par la ville de Vancouver, d’une politique dite « des quatre piliers » constituée de l’application de la loi, la réduction des risques, la prévention et le traitement.
Partiellement financé à titre de projet pilote par Santé Canada (en collaboration avec la ville et le ministère de la Santé de la province de la Colombie-Britannique), Insite est loin d’avoir fait l’unanimité dès le départ. Certaines autorités policières dont la Gendarmerie royale du Canada notamment (la police fédérale), des intervenants du domaine médical et de la prévention des addictions, voire certains acteurs même au sein du ministère fédéral de la Santé, s’y opposaient soit pour des raisons idéologiques soit par crainte de voir une augmentation des usages et trafics de drogue dans un quartier déjà vulnérabilisé.
Or, le statut du financement de Insite fait présentement l’objet d’un litige judiciaire entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, ce qui est tout à fait révélateur de la complexité de la répartition des pouvoirs au Canada et des difficultés qui balisent le champ des drogues.
Selon la constitution canadienne, les domaines de la santé, de l’éducation, de l’administration de la justice notamment, sont de responsabilité provinciale, tandis que le transport, les communications, les affaires étrangères ou la défense sont de responsabilité fédérale. La simplicité apparente de cette répartition s’arrête là. Ainsi, en matière de justice pénale, l’adoption des lois criminelles dans le Code criminel est de responsabilité fédérale, et le gouvernement fédéral est responsable de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), des pénitenciers fédéraux (pour l’incarcération des contrevenants condamnés à des sentences d’emprisonnement de deux ans et plus), des libérations conditionnelles des détenus sous responsabilité fédérale, et plus généralement des politiques de remise en liberté, en plus d’avoir la responsabilité de nommer les juges de la Cour suprême du Canada et des tribunaux d’appel dans les provinces. Les provinces ont la responsabilité de l’administration de la justice incluant les tribunaux, des prisons provinciales (pour les contrevenants qui ont des sentences de deux ans moins un jour), des politiques et organes de remise en liberté de ces contrevenants, et de la police provinciale (qui, dans certains cas est exercée par le GRC). Quant aux villes, qui sont, au Canada, des créations des provinces, elles ont la responsabilité de la police municipale (qui a tous les pouvoirs de police autant que la GRC ou les polices provinciales)... et d’accueillir sur leur territoire les détenus remis en liberté, y compris en prévoyant l’installation de maisons de transition et autres centres d’hébergement sans qu’elles n’aient grand-chose à y dire. On voit un peu le casse-tête.
En matière de santé, les choses sont un peu plus claires : les provinces ont toute responsabilité pour l’établissement et la gestion de l’ensemble des soins de santé. Ou presque. Premièrement, une exception : les populations autochtones (environ 2 % de la population canadienne) qui relèvent du gouvernement fédéral. Deuxièmement, la Loi sur la Santé au Canada qui a créé le régime universel de soins de santé au pays prévoit notamment des standards minima à travers le pays et un co-financement du régime entre le fédéral (dont la portion a diminué depuis les quinze dernières années à hauteur d’environ 20 % présentement), ce qui donne déjà un rôle régulateur important au fédéral. Troisièmement, en matière de santé publique, les trois paliers de gouvernement ont un mot à dire, mais pas de façon égale : certaines villes ont des établissements de santé publique (c’est le cas à Vancouver) mais pas toutes, les provinces ont toutes des organismes de santé publique, et le fédéral a aussi le sien propre.
S’agissant des politiques en matière de drogues, surtout lorsqu’il est question de drogues illicites, en raison des obligations internationales qui viennent se superposer aux lois et politiques nationales, on imagine les complexités et ambiguïtés qui résultent de cette répartition des pouvoirs. Le Code criminel canadien interdit la production, la détention, le trafic, et l’importation de stupéfiants. La politique nationale anti-drogue, qui sera décrite plus loin, est aussi de juridiction fédérale. En revanche, les politiques de santé publique, notamment pour la réduction des maladies infectieuses, sont principalement de portée et d’application provinciale.
Pour ce qui concerne des approches novatrices comme Insite, il doit donc obligatoirement y avoir dérogation aux dispositions du Code criminel, voire à certains traités dont le Canada est signataire, dans la mesure où l’organisme local doit pouvoir permettre l’utilisation sur place de doses d’héroïne, de même que leur stockage sous contrôle médical. Cette décision de surseoir aux obligations juridiques est du ressort du gouvernement fédéral. En revanche, la gestion de la santé publique et de ses conséquences, y compris financières, sur les hôpitaux, est du ressort de la province. Et la ville, qui a peu de pouvoirs, doit néanmoins faire face aux conséquences de la présence, dans les lieux publics, de toxicomanes voire de scènes ouvertes de drogues, et est confrontée aux plaintes des citoyens qui sont eux-mêmes aux prises chaque jour avec les manifestations les plus dérangeantes de ces phénomènes.
Dès le départ, l’articulation des politiques et stratégies entre les paliers de gouvernement n’est donc pas chose facile. Ainsi, dans le cas d’Insite, atypique puisqu’unique au Canada, mais non moins révélateur de cette complexité, les uns soutiennent que le gouvernement fédéral peut, de son propre chef, couper les vivres à l’organisme et le faire fermer, tandis que les autres affirment que la santé étant de ressort provincial, la province peut décider si ce genre d’organisme doit ou non faire partie de la gamme des services de santé offerts.
On trouve une complexité semblable sur d’autres aspects connexes. Ainsi par exemple, à l’instar des États-Unis et de nombreux autres pays anglo-saxons, le Canada met à l’essai, depuis bientôt six ans, les tribunaux de traitement de la toxicomanie. Ce programme pilote existe dans 6 villes canadiennes, sous l’égide du ministère fédéral de la Justice. Pourtant, comme il a été souligné plus haut, l’administration de la justice est du ressort des provinces. Que se passera-t-il si le gouvernement fédéral retirait les vivres à ces tribunaux de traitement dont certaines évaluations donnent à penser qu’ils sont efficaces pour réduire la récidive et contribuer à des sorties d’addiction ? Les provinces, qui ne sont pas à l’origine de la décision de piloter ces tribunaux de traitement, devront-elles assumer les coûts de leur pérennisation si leur efficacité est démontrée ?
S’agissant des programmes de traitement des addictions, il n’y a pas pour l’instant de standards minima au Canada, et chaque province peut définir l’offre et le contenu des programmes de traitement. Or, non seulement l’offre de traitement est très faible par rapport à la demande – certains l’évaluant à moins de 10 % de couverture – mais elle est de qualité extrêmement variable d’une juridiction à l’autre.
Évolutions récentes de la criminalité
Comme partout ailleurs, la mesure des phénomènes de drogues et de délinquance présente une série de défis qui n’ont d’ailleurs pas été résolus au Canada mieux qu’ailleurs, moins bien peut-être lorsqu’il est question des drogues, mieux en matière de délinquance.
La mesure de la délinquance révélée au Canada est globalement plutôt fiable et plutôt bien traitée par Statistiques Canada. Procédant des délits signalés à la police (ou par la police elle-même lorsqu’il s’agit de délits dits « sans victimes » comme c’est le cas en matière de drogues illicites), la base statistique est uniformisée à travers le pays et sujette à une série de paliers de contrôles pour assurer la validité et la fiabilité des données. Évidemment, les données ne seront jamais meilleures que ce que les policiers, dans l’exercice de leurs fonctions quotidiennes, enregistreront et de la manière dont ils procéderont à l’enregistrement. Les données sont annualisées et rapportées par le Centre canadien de la statistique juridique.
À la différence d’autres pays, dont l’Angleterre et les États-Unis, le Canada ne procède pas à une enquête annuelle de victimisation. Plutôt, il collecte des données sur la victimisation à la fréquence d’environ tous les cinq ans à travers l’Enquête sociale générale. La dernière remonte à 2006.
Les données les plus récentes indiquent que la criminalité toutes formes confondues a diminué de quelque 35 % au Canada dans son ensemble depuis 1991, et la victimisation de 20 %. Entre 1998 et 2008, la diminution tous délits confondus est de l’ordre de 17 %.
Plus significatif encore, l’indice de gravité des délits, mesuré par Statistiques Canada à partir d’un panier de délits pondérés notamment en fonction de la sévérité des sentences qui leur ont été accordées par les tribunaux, montre aussi une diminution importante de quelque 20 % sur la même période de 10 ans (tableau I).
Tableau Tableau I Évolution des indices de gravité des délits de 1998 à 2007
| |
Total des délits
|
Violence
|
|
Année
|
Indice de gravité
|
Variation (%)
|
Taux de criminalité
|
Variation (%)
|
Indice de gravité
|
Variation (%)
|
Taux de criminalité
|
Variation (%)
|
|
1998
|
118,8
| |
8,092
| |
97,8
| |
1,345
| |
|
1999
|
111,2
|
-6
|
7,694
|
-5
|
99,4
|
2
|
1,440
|
7
|
|
2000
|
106,7
|
-4
|
7,607
|
-1
|
97,8
|
-2
|
1,494
|
4
|
|
2001
|
105,3
|
-1
|
7,586
|
0
|
97,2
|
-1
|
1,473
|
-1
|
|
2002
|
104,1
|
-1
|
7,508
|
-1
|
96,2
|
-1
|
1,440
|
-2
|
|
2003
|
106,8
|
3
|
7,761
|
3
|
97,6
|
1
|
1,433
|
0
|
|
2004
|
104,1
|
-3
|
7,587
|
-2
|
96,0
|
-2
|
1,402
|
-2
|
|
2005
|
101,3
|
-3
|
7,310
|
-4
|
98,5
|
3
|
1,386
|
-1
|
|
2006
|
100,0
|
-1
|
7,228
|
-1
|
100,0
|
2
|
1,383
|
0
|
|
2007
|
95,2
|
-5
|
6,899
|
-5
|
97,7
|
-2
|
1,352
|
-2
|
Toutefois, ces diminutions globales cachent des variations importantes. La diminution est nettement plus marquée pour ce qui a trait aux délits contre la propriété (-40 % sur la décennie) que pour ce qui concerne les délits contre la personne (-1 % sur la même période). En revanche, pour ce qui concerne les délits relatifs aux drogues, ils sont en augmentation très nette, notamment chez les mineurs de moins de 18 ans, dont les taux ont doublé au cours de la décennie 1998-2008.
Les diminutions globales ne s’expriment pas non plus de la même manière selon les régions du pays. Les provinces de l’Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique) et les trois territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), bien que moins peuplés et moins densément, ont des taux de criminalité généralement beaucoup plus élevés que dans les autres provinces, notamment l’Ontario et le Québec plus peuplées : on recense quelques 14 000 délits pour 100 000 habitants en Saskatchewan, à peine plus de 5 000 au Québec. À bassins de population semblables, Winnipeg a un taux de 8 000, Québec de 4 000.
On observe aussi des variations importantes selon les populations. Les jeunes âgés de plus de 12 ans (l’âge minimal de la responsabilité pénale au Canada est fixé à 12 ans) et de moins de 18 ans, qui sont traités en vertu du système de justice des mineurs, comptent pour une proportion plus importante qu’auparavant des contrevenants signalés ce qui s’expliquera notamment par la chute moins importante de délits pour cette classe d’âge sur la décennie 1998-2008 : -4 %. De surcroît, au cours de cette période, les délits de violence ont augmenté de quelque 12 % chez les jeunes. De même, les autochtones ont des taux de violence nettement plus élevés que les populations non autochtones, ce qui expliquera aussi pour partie le niveau de criminalité plus élevé dans les provinces de l’Ouest où les autochtones sont plus nombreux.
Évolutions récentes des phénomènes de drogues
L’appareillage de mesure des consommations et usages de drogues au Canada n’est globalement pas aussi sophistiqué que ce que l’on peut trouver aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Les enquêtes en population générale sont peu fréquentes, suivant un cycle à peu près quinquennal : 1989, 1994, 1999, 2004 et 2008, la toute première ayant été menée par la Commission d’enquête LeDain en 1970. L’usage du cannabis est en hausse entre 1999 et 2004 mais en baisse entre 2004 et 2008 (14,1% versus 11,4%), tandis que l’usage de l’héroïne est en baisse et que celui des autres drogues est en dents de scie.
Les enquêtes en population étudiante sont aussi menées à intervalles irréguliers et ne sont pas réalisées dans toutes les provinces. La meilleure, comparable en qualité et en régularité à l’enquête américaine Monitoring the Future, est réalisée en Ontario auprès de quelque 4 000 étudiants âgés entre 12 et 16 ans dans les écoles secondaires. Les données montrent des baisses importantes de l’usage de toutes les drogues, tabac et alcool inclus, surtout par rapport aux pics de 1979 et 1999. En 2007, 26 % des étudiants ont utilisé du cannabis au cours de la dernière année, 14 % plus de 6 fois. Les auteurs de l’enquête estiment que quelque 10 % des usagers manifesteraient des signes de dépendance.
La production de certaines drogues illicites, notamment le cannabis, l’ecstasy et les métamphétamines serait en nette augmentation au Canada au cours de la dernière décennie. D’ailleurs, le Canada est un exportateur net de chacune de ces trois substances. Le nombre et la quantité des saisies par les corps policiers et les douaniers n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières années. Conséquence ou non d’une action policière renforcée et de la disponibilité, les phénomènes de guerre de gangs, notamment sur la côte ouest et dans certaines villes des Prairies, ont pris une ampleur qui inquiète la population et les gouvernements.
Évolutions récentes des politiques publiques
Deux principales politiques publiques balisent le champ de la délinquance et des drogues au niveau du gouvernement fédéral : la Stratégie nationale sur la prévention du crime (SNPC) et la Stratégie nationale anti-drogues (SNAD). De manière et avec une portée différente, chacune entend se décliner au niveau des provinces et au niveau local. On verra cependant que ce n’est rien d’immédiat ni de simple.
Stratégie de prévention du crime
La Stratégie nationale sur la prévention du crime prend ses racines dans le rapport d’un comité parlementaire (dit rapport Horner) déposé en 1993 qui recommandait au gouvernement fédéral de créer un centre de responsabilité chargé de la mise en œuvre de programmes de prévention du crime, et qui serait doté à terme d’un budget équivalent à 5 % des dépenses de justice pénale (police, tribunaux et pénitenciers). Le gouvernement donnait suite au rapport en créant le Conseil national de prévention du crime qui, de 1994 à 1996, a consulté les experts et intervenants, recensé la littérature scientifique et mené ses propres études, pour proposer au gouvernement l’adoption d’une politique de prévention fondée sur le développement social. En 1998, le gouvernement créait, au sein du ministère de la Justice, le Centre national de prévention du crime (CNPC), chargé d’appliquer cette politique de prévention par le développement social. D’abord doté d’un fonds annuel de 3,5 M $ pour soutenir des projets de prévention dans les collectivités locales, le CNPC a vu son budget augmenter exponentiellement à 35 M $ dès 2001, puis à 63 M $ en 2004.
De même que tous les programmes gouvernementaux qui ne sont pas issus d’une loi votée par le Parlement doivent être revus tous les cinq ans pour en déterminer la pertinence et les orientations, la SNPC a été réexaminée en 2008 et reconduite avec des orientations plus pointues. Elle ne repose plus sur une approche de prévention universelle par le développement social mais plutôt sur une prévention secondaire sélective et indiquée auprès des personnes qui présentent des facteurs de risque. Plusieurs études établissent en effet que l’accumulation de certains facteurs de risque prédispose certaines personnes à s’inscrire dans une trajectoire de délinquance au long cours. Ainsi par exemple, les enfants qui présentent des manifestations d’agressivité précoce (vers les 4-5 ans), des difficultés d’apprentissage avec troubles de comportement (hyperactivité) en milieu scolaire, l’usage prématuré (avant l’âge moyen d’initiation) de substances psychoactives (tabac, alcool et drogues illicites), des contacts en bas âge avec la police (dès les 7-9 ans), et qui de surcroît proviennent d’un milieu familial dysfonctionnel (discipline incohérente ou excessive, violence intrafamiliale) et fréquentent des pairs délinquants, sont significativement plus à risque de commettre des délits, d’être arrêtés par la police et condamnés et, si rien n’est fait en amont, de développer une trajectoire de délinquance prolongée.
En ce sens, les priorités de la SNPC sont d’intervenir auprès des enfants (6-11 ans), des jeunes (12-17 ans), des jeunes adultes (18-24 ans), qui présentent ces facteurs de risque en soutenant la mise en œuvre de projets d’interventions de nature psychosociale dans les collectivités locales. La SNPC a aussi pour priorité de cibler certains types de délits jugés prioritaires, notamment la violence des gangs de rue ainsi que les délits reliés aux drogues illicites. Cette dernière priorité provient en droite ligne de la Stratégie nationale anti-drogues.
Stratégie nationale anti-drogues (SNAD)
La première stratégie canadienne sur les drogues remonte à 1987. Elle portait alors sur l’alcool aussi bien que sur les drogues illicites et reposait sur quatre piliers : réduction des risques, prévention, intervention et traitement. Elle était gouvernée par le ministère de la Santé fédéral.
En 2007, le gouvernement fédéral a adopté un nouveau cadre de politique publique en matière de drogues illicites, qui est gouverné par le ministère de la Justice. Les politiques sur l’alcool et le tabac continuent d’être gouvernées par le ministère de la Santé. La Stratégie nationale anti-drogues a pour objectifs la réduction de la demande de drogues illicites, la réduction des effets par la prévention et le traitement, et la réduction de l’offre. Le budget total de la SNAD sur cinq ans est de 576 M $. À ce montant, il faudrait encore ajouter les budgets de police et de douane pour les activités de réduction de l’offre, budgets qui sont éminemment difficiles à préciser dans la mesure où la part des drogues dans l’ensemble de l’activité de police demeure inconnue.
Les trois principaux acteurs des volets prévention et traitement de la SNAD sont les ministères de la Justice, de la Santé et de la Sécurité publique.
Le ministère de la Justice du Canada administre le Fonds du système de justice pour les jeunes, un programme qui vise à ce que les citoyens et la collectivité contribuent davantage à accroître l’efficacité et le caractère équitable du système de justice pour les jeunes. La composante anti-drogue du Fonds sert à financer le traitement et la réadaptation des jeunes toxicomanes qui ont des démêlés avec la justice. Des ressources sont disponibles pour favoriser la création de liens entre le système de justice et les programmes et services communautaires qui aident les jeunes à faire des choix judicieux et à résister à la consommation de drogues. Les priorités du Fonds sont l’essai de programmes de traitement de la toxicomanie pour les jeunes qui ont des démêlés avec la justice, les promouvoir et les évaluer, ainsi que la transmission aux provinces et aux territoires, ainsi qu’aux intervenants intéressés, des connaissances sur les programmes et les pratiques prometteuses.
Justice Canada administre également le Programme de traitement des tribunaux de la toxicomanie (près de 4 M $ annuellement) qui a pour objectif de rompre le cycle de la consommation des drogues et de la récidive criminelle. Dans le cadre de ce programme pilote, six tribunaux sont présentement à l’essai dans diverses villes canadiennes, et font l’objet d’une évaluation. En vertu de ces tribunaux de la toxicomanie, les contrevenants multirécidivistes, qui ont une histoire connue d’addiction et qui sont condamnés pour une nouvelle infraction, ont la possibilité de suivre un traitement intensif et multidimensionnel supervisé par le tribunal sur une durée d’un an. Des données préliminaires indiquent un taux de succès relativement élevé par rapport à d’autres formes d’intervention.
Santé Canada, par l’entremise du Fonds des initiatives communautaires de la Stratégie anti-drogue (FICSA), lutte contre la consommation de drogues illicites chez les jeunes en exécutant des projets de prévention et de promotion de la santé sur lesquels il est essentiel de mobiliser les jeunes de manière significative. Ce fonds est à hauteur de 12 M $ annuellement sur cinq ans. Les résultats doivent être mesurables en matière de prévention et de réduction de la consommation de drogues illicites chez les jeunes. Les collectivités sont invitées à présenter des demandes de financement pour des projets de prévention de la consommation de drogues illicites chez les jeunes de 10 à 24 ans selon deux grandes orientations : la prévention universelle, ou la prévention sélective ou ciblée.
La première orientation consiste à cibler la population générale des jeunes en mettant l’accent sur les drogues illicites les plus susceptibles d’être essayées par ce groupe et examiner les contextes ou les situations qui incitent les jeunes à les essayer. Ce premier volet est une prévention universelle et vise la prévention de la consommation de drogues illicites par la population en général (par exemple parents de jeunes, étudiants, jeunes conducteurs). La prévention universelle ne fait pas de distinction entre les niveaux de risques dans les populations ciblées.
La deuxième orientation consiste à cibler certains groupes de jeunes les plus susceptibles de commencer à consommer des drogues illicites en veillant à décourager l’initiation à la toxicomanie ou à prévenir la progression vers une utilisation plus fréquente ou régulière chez les jeunes. Ce deuxième volet est une prévention sélective ou ciblée et vise des sous-groupes de jeunes personnes qui présentent des facteurs de risque connus associés à la consommation de drogues illicites (par exemple un parent toxicomane, des amis consommateurs, une famille dysfonctionnelle, le milieu, comme le fait de vivre dans un quartier où les drogues illicites sont facilement accessibles). Les groupes ciblés sont les suivants : jeunes de la rue ou jeunes à risque de le devenir ; jeunes pris en charge par des organismes de protection de la jeunesse, par exemple ; lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et bispirituels
1
« Le terme « bispirituel », ... est issu d’interprétations de termes de langues autochtones utilisés pour décrire les gens qui présentaient des caractéristique mâles et femelles. Le concept de bispiritualité est lié à la description actuelle des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenderistes d’origine autochtone. » Source : site web du ministère de la santé du Canada
http://www.sc-hc.gc.ca.
; jeunes autochtones (hors réserve).
Santé Canada administre aussi le Programme de financement sur le traitement de la toxicomanie (PFTT). Ce programme de 30 M $ par année est un nouveau programme de contributions fédérales destiné à fournir un soutien financier aux provinces, aux territoires et aux intervenants clés en vertu de deux volets distincts mais complémentaires qui vise l’amélioration des systèmes de traitement
2
et le soutien des services de traitement de la toxicomanie. Le PFTT a pour but d’offrir un incitatif aux provinces, aux territoires et aux intervenants clés pour la réalisation de projets qui serviront de points de départ à la mise en œuvre des changements systémiques menant à une amélioration durable sur le plan de la qualité et de l’organisation des systèmes de traitement de la toxicomanie. Le PFTT a également pour but d’augmenter la disponibilité des services de traitement afin de répondre aux besoins essentiels en matière de traitement de la toxicomanie chez les jeunes à risque des régions où les besoins sont importants.
De son côté, le Centre national de prévention du crime a engagé près de 20 M $ de ses fonds propres pour soutenir des projets d’intervention auprès de groupes à risque de la population.
Convergences et zones d’ombre
La Stratégie nationale anti-drogues, en réunissant autour d’une même table et d’un cadre commun, contribue à une meilleure articulation des politiques et des programmes fédéraux. Pour le cas de figure qui nous occupe plus spécifiquement, soient les rapports entre la prévention de la délinquance liée à l’usage des drogues et la réduction des risques, les recoupements se déclinent sous deux volets.
Le premier volet est constitué par les fonds de soutien à des initiatives locales engagées par le CNPC au titre de la prévention des délits liés aux usages de drogues. Ces fonds portent en particulier sur les groupes prioritaires suivants :
• enfants de 7 à 12 ans, qui ont déjà commencé à consommer des substances illicites et à afficher un comportement antisocial. Des interventions individualisées et intégrées seront élaborées avec les écoles et nécessiteront la participation des familles afin de prévenir les risques de consommation abusive plus tard et de réduire le comportement antisocial qui y est associé ;
• adolescents de 13 à 17 ans, qui sont polyconsommateurs (alcool et autres drogues) et qui présentent un risque de comportement délinquant. Le CNPC s’associera avec les écoles, la GRC et les services de police locaux ainsi qu’avec les services sociaux pour identifier les jeunes à risque et les référer aux services appropriés, concevoir et mettre en pratique des interventions individualisées et intégrées visant à réduire leur propension à commettre un délit et à consommer ;
• ex-délinquants, jeunes et adultes toxicomanes, qui ne sont plus sous la responsabilité des services correctionnels. Le CNPC travaillera avec des partenaires pour concevoir et mettre en pratique des interventions visant à prévenir les risques de récidive et à aider ces individus à risque grâce à des mesures de réinsertion sociale ;
• autochtones toxicomanes qui affichent un comportement problématique : le CNPC invitera les collectivités autochtones à concevoir et à mettre en pratique des interventions adaptées aux particularités culturelles et aux besoins particuliers des autochtones (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves), qui ont de sérieux problèmes de consommation et de comportements antisociaux.
Le choix de ces cibles prioritaires d’action repose sur les connaissances des facteurs de risque de délinquance. Or, la relation entre drogues et criminalité est complexe : malgré le volume imposant des études empiriques réalisées, la nature, la direction et les spécificités (aux produits, aux modes et contextes d’usage, aux individus...) de cette relation demeurent encore incertaines. Cependant, il est connu que certaines formes d’usages, notamment les usages précoces et dérégulés chez les jeunes, et les usages qui se superposent à une carrière délinquante déjà avérée, augmentent significativement les risques de délinquance chronique.
En ce qui concerne le deuxième volet, Justice Canada finance, comme on l’a vu plus haut, par l’entremise de l’initiative sur les jeunes contrevenants, des interventions spécifiquement auprès des jeunes contrevenants avérés qui ont aussi des problématiques de toxicomanie, ainsi que les tribunaux de traitement de la toxicomanie visant à réduire la récidive chronique chez des contrevenants toxicomanes adultes.
Ces deux composantes de la stratégie anti-drogues sont donc très clairement reliées à cet objectif commun de réduire la délinquance liée à l’usage des drogues. Il subsiste néanmoins une série de zones d’ombre.
Difficultés de l’articulation
Les programmes du gouvernement fédéral décrits dans la section précédente sont tous des programmes pilotes, qui financent des actions à durée déterminée (sur un maximum de cinq ans), par le biais de demandes de financement déposées par les collectivités ou organismes locaux. Si elle permet de procéder graduellement, notamment dans le but d’établir l’efficacité des interventions, cette façon de faire présente néanmoins un certain nombre de désavantages.
Ainsi, les interventions financées n’existent que dans quelques collectivités à travers le pays, tant en raison de la limite des financements disponibles qu’en raison du fait que les collectivités locales doivent être en mesure d’identifier un besoin auquel elles font face et d’élaborer une demande de financement.
Les interventions mises en application n’ont aucune garantie de pérennité, puisque les financements du fédéral sont à durée limitée et qu’il n’y a aucune assurance que d’autres paliers de gouvernement les soutiendront par la suite.
Il en résulte une sorte de patchwork pas nécessairement cohérent à travers le pays, dont il serait bien difficile d’affirmer, données à l’appui, qu’il correspond à l’état des besoins.
Toutes les provinces ne se sont pas dotées d’un cadre de politique publique spécifique en matière de prévention de la délinquance, mais toutes ont une stratégie sur les drogues et l’alcool. Quant aux collectivités locales, elles sont peu nombreuses à avoir élaboré l’une ou l’autre. Mais dans un cas comme dans l’autre, l’articulation de l’intervention entre les divers paliers de gouvernement demeure parfois difficile et il se présente des situations où les stratégies fédérale et provinciales sont en contradiction. On l’a vu plus haut dans le cas de Insite à Vancouver. C’est aussi le cas pour les tribunaux de la toxicomanie qui ne font pas l’unanimité entre les provinces, voire avec la magistrature.
La place de la réduction des risques dans la nouvelle stratégie demeure également ambiguë. Au-delà de Insite, on en trouve un exemple dans la situation incertaine du projet de recherche Salome (Study to Assess Longer-term Opioid Medication Effectiveness) qui est la suite de Naomi (North American Opiate Medication Initiative) qui a pris fin en 2008. Il s’agit d’un projet de recherche qui s’inscrit dans une philosophie de réduction des méfaits et qui vise à évaluer les impacts du traitement avec des opioïdes injectables sur la rétention en traitement et sur la santé, pour des personnes répondant mal aux stratégies thérapeutiques actuellement disponibles. Mené auprès de 59 usagers à Montréal et de 192 autres à Vancouver, ce projet a procédé à une comparaison entre l’efficacité d’un traitement traditionnel de substitution à la méthadone et la prescription d’héroïne pharmaceutique chez une clientèle de toxicomanes de longue date, incapables, malgré de multiples essais, de se libérer de leur dépendance. Pour son projet de recherche, l’équipe de Salome doit franchir deux obstacles : obtenir l’autorisation du bureau des essais cliniques et faire une demande d’exemption en vertu de la section 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances auprès du bureau des substances contrôlées. Ce projet n’a pour le moment pas encore démarré.
Pour de nombreux praticiens du terrain, les orientations de la nouvelle stratégie anti-drogues ne sont pas en phase avec les besoins des usagers de drogues, notamment les plus en difficulté. Si l’on s’accorde pour mettre l’accent sur la prévention et surtout sur le développement d’une meilleure connaissance de l’efficacité de diverses formes de traitement et, à terme, de standards minima, plusieurs observent que le durcissement des pratiques policières (qui se traduit entre autres par l’augmentation importante de l’enregistrement de délits relatifs aux lois sur les drogues comme on l’a vu plus haut) entre souvent en conflit avec la pratique du travail de proximité avec les usagers. Certains analystes allant même jusqu’à suggérer que cette répression accrue serait l’un des facteurs de la violence des gangs liés à la production et au trafic des drogues.
En conclusion, on peut constater que si une certaine forme d’affichage de la réduction des risques est moins visible en vertu de la nouvelle stratégie anti-drogues, sa pratique s’exprime de manière plus spécifique, plus pointue, sur certains objets, notamment dans le domaine des risques sociaux reliés aux drogues. Dans une certaine mesure, et sans prêter d’intentions au législateur, il est permis de penser que cette décision est en accord avec les champs de responsabilité des deux principaux ordres de gouvernement. En effet, s’agissant des risques sociaux ayant trait à la sécurité publique, il est clair que, bien qu’il s’agisse là d’une responsabilité partagée, le gouvernement fédéral a un rôle clair en la matière, rôle qu’il a décidé d’assumer pleinement. La focalisation de la stratégie sur la prévention d’effets délictueux relatifs à certains usages de drogues est en accord avec cette approche. Par ailleurs, la santé, et donc les risques sanitaires, étant davantage la responsabilité provinciale que fédérale, il devient tout aussi logique que le fédéral se retire de ce champ pour laisser libre cours aux choix des provinces.
Évidemment, comme tout schéma, il pêche par défaut de simplification abusive : on sait bien en ces matières que les risques sociaux et sanitaires sont le plus souvent étroitement imbriqués.
Daniel Sansfaçon
Directeur de Politique, recherche et évaluation
Centre National de prévention du crime, Canada
Complications liées à l’auto-injection des traitements de substitution aux opiacés
Notre contribution se fonde sur l’idée qu’une nouvelle approche clinique des addictions s’est mise en place progressivement, à l’hôpital, avec la création des Ecimud (acronyme spécifique à l’AP-HP pour : Équipe de coordination et d’intervention auprès des malades usagers de drogues) devenues ensuite les équipes de liaison et de soins en addictologie (Elsa). La mise en place de ce dispositif de repérage des consommations problématiques de substances psychoactives (drogues illicites, tabac, alcool et médicaments) a eu pour conséquence :
• le développement d’une activité quotidienne d’addictologie assurée par des équipes mobiles et pluridisciplinaires, transversale en partenariat avec les différents services cliniques (services médecine-chirurgie-obstétrique, services des urgences, psychiatrie) ;
• la mise en place de nouveaux dispositifs, comme le repérage précoce des consommations problématiques et l’intervention de réduction des risques liés à l’injection, en binôme praticien-pharmacien dans le cadre des consultations de liaison au lit du malade, l’intervention brève aux urgences avec message de prévention du passage à l’injection et la prise en compte systématisée des comorbidités (par exemple psychiatrie/addictions).
Ce nouveau dispositif hospitalier, créé en 1996 pour les hôpitaux de l’AP-HP, a profondément modifié la perception de l’usage des drogues psychoactives en différenciant les notions d’abus et de dépendance. Il permet de mieux observer les nouvelles modalités d’usage et de comportement vis-à-vis des drogues et des médicaments, mises en perspective avec les complications, motif habituel de passage par l’hôpital.
Notre expérience d’équipe mobile à la Pitié-Salpêtrière
1
KEMPFER J. Flux tendu à la plus ancienne Ecimud de France. Swaps 2008, 49
nous a conforté dans la nécessité d’une prévention ciblée et systématisée avec apport informatif et éducatif dans le cadre de la réduction des risques auprès des usagers de drogues hospitalisés ayant déclaré des conduites d’injection. Cette fonction est assurée en binôme avec le praticien-pharmacien, ou l’infirmière de liaison et les médecins addictologues de l’équipe.
Pratiques d’auto-injection et complications
Les pratiques d’auto-injection ont toujours existé mais ce qui a retenu toute notre attention, c’est l’émergence chez certains patients d’un discours très élaboré et inspiré par des éléments partiels d’informations issus de la réduction des risques, qui justifient des pratiques d’injection banalisées « a priori », quoique compulsives, chronicisées et centrées sur l’usage intraveineux de comprimés (en majorité buprénorphine et sulfates de morphine). Nous avons rencontré cette population d’usagers injecteurs à la faveur d’une complication infectieuse majeure lors d’un passage aux urgences ou au décours d’une hospitalisation et tous avaient bénéficié positivement de la large mise à disposition des traitements de substitution aux opiacés (TSO) depuis 1996 :
• soit dans le cadre d’un programme de prise en charge médicalisée par la prescription du TSO, stabilisé au long court, traitement « de maintenance » (fréquemment supérieur à dix années de TSO) avec persistance d’un mésusage intraveineux ;
• soit hors programme : achat de rue, échanges par les tiers... de comprimés.
Ces discours d’usagers qui se déclaraient informés lors du premier entretien avec notre équipe, étaient prioritairement centrés sur les stratégies de réduction des risques face au risque lié au VIH ou au VHC, et de réduction des overdoses. Il est indéniable que ces stratégies qui ont fait l’objet de grandes campagnes de prévention nationale et de nombreuses campagnes ciblées, sont connues des usagers. Mais il convient de réévaluer les pratiques à chaque rencontre lors des consultations de liaison, car la vigilance doit rester la règle concernant la persistance ou l’arrêt progressif des pratiques d’injection et l’actualisation des connaissances sur les risques.
En revanche, la méconnaissance des prises de risque voire le « déni du risque » est plus fréquente en ce qui concerne les pratiques « cachées » d’auto-injection (à entendre généralement comme des conduites d’injection à l’insu des proches et souvent du médecin-prescripteur), pratiques centrées sur le mésusage intraveineux du traitement de substitution aux opiacés.
Ces pratiques révélées à la faveur de la consultation de liaison dans le service qui se charge de traiter la complication somatique (candidose ophtalmique, spondylodiscite infectieuse, endocardite à Candida...) sont autant d’« urgences addictologiques » c’est-à-dire autant d’occasions, dans des délais les plus courts possibles, de les rendre « visibles » comme pratiques à risque « à l’insu de l’injecteur qui se représente comme en situation de moindre risque ».
Nous avons ainsi repéré une cohorte d’injecteurs pratiquant l’auto-injection exclusive de comprimés qui déclaraient être bien informés sur les risques. En plus, ils se sentaient « sécurisés » par le conditionnement des formes galéniques, et par la qualité des composants du stéribox. En revanche, ils éprouvaient une incompréhension totale, voire un déni violent de ce qui leur arrivait à l’annonce du diagnostic de complication infectieuse liée à leurs pratiques intra-veineuses, c’est-à-dire une candidose ophtalmique avec risque de cécité définitive en l’absence de traitement et d’arrêt des injections.
Le terme d’« épidémie d’injecteurs de comprimés » traduit, maladroitement sans doute, la réalité des pratiques intraveineuses persistantes sous TSO ; selon les cohortes estimées, entre 8 et 30 % des patients sous TSO pratiqueraient une injection de comprimés. Dans l’enquête nationale Oppidum 2008, on retrouve 14 % de pratiques intraveineuses dans le cadre des TSO (en majorité Subutex ou BHD GNR
2
).
Une majorité de ces patients sont stabilisés du point de vue de leur consommation d’opiacés illicites grâce à la prescription de TSO. Ils sont pris en charge en médecine générale de façon régulière ou discontinue. De notre point de vue, ils sont à considérer comme une population d’autant plus difficile à repérer dans le champ de la prévention, qu’elle a toutes les caractéristiques d’une « population cachée »
3
WATTERS JK, BIERNACKI P. Targeted sampling : options for the study of hidden populations. Social problems 1986, 36.
. L’appellation d’« épidémie d’injecteurs » est contestable mais correspond à la réalité clinique de ces dix dernières années du fait de la prédominance du modèle de TSO par la buprénorphine et d’un mode habituel de conduites mimétiques « standardisées » qui se transmettent d’un « injecteur » à un autre par le biais d’informations considérées par l’usager et ses pairs comme standardisées et sécurisées.
Par ailleurs, l’impact épidémiologique de ces complications liées spécifiquement aux pratiques d’auto-injection est peu voire insuffisamment documenté dans les différents supports (cartes, flyers, vidéos, brochures) que nous avons consultés qu’ils soient à la disposition des usagers ou des professionnels
4
CRIPS ÎLE-DE-FRANCE, INPES. Réduire les risques infectieux chez les usagers de drogues par voie intraveineuse. Document pour les professionnels en contact avec les usagers. Juillet 2009 ; OLIVET F. L’injection intraveineuse de substances psychoactives. ASUD Journal, mars 2003 ; FONTAA V, BRONNER C. Persistance de la pratique d’injection chez les patients substitués par méthadone ou buprénorphine haut dosage (étude sur 600 cas). Ann Med Interne 2001, 152 (suppl. 7) : 2S59-2S69
.
Notre fonctionnement transversal a grandement favorisé notre mission d’observatoire de ces pratiques d’auto-injection et de recueil des informations, grâce à deux outils épidémiologiques dont la « fiche patient » élaborée par Christophe Palle (OFDT) pour les équipes de liaison hospitalière et le questionnaire détaillé destiné à évaluer les risques infectieux liés à l’usage de drogue par voie intraveineuse
5
Questionnaire « Évaluation des risques infectieux liés à l’usage de drogue par voie intraveineuse » (41 items) rédigé initialement pour l’étude Canditox et actuellement utilisé dans une version réactualisée. Disponible sur demande : yves.edel@psl.aphp.fr
. La taille importante de notre groupe hospitalier et l’implantation de l’équipe d’addictologie depuis 1996 expliquent qu’un nombre important de complications infectieuses ont pu être diagnostiquées et reliées de manière directe à des facteurs de risque par auto-injection. À ce repérage des facteurs de risque/complications, il faut ajouter les conséquences psychiques personnelles pour le patient hospitalisé. Ces conséquences sont majeures et associent à la fois incompréhension sur les pratiques, considérées par l’usager comme à moindre risque, sinon supposées sans risques, et angoisse quant à la crainte d’une complication irréversible comme une cécité dans le cas d’une candidose ophtalmique ou de séquelles douloureuses chroniques.
Facteurs de risque de la candidose systémique chez les usagers de drogues par voie intraveineuse
La mise au point de l’étude Canditox 2001-2005
6
GAMBOTTI L, BONNET N, IMBERT E, ASTAGNEAU P, EDEL Y. Risk factor for systemic candidiasis among intravenous drug users (Étude Canditox). IHRA’s 19th International Conference, Barcelone, 2008
, étude cas-témoins en
cross-over et multicentrique (150 patients inclus dont 49 cas et 101 témoins) a permis de confirmer nos hypothèses en comparant une cohorte d’injecteurs atteints de candidose systémique avec une localisation secondaire (ophtalmique, articulaire, cutané)
versus une cohorte d’injecteurs non atteints de candidose systémique, avec ajustement sur d’éventuels facteurs de confusion (âge, sexe, durée des conduites addictives...). Une étude mycologique complémentaire a cherché à comparer les souches de
Candida identifiées dans la bouche, dans le(s) tissus(s) atteint(s) et dans les éventuels matériels ou produits ayant servi à la préparation de l’injection. Notre hypothèse de départ était celle d’une contamination par
Candida à partir de la flore orale de l’usager injecteur, dans une prise de risque manuportée et/ou salivoportée lors de la manipulation du comprimé, de la préparation du liquide d’injection ou/et des étapes de l’auto-injection. La majorité des injecteurs de l’étude Canditox avaient des pratiques d’injection par mésusage de leur traitement de substitution en comprimés. Le biais de recrutement hospitalier a été pris en compte dans l’interprétation des résultats. Il convient de revenir sur la singularité de la situation française où la buprénorphine haut dosage (sous sa forme Subutex) tient la place de premier médicament de substitution dans le traitement au long cours de la pharmacodépendance opiacée. Cette particularité porte à la fois sur l’accès le plus large à la substitution par buprénorphine haut dosage à partir d’une consultation en médecine de ville ou dans le dispositif de soins spécialisés en addictologie, et à la grande disponibilité du médicament chez les usagers d’opiacés (échanges entre pairs, trafic, achat au marché noir). Cette loi du nombre peut expliquer pour partie la prévalence d’un mésusage préférentiel par voie intraveineuse de la buprénorphine, rattrapée actuellement par la voie sniffée et fumée, en France métropolitaine. Pour simple rappel, l’inconvénient majeur de la buprénorphine et des sulfates de morphine avec excipient d’amidon est leur injectabilité facile sans la nécessité de chauffage, sans citron additionnel, par simple solubilité au contact d’une eau de dissolution, quoiqu’en écrive le dernier document destiné aux professionnels en contact avec les usagers
7
CRIPS Ile-de-France. Réduire les risques infectieux chez les usagers de drogues par voie intraveineuse (document pour les professionnels en contact avec les usagers), Crips Ile-de-France, Inpes, juillet 2009.
(Crips Île-de-France, 2009).
Les résultats de l’étude Canditox ont démontré que l’hypothèse de l’utilisation du citron, comme vecteur du Candida contaminant, n’est pas vérifiée en cas d’injection de comprimés, tout simplement parce que ce facteur de risque est exclu de la préparation de l’auto-injection. Les risques validés sont prioritairement des facteurs manuportés et salivoportés (mauvaise hygiène des mains avec manipulation des comprimés, arrachage du filtre à cigarette avec les dents, dissection des cotons avec les doigts, léchage de la seringue...), pratiques encore trop souvent méconnues comme à risque par les injecteurs eux-mêmes même quand ils déclarent être surinformés ! Ces mauvaises pratiques d’auto-injection (ignorées de l’injecteur, de l’entourage voire des médecins) confirment la réalité clinique et épidémiologique d’une « population cachée » difficile à quantifier mais ayant pu bénéficier de soins en addictologie adaptés à la situation d’urgence à l’origine de l’hospitalisation grâce au travail de liaison transversale des équipes addictologiques Elsa.
En conclusion, l’épidémiologie des pratiques d’injection et de leurs complications progresse sans cesse, associant de nouvelles maladies à la pratique intraveineuse et affinant l’estimation probabiliste des risques déjà connus (comme l’ont montré les travaux de Peretti-Watel)
8
PERETTI-WATEL P, MOATTI JP. Le principe de prévention (le culte de la santé et ses dérives). La République des idées, Seuil, 2009.
.
La réapparition en clinique des candidoses liées à la pratique de l’auto-injection – mais avaient-elles seulement disparu du champ des diagnostics individuels spécialisés (en particulier chez les ophtalmologistes et les rhumatologues) – nous permet de rappeler que nos patients usagers de drogues, ont su intégrer les messages de prévention des risques ciblés prioritairement sur les risques infectieux VIH-VHC, mais que le risque s’est maintenu du côté des facteurs manuportés et salivoportés dans l’auto-injection.
Cette étrange situation rappelle aux cliniciens et aux acteurs de prévention que « l’épidémiologie multiplie la découverte des facteurs de risque sans pour autant comprendre la persistance, la réapparition, et la transformation originale souvent des conduites qu’elle prétend prévenir »
9
PERETTI-WATEL P, MOATTI JP. Le principe de prévention (le culte de la santé et ses dérives). La République des idées, Seuil, 2009.
.
L’étude Canditox est une illustration quasi expérimentale, pour nous, en milieu hospitalier de cette tension permanente entre des connaissances scientifiques réactualisées, fausses croyances persistantes et maintien des conduites à risques dans les comportements humains.
Yves Edel
Ecimud, Unité d’addictologie hospitalière,
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris
 ), ainsi que dans différentes autres publications accessibles sur le site Internet de l’OEDT2
.
), ainsi que dans différentes autres publications accessibles sur le site Internet de l’OEDT2
. ).
).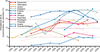
 ), et elle a jusqu’ici été principalement limitée à l’Europe occidentale.
), et elle a jusqu’ici été principalement limitée à l’Europe occidentale.
 ). Ce développement reflète la volonté et la capacité technologique des producteurs et vendeurs de développer des produits qui ciblent les habitudes des consommateurs tout en tentant d’échapper aux mesures de contrôle. Il n’existe pas encore de données fiables sur la consommation ou la vente de ce type de produits, mais leur prix compétitif, la qualité du marketing (emballages, sites Internet) et le nombre de revendeurs pourraient indiquer que le marché n’est pas négligeable.
). Ce développement reflète la volonté et la capacité technologique des producteurs et vendeurs de développer des produits qui ciblent les habitudes des consommateurs tout en tentant d’échapper aux mesures de contrôle. Il n’existe pas encore de données fiables sur la consommation ou la vente de ce type de produits, mais leur prix compétitif, la qualité du marketing (emballages, sites Internet) et le nombre de revendeurs pourraient indiquer que le marché n’est pas négligeable. ), on peut estimer que la prévalence au niveau européen se situe entre 2,2 et 3 cas pour 1 000 habitants âgés entre 15 et 64 ans, soit environ entre 750 000 et un million d’usagers de drogue par injection, toutes drogues confondues (EMCDDA, 2010a
), on peut estimer que la prévalence au niveau européen se situe entre 2,2 et 3 cas pour 1 000 habitants âgés entre 15 et 64 ans, soit environ entre 750 000 et un million d’usagers de drogue par injection, toutes drogues confondues (EMCDDA, 2010a ). Ici aussi, les usagers incarcérés sont sous-représentés.
). Ici aussi, les usagers incarcérés sont sous-représentés.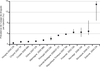
 ), le nombre de décès par overdose (dont la grande majorité sont liés à l’usage d’opiacés), le nombre de saisies d’héroïne, ainsi que les interpellations liées à cette substance. Cette convergence de différents indicateurs a conduit l’OEDT à inviter les États européens à la vigilance et à ne pas réduire leurs efforts pour lutter contre les problèmes liés aux opiacés. Ces derniers constituent toujours la majeure partie des problèmes de drogue en Europe.
), le nombre de décès par overdose (dont la grande majorité sont liés à l’usage d’opiacés), le nombre de saisies d’héroïne, ainsi que les interpellations liées à cette substance. Cette convergence de différents indicateurs a conduit l’OEDT à inviter les États européens à la vigilance et à ne pas réduire leurs efforts pour lutter contre les problèmes liés aux opiacés. Ces derniers constituent toujours la majeure partie des problèmes de drogue en Europe. ). Toutefois, la hausse de l’usage d’opiacés mentionnée ci-dessus implique aussi que, dans certains pays, le nombre absolu d’usagers d’opiacés par injection entrant en traitement pour la première fois est en réalité stable ou en hausse.
). Toutefois, la hausse de l’usage d’opiacés mentionnée ci-dessus implique aussi que, dans certains pays, le nombre absolu d’usagers d’opiacés par injection entrant en traitement pour la première fois est en réalité stable ou en hausse.
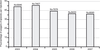
 ), qui pourrait être expliquée par différents facteurs incluant le vieillissement d’une population de consommateurs de longue date et une hausse de la polyconsommation. Différentes études ont aussi montré que les usagers de drogue sortant de prison et ceux interrompant un traitement ont un risque particulièrement élevé de décès (Davoli et coll., 2007
), qui pourrait être expliquée par différents facteurs incluant le vieillissement d’une population de consommateurs de longue date et une hausse de la polyconsommation. Différentes études ont aussi montré que les usagers de drogue sortant de prison et ceux interrompant un traitement ont un risque particulièrement élevé de décès (Davoli et coll., 2007 ; Farrell et coll., 2008
; Farrell et coll., 2008 ).
).
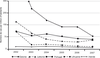
 ).
). ) et on estime qu’il y a environ cent à deux cent mille (ex-)consommateurs de drogue qui sont porteurs du virus dans l’Union Européenne. Depuis quelques années, le nombre de nouvelles infections est en baisse, notamment dans les pays rapportant les nombres et taux de contamination par le VIH les plus élevés (figure 7
) et on estime qu’il y a environ cent à deux cent mille (ex-)consommateurs de drogue qui sont porteurs du virus dans l’Union Européenne. Depuis quelques années, le nombre de nouvelles infections est en baisse, notamment dans les pays rapportant les nombres et taux de contamination par le VIH les plus élevés (figure 7 ), et les enquêtes de prévalence chez les usagers de drogues par injection montrent également une situation stable ou en baisse. À l’inverse, la situation dans certains pays frontaliers de l’Union Européenne, comme la Fédération de Russie (11 161 nouveaux cas d’infection rapportées chez des consommateurs de drogue par injection en 2006) et l’Ukraine (7 087 cas en 2007), reste très préoccupante.
), et les enquêtes de prévalence chez les usagers de drogues par injection montrent également une situation stable ou en baisse. À l’inverse, la situation dans certains pays frontaliers de l’Union Européenne, comme la Fédération de Russie (11 161 nouveaux cas d’infection rapportées chez des consommateurs de drogue par injection en 2006) et l’Ukraine (7 087 cas en 2007), reste très préoccupante.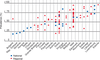
 ). Comme les données provenant des registres des maladies infectieuses sont de qualité inférieure à celles concernant le VIH, il est difficile d’estimer quelle est la tendance dans ce domaine. Ces données suggèrent toutefois que les usagers de drogue par injection sont, parmi ceux dont les facteurs de risque sont connus, le groupe avec l’incidence la plus élevée du VHC (Wiessing et coll., 2008
). Comme les données provenant des registres des maladies infectieuses sont de qualité inférieure à celles concernant le VIH, il est difficile d’estimer quelle est la tendance dans ce domaine. Ces données suggèrent toutefois que les usagers de drogue par injection sont, parmi ceux dont les facteurs de risque sont connus, le groupe avec l’incidence la plus élevée du VHC (Wiessing et coll., 2008 ).
). ).
). ).
). ). On estime qu’environ 670 000 consommateurs d’opiacés ont été en traitement de substitution en 2008, un nombre environ sept fois supérieur à celui estimé en 1993. La plupart des pays continuent d’ailleurs de reporter des hausses du nombre de ces traitements. Les substances prescrites sont avant tout la méthadone (environ 70 % des traitements) et la buprénorphine à haut dosage9
(20 %), mais aussi la morphine à libération lente, la codéine et l’héroïne. Cette dernière est prescrite dans des cliniques spécialisées en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni10
.
). On estime qu’environ 670 000 consommateurs d’opiacés ont été en traitement de substitution en 2008, un nombre environ sept fois supérieur à celui estimé en 1993. La plupart des pays continuent d’ailleurs de reporter des hausses du nombre de ces traitements. Les substances prescrites sont avant tout la méthadone (environ 70 % des traitements) et la buprénorphine à haut dosage9
(20 %), mais aussi la morphine à libération lente, la codéine et l’héroïne. Cette dernière est prescrite dans des cliniques spécialisées en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni10
.
 ). De manière générale, la prescription de ces traitements par les médecins généralistes semble souvent associée à un plus haut taux de couverture.
). De manière générale, la prescription de ces traitements par les médecins généralistes semble souvent associée à un plus haut taux de couverture.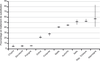
 ), vieillissement et fragilisation de certaines catégories d’usagers. Ces différentes tendances pourraient en fait, malgré une situation en apparence stable, être synonymes d’une hausse globale des risques associés à la consommation de drogue en Europe. Les tendances préoccupantes observées pour le nombre de décès par overdose pourraient en être un reflet.
), vieillissement et fragilisation de certaines catégories d’usagers. Ces différentes tendances pourraient en fait, malgré une situation en apparence stable, être synonymes d’une hausse globale des risques associés à la consommation de drogue en Europe. Les tendances préoccupantes observées pour le nombre de décès par overdose pourraient en être un reflet.









 (Available online:http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18884)
(Available online:http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18884) ), des réseaux de politiques publiques, regroupant des acteurs d’origines diverses mais dont les croyances sont convergentes (médecins humanitaires, associations d’usagers, professionnels du sida...) et pour lesquels il convient de réorganiser la hiérarchie des objectifs des politiques sanitaires. S’il est louable de vouloir traiter les causes de la toxicomanie et de prévenir les usages, il est urgent, argument-ils, en ces temps de menace planétaire pour la santé publique, de traiter les conséquences des usages et de prévenir les risques qui leur sont associés. C’est ainsi que le modèle dit de la « réduction des risques », développé originellement aux Pays-Bas (Boekout Van Solinge, 2004
), des réseaux de politiques publiques, regroupant des acteurs d’origines diverses mais dont les croyances sont convergentes (médecins humanitaires, associations d’usagers, professionnels du sida...) et pour lesquels il convient de réorganiser la hiérarchie des objectifs des politiques sanitaires. S’il est louable de vouloir traiter les causes de la toxicomanie et de prévenir les usages, il est urgent, argument-ils, en ces temps de menace planétaire pour la santé publique, de traiter les conséquences des usages et de prévenir les risques qui leur sont associés. C’est ainsi que le modèle dit de la « réduction des risques », développé originellement aux Pays-Bas (Boekout Van Solinge, 2004 ), se trouve inscrit sur l’agenda politique. Profitant de la médiatisation sans précédent et de l’importance politique qu’a prise le problème du sida (Favre, 1992
), se trouve inscrit sur l’agenda politique. Profitant de la médiatisation sans précédent et de l’importance politique qu’a prise le problème du sida (Favre, 1992 ) bénéficiant du soutien décisif des militants anti-sida qui ont acquis des positions clefs d’influence politique, les défenseurs de la réduction des risques vont réussir, partout en Europe, à imposer cette politique qui prévoit la mise en place de lieux de soins de première urgence, la distribution de matériel d’injection stérile et la fourniture extensive des produits de substitution. La méthadone est en effet réputée favoriser l’arrêt de l’injection intraveineuse d’héroïne et permettre au toxicomane de ne plus être prisonnier d’un mode de vie où la recherche du produit et des moyens de l’obtenir peuvent devenir une activité à plein temps. La méthadone fut ainsi conçue comme un instrument permettant non seulement de limiter la diffusion des virus du sida et de l’hépatite C mais aussi de favoriser une réinsertion sociale et sanitaire, jugée de plus en plus nécessaire pour certains toxicomanes toujours plus désocialisés et dans des situations médicales de plus en plus désastreuses (hépatite C, maladies opportunistes du sida...).
) bénéficiant du soutien décisif des militants anti-sida qui ont acquis des positions clefs d’influence politique, les défenseurs de la réduction des risques vont réussir, partout en Europe, à imposer cette politique qui prévoit la mise en place de lieux de soins de première urgence, la distribution de matériel d’injection stérile et la fourniture extensive des produits de substitution. La méthadone est en effet réputée favoriser l’arrêt de l’injection intraveineuse d’héroïne et permettre au toxicomane de ne plus être prisonnier d’un mode de vie où la recherche du produit et des moyens de l’obtenir peuvent devenir une activité à plein temps. La méthadone fut ainsi conçue comme un instrument permettant non seulement de limiter la diffusion des virus du sida et de l’hépatite C mais aussi de favoriser une réinsertion sociale et sanitaire, jugée de plus en plus nécessaire pour certains toxicomanes toujours plus désocialisés et dans des situations médicales de plus en plus désastreuses (hépatite C, maladies opportunistes du sida...). ), la valeur et l’importance de cette politique et de certaines interventions qui la composent (certaines mesures comme la distribution contrôlée d’héroïne restent cependant sujettes à controverse entre États membres et ne font pas partie des mesures visées par cette recommandation). Certains auteurs affirment ainsi que se dessine une tendance à la convergence des réponses sanitaires dans tous les pays de l’Union, tendance que la Commission européenne aurait amplement favorisée (Grange, 2005
), la valeur et l’importance de cette politique et de certaines interventions qui la composent (certaines mesures comme la distribution contrôlée d’héroïne restent cependant sujettes à controverse entre États membres et ne font pas partie des mesures visées par cette recommandation). Certains auteurs affirment ainsi que se dessine une tendance à la convergence des réponses sanitaires dans tous les pays de l’Union, tendance que la Commission européenne aurait amplement favorisée (Grange, 2005 ; Bergeron, 2005
; Bergeron, 2005 ). Le Canada, le Brésil et l’Australie ont également adopté ce modèle. Seuls les États-Unis, en particulier à l’initiative des administrations Bush (père et fils), résistent à la mise en œuvre de ce qu’ils considèrent être une forme de renoncement moral et une porte ouverte à d’occultes manœuvres visant la levée de l’interdiction.
). Le Canada, le Brésil et l’Australie ont également adopté ce modèle. Seuls les États-Unis, en particulier à l’initiative des administrations Bush (père et fils), résistent à la mise en œuvre de ce qu’ils considèrent être une forme de renoncement moral et une porte ouverte à d’occultes manœuvres visant la levée de l’interdiction. ). Dans ce contexte, l’usage risqué de drogues risquées serait le propre d’individus mal socialisés aux normes et techniques d’optimisation du « capital santé », d’individus déviants à l’ordre sanitaire nouveau et à sa médecine de surveillance (Armstrong, 1995
). Dans ce contexte, l’usage risqué de drogues risquées serait le propre d’individus mal socialisés aux normes et techniques d’optimisation du « capital santé », d’individus déviants à l’ordre sanitaire nouveau et à sa médecine de surveillance (Armstrong, 1995 ).
). ) a cherché à identifier quels ont été les groupes d’acteurs qui ont progressivement exercé une influence déterminante dans la définition de ce que devait être la politique publique de soins aux toxicomanes. Il conclut qu’une « communauté de politique », composée d’acteurs d’origines diverses mais partageant des opinions convergentes concernant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre, s’est lentement constituée. Au sein de la Direction générale de la santé (DGS) du ministère de la Santé, un petit nombre de fonctionnaires nouent ainsi des alliances durables avec les représentants professionnels les plus influents du secteur spécialisé (en majorité des psychiatres), qui ont su s’imposer comme les seuls interlocuteurs légitimes du champ spécialisé. Ce couple d’acteurs s’est progressivement autonomisé vis-à-vis des autres instances administratives et politiques, qui auraient pu pourtant émettre un avis sur le contenu de la politique de soins. Comme l’ont montré Jobert et Muller (1987
) a cherché à identifier quels ont été les groupes d’acteurs qui ont progressivement exercé une influence déterminante dans la définition de ce que devait être la politique publique de soins aux toxicomanes. Il conclut qu’une « communauté de politique », composée d’acteurs d’origines diverses mais partageant des opinions convergentes concernant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre, s’est lentement constituée. Au sein de la Direction générale de la santé (DGS) du ministère de la Santé, un petit nombre de fonctionnaires nouent ainsi des alliances durables avec les représentants professionnels les plus influents du secteur spécialisé (en majorité des psychiatres), qui ont su s’imposer comme les seuls interlocuteurs légitimes du champ spécialisé. Ce couple d’acteurs s’est progressivement autonomisé vis-à-vis des autres instances administratives et politiques, qui auraient pu pourtant émettre un avis sur le contenu de la politique de soins. Comme l’ont montré Jobert et Muller (1987 ) en analysant d’autres politiques publiques, on assiste pendant les années 1970 et 1980 au développement simultané d’un double leadership, professionnel et administratif, chacun ayant su s’octroyer la représentation légitime du segment concerné. Mais la seule mise en lumière de l’existence d’un couple d’acteurs autonomes et aux opinions convergentes ainsi que l’analyse des systèmes d’interdépendances durables qui ont lié ces acteurs laissaient une question importante sans réponse : comment pareilles opinions collectives ont-elles pu se maintenir dominantes aussi longtemps en France ? Cette question a porté Bergeron à considérer en particulier les problèmes ayant trait à la formation, au maintien puis à la transformation des croyances des acteurs et à mobiliser le modèle « cognitiviste » d’analyse des croyances collectives développé par Boudon (1986
) en analysant d’autres politiques publiques, on assiste pendant les années 1970 et 1980 au développement simultané d’un double leadership, professionnel et administratif, chacun ayant su s’octroyer la représentation légitime du segment concerné. Mais la seule mise en lumière de l’existence d’un couple d’acteurs autonomes et aux opinions convergentes ainsi que l’analyse des systèmes d’interdépendances durables qui ont lié ces acteurs laissaient une question importante sans réponse : comment pareilles opinions collectives ont-elles pu se maintenir dominantes aussi longtemps en France ? Cette question a porté Bergeron à considérer en particulier les problèmes ayant trait à la formation, au maintien puis à la transformation des croyances des acteurs et à mobiliser le modèle « cognitiviste » d’analyse des croyances collectives développé par Boudon (1986 , 1990
, 1990 ). Nous montrons ainsi que l’adoption d’une doctrine thérapeutique aux origines composites comme corpus cognitif d’interprétation majoritaire dans le champ de la toxicomanie peut s’expliquer comme le résultat d’actions individuelles qui s’appuient sur de « bonnes raisons », compréhensibles (au sens de Weber) quand on les rapporte au contexte socio-historique et culturel dans lequel elles sont situées. En particulier, l’auteur montre que les acteurs en question ne voyaient qu’une frange particulière de toxicomanes (effet de position), qui ne présentait guère les caractéristiques (désocialisation extrême et situation sanitaire très dégradée) sur lesquelles s’échafaude précisément l’argumentation en faveur du développement de la méthadone dans les autres pays ; et que quand ils en rencontraient en effet, les théories qu’ils avaient progressivement faites leurs et qui s’étaient installées en « cadres cognitifs » (effet de disposition) induisaient une interprétation singulière guère favorable à la politique de la réduction des risques. Le modèle cognitiviste focalise donc l’attention sur le fait que le maintien d’une croyance (en l’espèce, le rejet de la méthadone) ne tient pas tant à un respect aveugle de certaines doctrines qu’au fait que l’acteur idéal-typique a des raisons solides de croire que le paradigme adopté et le dispositif institutionnel s’en inspirant sont adaptés à la population qu’il traite.
). Nous montrons ainsi que l’adoption d’une doctrine thérapeutique aux origines composites comme corpus cognitif d’interprétation majoritaire dans le champ de la toxicomanie peut s’expliquer comme le résultat d’actions individuelles qui s’appuient sur de « bonnes raisons », compréhensibles (au sens de Weber) quand on les rapporte au contexte socio-historique et culturel dans lequel elles sont situées. En particulier, l’auteur montre que les acteurs en question ne voyaient qu’une frange particulière de toxicomanes (effet de position), qui ne présentait guère les caractéristiques (désocialisation extrême et situation sanitaire très dégradée) sur lesquelles s’échafaude précisément l’argumentation en faveur du développement de la méthadone dans les autres pays ; et que quand ils en rencontraient en effet, les théories qu’ils avaient progressivement faites leurs et qui s’étaient installées en « cadres cognitifs » (effet de disposition) induisaient une interprétation singulière guère favorable à la politique de la réduction des risques. Le modèle cognitiviste focalise donc l’attention sur le fait que le maintien d’une croyance (en l’espèce, le rejet de la méthadone) ne tient pas tant à un respect aveugle de certaines doctrines qu’au fait que l’acteur idéal-typique a des raisons solides de croire que le paradigme adopté et le dispositif institutionnel s’en inspirant sont adaptés à la population qu’il traite. ), le risque est devenu l’unité à l’aune de laquelle se distinguent, se hiérarchisent et se classent les drogues. L’usage de drogue fait désormais partie de ce vaste continent des « conduites à risques », dont les déterminants sont, malgré les précautions prises, souvent présentés comme essentiellement individuels et que l’on isole, souvent à tort, du contexte social dans lequel ils s’expriment et qui peut en modifier singulièrement l’efficacité (Perreti-Watel, 2004
), le risque est devenu l’unité à l’aune de laquelle se distinguent, se hiérarchisent et se classent les drogues. L’usage de drogue fait désormais partie de ce vaste continent des « conduites à risques », dont les déterminants sont, malgré les précautions prises, souvent présentés comme essentiellement individuels et que l’on isole, souvent à tort, du contexte social dans lequel ils s’expriment et qui peut en modifier singulièrement l’efficacité (Perreti-Watel, 2004 ). Les usagers de drogues « rentrent dans le rang » : ils sont conçus, dans cette perspective, comme des individus autonomes, capables d’estimer les risques qui pèsent sur leur vie future, à l’image de l’homme moderne analysé par Giddens.
). Les usagers de drogues « rentrent dans le rang » : ils sont conçus, dans cette perspective, comme des individus autonomes, capables d’estimer les risques qui pèsent sur leur vie future, à l’image de l’homme moderne analysé par Giddens. ). Au fondement de ce mouvement, la percée, sur le marché scientifique comme en politique, des explications neurobiologiques des phénomènes d’addiction : théories qui montreraient l’existence de voies communes neurobiologiques à l’ensemble des pratiques addictives. La montée des explications d’ordre neurobiologique, qui fondent autant l’avènement de l’addictologie comme discipline clef de l’offre clinique que les orientations nouvelles des politiques publiques (Bergeron, 2003
). Au fondement de ce mouvement, la percée, sur le marché scientifique comme en politique, des explications neurobiologiques des phénomènes d’addiction : théories qui montreraient l’existence de voies communes neurobiologiques à l’ensemble des pratiques addictives. La montée des explications d’ordre neurobiologique, qui fondent autant l’avènement de l’addictologie comme discipline clef de l’offre clinique que les orientations nouvelles des politiques publiques (Bergeron, 2003 ), accentue ainsi la médicalisation et la sanitarisation que nous évoquions plus haut. Trois arguments principaux peuvent être avancés pour soutenir cette hypothèse (Bergeron, 2006
), accentue ainsi la médicalisation et la sanitarisation que nous évoquions plus haut. Trois arguments principaux peuvent être avancés pour soutenir cette hypothèse (Bergeron, 2006 ) :
) : ), l’addiction est devenue la seule maladie dont on punit les conséquences (c’est-à-dire l’usage).
), l’addiction est devenue la seule maladie dont on punit les conséquences (c’est-à-dire l’usage). ) distinguaient ainsi, en Europe, trois types d’États-providence constitués dans les différents pays européens. L’on peut se demander aujourd’hui si la médicalisation et la sanitarisation des problèmes de drogues n’ont pas contribué à effacer les différences les plus saillantes entre pays européens. Ce progressif rapprochement des politiques européennes doit certainement beaucoup à la reconnaissance croissante du caractère fondamental de la réduction des risques dans les stratégies anti-drogues, tout autant qu’au refus de considérer la prison comme la peine devant sanctionner l’usage simple. Il est remarquable qu’il s’agisse là de deux pommes de discorde qui divisaient profondément les États membres il y a encore dix ans, et qui sont aujourd’hui des sujets suscitant sinon un froid consensus, du moins des discussions plus techniques et moins passionnées. Il est, bien sûr, trop tôt pour affirmer que les politiques des États européens connaissent des trajectoires parfaitement convergentes, mais l’on peut toutefois légitimement se demander si un modèle européen de politique des drogues n’est pas en train d’émerger, sur un sujet où l’Union européenne n’a pourtant guère de compétences communautaires. Les ressorts précis des dynamiques présidant à ce supposé processus de convergence politique restent encore à explorer, même si certains auteurs forment déjà quelques hypothèses sur le rôle clef de la Commission européenne et de certaines de ses institutions (Grange, 2005
) distinguaient ainsi, en Europe, trois types d’États-providence constitués dans les différents pays européens. L’on peut se demander aujourd’hui si la médicalisation et la sanitarisation des problèmes de drogues n’ont pas contribué à effacer les différences les plus saillantes entre pays européens. Ce progressif rapprochement des politiques européennes doit certainement beaucoup à la reconnaissance croissante du caractère fondamental de la réduction des risques dans les stratégies anti-drogues, tout autant qu’au refus de considérer la prison comme la peine devant sanctionner l’usage simple. Il est remarquable qu’il s’agisse là de deux pommes de discorde qui divisaient profondément les États membres il y a encore dix ans, et qui sont aujourd’hui des sujets suscitant sinon un froid consensus, du moins des discussions plus techniques et moins passionnées. Il est, bien sûr, trop tôt pour affirmer que les politiques des États européens connaissent des trajectoires parfaitement convergentes, mais l’on peut toutefois légitimement se demander si un modèle européen de politique des drogues n’est pas en train d’émerger, sur un sujet où l’Union européenne n’a pourtant guère de compétences communautaires. Les ressorts précis des dynamiques présidant à ce supposé processus de convergence politique restent encore à explorer, même si certains auteurs forment déjà quelques hypothèses sur le rôle clef de la Commission européenne et de certaines de ses institutions (Grange, 2005 ; Bergeron, 2005
; Bergeron, 2005 ).
). ), remplacé l’État social. Ce que l’on pourrait appeler le « modèle de la fonction inverse » et qui suppose que la réponse pénale s’accroît à mesure que l’offre sociale décline ne s’applique guère à la situation européenne : contrairement à ce qu’avance Wacquant pour les États-Unis (et en le paraphrasant), le traitement pénal sévère (par l’emprisonnement en particulier) de l’usage simple de drogues a progressivement, en Europe, été doté d’une charge symbolique négative, tandis que l’approche médicale et sociale (donc par le welfare) s’est vue gagner progressivement une connotation positive. Toutefois, si l’État pénal, décrit par Wacquant, cet État qui enferme plutôt qu’il ne traite (ou qui traite en enfermant), ne s’est pas épanoui en Europe, l’on ne peut manquer de relever l’augmentation des interpellations massives pour usage dans un grand nombre de pays, les tentatives de maximisation de la réponse judiciaire à l’usage, dans un certain nombre d’autres, et le maintien généralisé du principe de la prohibition. Ainsi est-il plus juste de constater l’existence d’un phénomène de juxtaposition de l’État social et de l’État pénal en Europe, que d’avancer l’hypothèse d’une relation de compensation.
), remplacé l’État social. Ce que l’on pourrait appeler le « modèle de la fonction inverse » et qui suppose que la réponse pénale s’accroît à mesure que l’offre sociale décline ne s’applique guère à la situation européenne : contrairement à ce qu’avance Wacquant pour les États-Unis (et en le paraphrasant), le traitement pénal sévère (par l’emprisonnement en particulier) de l’usage simple de drogues a progressivement, en Europe, été doté d’une charge symbolique négative, tandis que l’approche médicale et sociale (donc par le welfare) s’est vue gagner progressivement une connotation positive. Toutefois, si l’État pénal, décrit par Wacquant, cet État qui enferme plutôt qu’il ne traite (ou qui traite en enfermant), ne s’est pas épanoui en Europe, l’on ne peut manquer de relever l’augmentation des interpellations massives pour usage dans un grand nombre de pays, les tentatives de maximisation de la réponse judiciaire à l’usage, dans un certain nombre d’autres, et le maintien généralisé du principe de la prohibition. Ainsi est-il plus juste de constater l’existence d’un phénomène de juxtaposition de l’État social et de l’État pénal en Europe, que d’avancer l’hypothèse d’une relation de compensation. ) : législation sur la drogue au volant, mesures de lutte contre les nuisances publiques (en particulier en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique et en Grande-Bretagne), interdiction des rassemblements de jeunes qui boivent de l’alcool dans les lieux publics (Espagne), dispositions réglementaires encadrant l’organisation de rave parties et leur isolement dans des espaces fermés, ou encore tentations grandissantes de contrôle de la consommation sur le lieu de travail et du développement consécutif de l’utilisation des tests (Crespin, 2004
) : législation sur la drogue au volant, mesures de lutte contre les nuisances publiques (en particulier en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique et en Grande-Bretagne), interdiction des rassemblements de jeunes qui boivent de l’alcool dans les lieux publics (Espagne), dispositions réglementaires encadrant l’organisation de rave parties et leur isolement dans des espaces fermés, ou encore tentations grandissantes de contrôle de la consommation sur le lieu de travail et du développement consécutif de l’utilisation des tests (Crespin, 2004 )... Voilà autant de mesures, diverses certes, mais qui cherchent la « civilisation » de conduites nuisibles pour la collectivité, leur maintien à distance de l’espace partagé ou tout bonnement leur interdiction (Bergeron, 2009
)... Voilà autant de mesures, diverses certes, mais qui cherchent la « civilisation » de conduites nuisibles pour la collectivité, leur maintien à distance de l’espace partagé ou tout bonnement leur interdiction (Bergeron, 2009 ). Il n’est pas déraisonnable de vouloir y discerner une volonté de protection de l’espace public et de la collectivité, protection qui était un des arguments clefs de la campagne de promotion de la réduction des risques. À n’en pas douter, comme dans le cas de la formation d’autres politiques publiques, les associations de « victimes » de ces usages et usagers auront un rôle plus important dans l’élaboration de l’action publique si pareille tendance venait à s’affirmer, comme ce fut le cas en France lors du vote de la loi sur les stupéfiants au volant en 2003 (loi dite Marilou, du nom de l’association créée par les parents d’une victime d’un accident de la route où le conducteur d’un des véhicules avait été testé positif au cannabis). Médicalisation, souci de sécurité sanitaire et contrôle de l’espace public, voilà les trois axes de développement de la régulation politique et du contrôle social de l’usage de drogues.
). Il n’est pas déraisonnable de vouloir y discerner une volonté de protection de l’espace public et de la collectivité, protection qui était un des arguments clefs de la campagne de promotion de la réduction des risques. À n’en pas douter, comme dans le cas de la formation d’autres politiques publiques, les associations de « victimes » de ces usages et usagers auront un rôle plus important dans l’élaboration de l’action publique si pareille tendance venait à s’affirmer, comme ce fut le cas en France lors du vote de la loi sur les stupéfiants au volant en 2003 (loi dite Marilou, du nom de l’association créée par les parents d’une victime d’un accident de la route où le conducteur d’un des véhicules avait été testé positif au cannabis). Médicalisation, souci de sécurité sanitaire et contrôle de l’espace public, voilà les trois axes de développement de la régulation politique et du contrôle social de l’usage de drogues.















 ). Le but est, d’une part, de prendre en considération la relation qu’entretient la personne avec le produit, et, d’autre part, de donner la priorité à l’intervention des professionnels du réseau sanitaire.
). Le but est, d’une part, de prendre en considération la relation qu’entretient la personne avec le produit, et, d’autre part, de donner la priorité à l’intervention des professionnels du réseau sanitaire.