Réduction des dommages associés à la consommation d’alcool
I. Consommations d’alcool : les risques, les dommages et leur environnement
2021
| ANALYSE |
7-
Marketing des produits alcoolisés
Marketing des industriels de l’alcool
Définition, contenu et cibles
 ),
le marketing « est un moyen d’action qu’utilisent les organisations
pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont
elles dépendent ». Comme toutes les entreprises, les producteurs
d’alcool mobilisent le marketing pour créer de la valeur aux yeux
des consommateurs et les attirer vers leurs produits et leurs
marques. Différentes techniques sont déployées pour atteindre ces
objectifs : des campagnes publicitaires, des produits et packagings
attractifs, des publicités dans les points de vente et de
consommation (bars, etc.), du sponsoring d’événements culturels et
sportifs, une présence des marques sur internet et sur les réseaux
sociaux, un placement de produits alcoolisés dans les films et les
séries, etc. (Inserm, 2014
),
le marketing « est un moyen d’action qu’utilisent les organisations
pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont
elles dépendent ». Comme toutes les entreprises, les producteurs
d’alcool mobilisent le marketing pour créer de la valeur aux yeux
des consommateurs et les attirer vers leurs produits et leurs
marques. Différentes techniques sont déployées pour atteindre ces
objectifs : des campagnes publicitaires, des produits et packagings
attractifs, des publicités dans les points de vente et de
consommation (bars, etc.), du sponsoring d’événements culturels et
sportifs, une présence des marques sur internet et sur les réseaux
sociaux, un placement de produits alcoolisés dans les films et les
séries, etc. (Inserm, 2014 ).
). détaille les
principaux outils marketing (traditionnellement nommés les 4 « P »)
mobilisés par les producteurs d’alcool et les illustre par des
exemples observés sur le marché français.
détaille les
principaux outils marketing (traditionnellement nommés les 4 « P »)
mobilisés par les producteurs d’alcool et les illustre par des
exemples observés sur le marché français.Tableau 7.I Marketing des boissons alcooliques : définitions et exemples
|
Outils marketing
|
Définition, description
|
Exemples – illustrations
(France)*
|
|
Le « P »
PRODUIT
|
Concevoir un produit susceptible de
plaire à la cible à atteindre pour l’inciter à
acheter.
|
 Produits conçus pour des
jeunes : whisky William Peel au goût
cola dans un emballage format « compote à boire », rhum Saint James mojito fraise et « impérial », bière Belzebuth pink framboise (2,8°) ou blanche (4,5°), vins Sucette rosé (goût mandarine) et rouge (goût cola) |
|
Les composants du P « produit » sont le
goût, le nom, le packaging, le format du
contenant, le degré d’alcool, etc.
|
 Produits conçus pour des
femmes : teintes roses, produits
aromatisés, référence à l’univers de la mode (nom de marque « Gloss », coffret champagne rouge à lèvres) |
|
|
Ces différents éléments sont adaptés à
la cible visée (les jeunes, les femmes,
etc.).
|
 Produits aux degrés d’alcool variés
pour toucher différentes
cibles : bière Koenigsbier (marque premier prix de Carrefour**) disponible à 4,2° (en 33 ou 50 cl), à 7° ou à 10°  Produits à faible teneur en alcool, 0°
et « light » (moins de
calories) proposés comme une alternative à l’alcool dans certaines situations (grossesse, conduite, etc.), pour ne pas perdre le lien avec les consommateurs et pour cibler les femmes. |
|
|
Le « P »
PRIX
|
Proposer des prix adaptés au budget de
la cible visée, en lien avec l’image et le
positionnement souhaités pour le produit (par
exemple : un prix élevé pour une meilleure image
de marque).
|

Prix bas pour cibler les jeunes : produits
vendus à l’unité ou
en petit conditionnement : 50 cl de bière Blonde : 50 centimes d’euros, 20 cl de vodka Poliakov : 4,49 euros |
|
La politique de prix consiste à
réfléchir au « bon » prix, à proposer des
promotions (magasins, sites de vente en ligne,
bons de réduction sur l’emballage,
etc.).
|
 
Promotions sur les prix dans les grandes
surfaces, sur le
packaging, sur internet, Tweet promotionnel foire aux vins*** |
|
|
Le « P »
PLACE
|
Faciliter l’accès et la
disponibilité du produit dans de nombreux endroits. |
Vente de boissons
alcoolisées :
1/ dans de nombreux points de vente
(supérettes, hypermarchés, supermarchés, etc.) et
dans les magasins aux horaires d’ouverture
larges ;
2/ sur internet (nicolas.com,
lepetitballon.com, Ventealapropriete.com,
etc.) ;
3/ dans des festivals de musique, lors
d’événements sportifs, etc. ;
4/ livraison à domicile pour « aller »
vers les consommateurs (www.aperoflashrennes.com,
www.aperocube.fr, etc.)
|
|
(ACCÈS)
|
Valoriser la
présentation de la marque dans les lieux de vente pour faciliter et inciter à l’acte d’achat (merchandising). |
|
|
Le « P »
PUBLICITÉ
|
Rendre le produit/la marque
attractif/ve, augmenter sa notoriété et donner
envie d’acheter grâce à la publicité (en
sélectionnant les médias et les contenus de
publicité les plus pertinents par rapport à la
cible).
Supports publicitaires protéiformes :
affichage, presse, internet, sponsoring, placement
de produit dans les films, mécénat, publicité sur
le lieu de vente, etc.
|
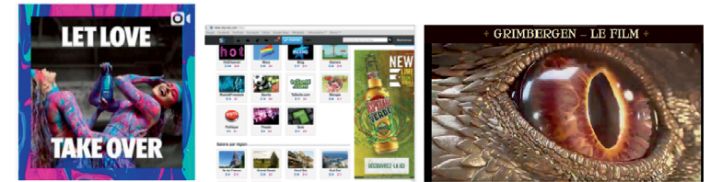  Page Instagram Absolut vodka, bannière
publicitaire Desperado sur Skyrock, spot vidéo
Grimbergen sur internet, publicité pour la bière
et la vodka dans des magazines et dans la rue,
sponsoring Kronenbourg, publicité Skoll dans les
magasins
|
* Pour d’autres exemples, voir les fiches
décryptages de l’ANPAA sur le marketing de l’alcool (https://www.anpaa.asso.fr/sinformer/dossier-loi-evin/decryptage-loi-evin),
et le Flash Alcoolator d’Avenir Santé (https://www.avenir-sante.com/2019/flash-alcoolator-janvier-2019/)
(consultés le 3 avril 2020).
** https://www.bcmelaboiteboisson.com/news_boite/une-nouvelle-recette-de-biere-plus-forte-que-forte/1664
(consulté le 3 avril 2020).
*** https://twitter.com/Monoprix/status/1039393100895055873
(consulté le 3 avril 2020).
 sont une forme de « concurrence » aux
acteurs de la santé publique, dans le sens où ils influencent
positivement les représentations et l’envie de boire de l’alcool et,
dans le même temps, ils contrecarrent les campagnes de prévention
menées pour réduire la consommation de ce produit (Gallopel-Morvan,
2018
sont une forme de « concurrence » aux
acteurs de la santé publique, dans le sens où ils influencent
positivement les représentations et l’envie de boire de l’alcool et,
dans le même temps, ils contrecarrent les campagnes de prévention
menées pour réduire la consommation de ce produit (Gallopel-Morvan,
2018 ).
). ).
).|
Encadré 7.1 : Investissements publicitaires des producteurs d’alcool en France en 2016, 2017 et 2018 (Source : pige Kantar Média 2018 réalisée pour Santé publique France) Une pige des investissements publicitaires des alcooliers
a été réalisée par Kantar Média pour Santé publique France.
Cette technique consiste à recenser les publicités diffusées
dans les médias et à les valoriser financièrement à partir des
coûts des achats d’espace commerciaux. Cela permet d’évaluer le
montant des investissements publicitaires des annonceurs
pigés.
Les médias retenus dans l’observatoire des marques
d’alcool en France étaient la télévision (plus de 80 chaînes,
spots et parrainage), la radio (29 stations), la presse (plus de
900 titres), la publicité extérieure des principaux afficheurs
(Moohnitor, Clear Channel, Médiatransports, etc.), le cinéma (2
régies) et l’internet display (achat d’espace
publicitaire sur internet de type bannières, pop-up. Pige sur
plus de 600 sites). La pige ne prenait pas en compte le contenu
des messages recensés, les publicités sur les réseaux sociaux
hors display, la VOL (vidéo en ligne) ni l’achat
programmatique (publicités ciblées). Précisons également que les
investissements relatifs à l’année 2018 ne concernent qu’une
partie de l’année (janvier-août).
En 2016, 2017 et 2018, les budgets publicitaires des
alcooliers sont estimés respectivement à 454,6 ; 369,2 et
208,5 millions d’euros.
La baisse constatée depuis 2016 s’explique certainement
par un report des investissements des formats publicitaires
« classiques » vers des supports interactifs et digitaux qui ont
fait l’objet d’une forte croissance publicitaire en France ces
dernières années, mais qui ont été peu intégrés dans cet
observatoire.
La majorité des budgets publicitaires des alcooliers est
consacrée à l’achat d’espace dans la presse et à l’affichage
extérieur. La télévision et le cinéma sont absents des médias
observés, très certainement du fait de la loi Évin qui en
interdit l’accès pour les boissons alcooliques. Deux pics
d’investissements sont constatés tous les ans à la période
estivale et à Noël, et un pic a été observé en 2016 lors de la
coupe d’Europe de football qui a eu lieu en France.
Les catégories et marques d’alcool les plus présentes sur
ces 3 ans dans les médias pigés sont :
1. La bière, avec 124 919 euros estimés en 2017 (Heineken
est leader, suivi par Kronenbourg, Ab Inv – Cubanisto, Corona,
Leffe entre autres –, Bavaria et Karlsbrau). L’affichage est le
média le plus utilisé.
2. Les vins, avec 74 973 euros estimés en 2017 (Castel
frères est leader suivi du syndicat des producteurs de vin de
pays d’Oc, du conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux,
des domaines viticoles salins du midi et du groupe Bernard
Magrez). La presse est le média le plus utilisé.
3. Le champagne, avec 48 420 euros estimés en 2017 (Moet
Hennessy est leader suivi par Laurent Perrier, Kriter, Pernod et
Vranken Pommery monopole). La presse est le média le plus
utilisé.
Enfin, 33 % des investissements totaux de 2017 ont été
réalisés par trois entreprises : Heineken (no 1),
Kronenbourg (no 2) et la Martiniquaise
(no 3 ; Label 5, Poliakov, Saint James, Porto Cruz,
etc.).
|
 ).
Pour pouvoir estimer l’ensemble des dépenses marketing de l’alcool
en France, il faudrait ajouter les éléments suivants :
).
Pour pouvoir estimer l’ensemble des dépenses marketing de l’alcool
en France, il faudrait ajouter les éléments suivants : ) ;
) ; ; Rouzet et Seguin,
2017
; Rouzet et Seguin,
2017 ) : l’innovation produits, les
bouteilles « éditions limitées », marques, la segmentation,
les études de marché pour mieux comprendre les
consommateurs, le marketing territorial, les politiques de
prix, de promotions et de distribution, les boutiques
éphémères, l’e-commerce, le big data (la constitution
de base de données des consommateurs afin d’envoyer des
messages commerciaux personnalisés), les nouvelles
technologies, l’œnotourisme, le merchandising, la
vente, le trade-marketing, category
management, les partenariats, relations publiques, le
street marketing, etc.2
;
) : l’innovation produits, les
bouteilles « éditions limitées », marques, la segmentation,
les études de marché pour mieux comprendre les
consommateurs, le marketing territorial, les politiques de
prix, de promotions et de distribution, les boutiques
éphémères, l’e-commerce, le big data (la constitution
de base de données des consommateurs afin d’envoyer des
messages commerciaux personnalisés), les nouvelles
technologies, l’œnotourisme, le merchandising, la
vente, le trade-marketing, category
management, les partenariats, relations publiques, le
street marketing, etc.2
; ; Mejia et coll.,
2019
; Mejia et coll.,
2019 ) : les messages pro-alcool émis
par des internautes sur les réseaux sociaux (cf.
infra, section « Formes, exposition et effet de
la présence des marques et des produits alcoolisés sur
internet et les réseaux sociaux » de ce chapitre), les
marques visibles dans les films, les séries, les clips
musicaux, etc. Concernant la France, une étude a montré que
les jeunes sont particulièrement exposés à l’alcool dans les
productions télévisées : sur les 14 séries les plus
regardées par des jeunes (8 séries françaises et 6
américaines, pour un total de 180 épisodes visionnés),
l’alcool apparaît dans 87,8 % des épisodes et pendant
7 heures 29 minutes au total (plus souvent dans des séries
françaises qu’américaines). Dans les séries françaises en
particulier, le vin est particulièrement visible à l’écran
(Chapoton et coll., 2019
) : les messages pro-alcool émis
par des internautes sur les réseaux sociaux (cf.
infra, section « Formes, exposition et effet de
la présence des marques et des produits alcoolisés sur
internet et les réseaux sociaux » de ce chapitre), les
marques visibles dans les films, les séries, les clips
musicaux, etc. Concernant la France, une étude a montré que
les jeunes sont particulièrement exposés à l’alcool dans les
productions télévisées : sur les 14 séries les plus
regardées par des jeunes (8 séries françaises et 6
américaines, pour un total de 180 épisodes visionnés),
l’alcool apparaît dans 87,8 % des épisodes et pendant
7 heures 29 minutes au total (plus souvent dans des séries
françaises qu’américaines). Dans les séries françaises en
particulier, le vin est particulièrement visible à l’écran
(Chapoton et coll., 2019 ).
). et les
témoignages de directeurs marketing, de managers, de chercheurs ou
de consultants spécialistes en marketing de l’alcool. Des stratégies
sont ainsi réfléchies pour attirer les jeunes vers le vin : « la
principale difficulté lorsque l’on cherche à cibler les plus jeunes
consiste à démystifier le vin, pour que ce dernier s’intègre peu à
peu dans leur vie quotidienne, qu’ils soient à l’aise avec ce
produit, pour qu’ils le perçoivent comme attractif et ainsi de
suite » (Gallo et Charters, 2014
et les
témoignages de directeurs marketing, de managers, de chercheurs ou
de consultants spécialistes en marketing de l’alcool. Des stratégies
sont ainsi réfléchies pour attirer les jeunes vers le vin : « la
principale difficulté lorsque l’on cherche à cibler les plus jeunes
consiste à démystifier le vin, pour que ce dernier s’intègre peu à
peu dans leur vie quotidienne, qu’ils soient à l’aise avec ce
produit, pour qu’ils le perçoivent comme attractif et ainsi de
suite » (Gallo et Charters, 2014 ). Des produits spécifiques sont également
conçus pour eux : « le vin aromatisé permet de sensibiliser de
nouveaux consommateurs au vin. Pour les jeunes, c’est une boisson
qui aide à faire la transition entre les boissons non-alcoolisées et
les autres que boivent les adultes »3
(interview de la directrice du développement de
Larraqué Vins International). Dans l’idée de transition, des
recettes de cocktails alcoolisés avec des jus de fruit et/ou des
sodas sont suggérées par les marques4
comme mode de consommation pour les jeunes adeptes
des mélanges.
). Des produits spécifiques sont également
conçus pour eux : « le vin aromatisé permet de sensibiliser de
nouveaux consommateurs au vin. Pour les jeunes, c’est une boisson
qui aide à faire la transition entre les boissons non-alcoolisées et
les autres que boivent les adultes »3
(interview de la directrice du développement de
Larraqué Vins International). Dans l’idée de transition, des
recettes de cocktails alcoolisés avec des jus de fruit et/ou des
sodas sont suggérées par les marques4
comme mode de consommation pour les jeunes adeptes
des mélanges. ; Johnston,
2015
; Johnston,
2015 ). Un
marketing spécifique est mis en place pour attirer les femmes
(Atkinson et coll., 2019
). Un
marketing spécifique est mis en place pour attirer les femmes
(Atkinson et coll., 2019 ) qui se distinguent des hommes sur le goût
(par exemple les femmes ont plus tendance que les hommes à boire du
vin blanc et pétillant : Bruwer et coll.,
2011
) qui se distinguent des hommes sur le goût
(par exemple les femmes ont plus tendance que les hommes à boire du
vin blanc et pétillant : Bruwer et coll.,
2011 ;
Rodríguez-Donate et coll., 2019
;
Rodríguez-Donate et coll., 2019 ), l’odorat des produits alcoolisés, la
quantité consommée, les motivations à consommer (la socialisation,
l’image, réduire l’anxiété, etc.), les lieux d’approvisionnement
(Atkin et coll., 2007
), l’odorat des produits alcoolisés, la
quantité consommée, les motivations à consommer (la socialisation,
l’image, réduire l’anxiété, etc.), les lieux d’approvisionnement
(Atkin et coll., 2007 ), etc. Par ailleurs, les femmes consomment
aujourd’hui moins d’alcool que les hommes, et représentent donc un
potentiel de marché important à développer (Dutch Institute for
Alcohol Policy, 2012
), etc. Par ailleurs, les femmes consomment
aujourd’hui moins d’alcool que les hommes, et représentent donc un
potentiel de marché important à développer (Dutch Institute for
Alcohol Policy, 2012 ).
). ).
Concernant les produits aromatisés, Annick Vincenty, directrice
marketing de Heineken France en 2014, explique à propos des femmes
qu’« elles sont notre cible prioritaire pour des nouveaux produits
comme la gamme Radler, vendue sous la marque Pelforth et déclinée au
citron, au pamplemousse rose »7
.
).
Concernant les produits aromatisés, Annick Vincenty, directrice
marketing de Heineken France en 2014, explique à propos des femmes
qu’« elles sont notre cible prioritaire pour des nouveaux produits
comme la gamme Radler, vendue sous la marque Pelforth et déclinée au
citron, au pamplemousse rose »7
. ), à
l’association SAF France qui lutte contre les troubles liés à
l’alcoolisation fœtale9
(alors que l’industrie crée de la confusion sur ce
problème sur leurs sites internet ; Lim et coll., 2019
), à
l’association SAF France qui lutte contre les troubles liés à
l’alcoolisation fœtale9
(alors que l’industrie crée de la confusion sur ce
problème sur leurs sites internet ; Lim et coll., 2019 ) ou encore à
la journée internationale des femmes en 2019 et 2020 (partenariat
avec Diageo10
) en sont des illustrations. Mart et Giesbrecht
(2015
) ou encore à
la journée internationale des femmes en 2019 et 2020 (partenariat
avec Diageo10
) en sont des illustrations. Mart et Giesbrecht
(2015 )
parlent ici du « pinkwashing » des compagnies d’alcool.
)
parlent ici du « pinkwashing » des compagnies d’alcool.Effets du marketing et de la publicité pour les
marques d’alcool
sur les incitations à consommer des
individus
 ;
Smith et Foxcroft, 2009
;
Smith et Foxcroft, 2009 ; Jernigan et coll.,
2017a
; Jernigan et coll.,
2017a .
. ) ont synthétisé les résultats de 13 études
longitudinales menées aux États-Unis, en Allemagne, en
Nouvelle-Zélande ou en Belgique, portant au total sur plus de 38 000
jeunes. Ces recherches analysent l’association entre l’exposition à
la publicité sur l’alcool dans les médias (télévision, presse,
affichages publicitaires, radio), la promotion d’alcool puis les
comportements déclarés d’alcoolisation chez les jeunes. Douze études
sur les 13 font état d’un lien significatif et positif entre
l’exposition à la publicité et l’initiation de la consommation
d’alcool d’adolescents non buveurs d’une part, puis l’augmentation
de la consommation de jeunes déjà buveurs d’autre part. Ainsi plus
l’exposition publicitaire est importante plus la consommation
d’alcool est élevée. La treizième étude montre que les panneaux
publicitaires de marques d’alcool situés à moins de 450 mètres
d’établissements scolaires favorisent les intentions de
consommation.
) ont synthétisé les résultats de 13 études
longitudinales menées aux États-Unis, en Allemagne, en
Nouvelle-Zélande ou en Belgique, portant au total sur plus de 38 000
jeunes. Ces recherches analysent l’association entre l’exposition à
la publicité sur l’alcool dans les médias (télévision, presse,
affichages publicitaires, radio), la promotion d’alcool puis les
comportements déclarés d’alcoolisation chez les jeunes. Douze études
sur les 13 font état d’un lien significatif et positif entre
l’exposition à la publicité et l’initiation de la consommation
d’alcool d’adolescents non buveurs d’une part, puis l’augmentation
de la consommation de jeunes déjà buveurs d’autre part. Ainsi plus
l’exposition publicitaire est importante plus la consommation
d’alcool est élevée. La treizième étude montre que les panneaux
publicitaires de marques d’alcool situés à moins de 450 mètres
d’établissements scolaires favorisent les intentions de
consommation. ) ont, de la même façon, mené une revue
systématique afin d’évaluer si l’exposition à la publicité et au
marketing de l’alcool augmente la consommation d’alcool chez les
jeunes. Les critères d’inclusion étaient les suivants : des études
longitudinales, des supports publicitaires variés étudiés
(télévision, radio, journaux, affichages, t-shirts avec marques
d’alcool, représentation de l’alcool dans les films, dans les
programmes télévisés et spots musicaux, événements sportifs, etc.),
une mesure de la consommation d’alcool des jeunes interrogés
(quantité, fréquence, marque ou type d’alcool consommés). Au total,
9 articles (7 cohortes différentes aux États-Unis, en Belgique, en
Nouvelle-Zélande) correspondaient aux critères d’inclusion, soit
13 255 jeunes de 10 à 26 ans interrogés sur une période allant de
1 an à 30 mois, ont été intégrés dans cette synthèse. Les résultats
révèlent, pour les 9 articles, une association significative et
positive entre l’exposition au marketing et à la publicité des
marques d’alcool puis les comportements d’alcoolisation. En
particulier, 3 études montrent un lien significatif entre
l’initiation à l’alcool de jeunes non buveurs et leur exposition au
marketing et à la publicité.
) ont, de la même façon, mené une revue
systématique afin d’évaluer si l’exposition à la publicité et au
marketing de l’alcool augmente la consommation d’alcool chez les
jeunes. Les critères d’inclusion étaient les suivants : des études
longitudinales, des supports publicitaires variés étudiés
(télévision, radio, journaux, affichages, t-shirts avec marques
d’alcool, représentation de l’alcool dans les films, dans les
programmes télévisés et spots musicaux, événements sportifs, etc.),
une mesure de la consommation d’alcool des jeunes interrogés
(quantité, fréquence, marque ou type d’alcool consommés). Au total,
9 articles (7 cohortes différentes aux États-Unis, en Belgique, en
Nouvelle-Zélande) correspondaient aux critères d’inclusion, soit
13 255 jeunes de 10 à 26 ans interrogés sur une période allant de
1 an à 30 mois, ont été intégrés dans cette synthèse. Les résultats
révèlent, pour les 9 articles, une association significative et
positive entre l’exposition au marketing et à la publicité des
marques d’alcool puis les comportements d’alcoolisation. En
particulier, 3 études montrent un lien significatif entre
l’initiation à l’alcool de jeunes non buveurs et leur exposition au
marketing et à la publicité. )
recensant les études longitudinales publiées entre 2008 et 2016. Les
facteurs d’inclusion étaient les suivants : dans l’abstract
ou le titre, « association, publicité pour l’alcool, consommation
des jeunes » devaient être mentionnées ; des mesures valides de la
consommation d’alcool devaient avoir été utilisées au début et au
cours de l’étude (initiation à la consommation d’alcool,
comportement de binge-drinking, consommation, fréquence et
quantité absorbée au cours des 30 derniers jours, problème
rencontrés liés à l’alcool) et passées sur au moins 500 participants
dont l’âge était inférieur à l’âge légal d’achat d’alcool dans le
pays. Les études qui évaluaient seulement les intentions de
consommer de l’alcool n’ont pas été intégrées dans cette synthèse.
Au total, les auteurs ont retenu 12 recherches publiées dans des
revues scientifiques, soit un total de 35 219 jeunes interrogés dans
sept pays différents (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne,
Grande-Bretagne – dont Écosse, Taïwan, États-Unis). Les formes de
marketing étudiées différaient selon les études : l’affichage, les
publicités dans les magazines, à la radio et à la télévision, sur
les réseaux sociaux et sur internet (quand ces dispositifs digitaux
étaient conçus par les producteurs d’alcool), le placement des
marques d’alcool dans les films, séries et clips, publicités dans
les magasins, les promotions sur le prix, les cadeaux promotionnels,
le packaging, l’association avec des célébrités, le sponsoring
d’événements sportifs et musicaux, etc. Afin d’évaluer le niveau
d’exposition à ce marketing, les répondants déclaraient leur
perception de l’exposition au marketing de l’alcool et/ou la
mémorisation de publicités pour l’alcool et/ou l’appréciation de ces
publicités et/ou l’engagement dans les activités marketing des
marques d’alcool sur internet (inscription sur un site, etc.) et/ou
des mesures populationnelles de l’exposition à la publicité
réalisées par des sociétés d’études de marché (à partir des
audiences des médias). Les 12 études recensées montrent toutes un
lien positif et significatif entre l’exposition au marketing et à la
publicité pour des produits alcooliques, les comportements
d’alcoolisation déclarés pendant la période d’observation (entre
9 mois et 8 ans selon les articles) et les problèmes vécus liés à la
consommation d’alcool.
)
recensant les études longitudinales publiées entre 2008 et 2016. Les
facteurs d’inclusion étaient les suivants : dans l’abstract
ou le titre, « association, publicité pour l’alcool, consommation
des jeunes » devaient être mentionnées ; des mesures valides de la
consommation d’alcool devaient avoir été utilisées au début et au
cours de l’étude (initiation à la consommation d’alcool,
comportement de binge-drinking, consommation, fréquence et
quantité absorbée au cours des 30 derniers jours, problème
rencontrés liés à l’alcool) et passées sur au moins 500 participants
dont l’âge était inférieur à l’âge légal d’achat d’alcool dans le
pays. Les études qui évaluaient seulement les intentions de
consommer de l’alcool n’ont pas été intégrées dans cette synthèse.
Au total, les auteurs ont retenu 12 recherches publiées dans des
revues scientifiques, soit un total de 35 219 jeunes interrogés dans
sept pays différents (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne,
Grande-Bretagne – dont Écosse, Taïwan, États-Unis). Les formes de
marketing étudiées différaient selon les études : l’affichage, les
publicités dans les magazines, à la radio et à la télévision, sur
les réseaux sociaux et sur internet (quand ces dispositifs digitaux
étaient conçus par les producteurs d’alcool), le placement des
marques d’alcool dans les films, séries et clips, publicités dans
les magasins, les promotions sur le prix, les cadeaux promotionnels,
le packaging, l’association avec des célébrités, le sponsoring
d’événements sportifs et musicaux, etc. Afin d’évaluer le niveau
d’exposition à ce marketing, les répondants déclaraient leur
perception de l’exposition au marketing de l’alcool et/ou la
mémorisation de publicités pour l’alcool et/ou l’appréciation de ces
publicités et/ou l’engagement dans les activités marketing des
marques d’alcool sur internet (inscription sur un site, etc.) et/ou
des mesures populationnelles de l’exposition à la publicité
réalisées par des sociétés d’études de marché (à partir des
audiences des médias). Les 12 études recensées montrent toutes un
lien positif et significatif entre l’exposition au marketing et à la
publicité pour des produits alcooliques, les comportements
d’alcoolisation déclarés pendant la période d’observation (entre
9 mois et 8 ans selon les articles) et les problèmes vécus liés à la
consommation d’alcool.Dispositifs de protection des populations
vulnérables au marketing
et à la publicité pour les marques
d’alcool
 ;
Maani Hessari et coll., 2019
;
Maani Hessari et coll., 2019 ). En conséquence et afin de protéger les
mineurs, les acteurs de la santé recommandent de réguler les
pratiques commerciales des producteurs d’alcool (Cour des comptes,
2016
). En conséquence et afin de protéger les
mineurs, les acteurs de la santé recommandent de réguler les
pratiques commerciales des producteurs d’alcool (Cour des comptes,
2016 ;
Pan American Health Organization PAHO,
2017
;
Pan American Health Organization PAHO,
2017 ;
Santé publique France, 2017
;
Santé publique France, 2017 ; Mildeca,
2018
; Mildeca,
2018 ;
WHO, 2018
;
WHO, 2018 ;
WHO Europe, 2019
;
WHO Europe, 2019 ...), et en particulier la restriction de
l’accès à certains médias et la régulation des créations
publicitaires. De telles mesures sont jugées coût-efficaces et
bénéfiques pour la santé publique car d’une part, la littérature a
montré l’effet de la publicité sur les jeunes et d’autre part, elles
ne coûtent rien aux gouvernements (Anderson et coll.,
2009a
...), et en particulier la restriction de
l’accès à certains médias et la régulation des créations
publicitaires. De telles mesures sont jugées coût-efficaces et
bénéfiques pour la santé publique car d’une part, la littérature a
montré l’effet de la publicité sur les jeunes et d’autre part, elles
ne coûtent rien aux gouvernements (Anderson et coll.,
2009a ;
Burton et coll., 2017
;
Burton et coll., 2017 ; Siegfried et Parry,
2019
; Siegfried et Parry,
2019 ).
). ).
). ;
Mosher, 2012
;
Mosher, 2012 ; Babor et coll., 2013a
; Babor et coll., 2013a ; Babor et coll.,
2013b
; Babor et coll.,
2013b ;
Noel et coll., 2017
;
Noel et coll., 2017 ; Noel et Babor,
2017
; Noel et Babor,
2017 ;
Vendrame, 2017
;
Vendrame, 2017 ; Lloyd et coll., 2018
; Lloyd et coll., 2018 ; Pierce et coll.,
2019
; Pierce et coll.,
2019 ). En
effet, ces études menées dans différents pays montrent qu’en dépit
de l’augmentation du nombre de codes de bonne conduite émanant des
alcooliers, l’exposition des jeunes à la publicité et au marketing
des produits alcooliques ne cesse de croître. De plus, étant donné
que les producteurs d’alcool choisissent les médias à audience
élevée (télévision, affichage dans la rue, magazines, radio, médias
digitaux, etc.) pour diffuser leurs publicités, les jeunes, qui font
partie de cette audience, y sont alors exposés. Enfin, ces
recherches sur l’autorégulation mettent en lumière que les contenus
de certaines publicités ne respectent pas les chartes de la
profession. Alors que certains thèmes très attractifs pour les
mineurs sont déconseillés par la filière alcool, ils sont pourtant
utilisés dans les messages commerciaux : l’humour, des personnages
de bande dessinée, l’amitié, la masculinité, la relaxation, le
sport, le succès sexuel, etc.
). En
effet, ces études menées dans différents pays montrent qu’en dépit
de l’augmentation du nombre de codes de bonne conduite émanant des
alcooliers, l’exposition des jeunes à la publicité et au marketing
des produits alcooliques ne cesse de croître. De plus, étant donné
que les producteurs d’alcool choisissent les médias à audience
élevée (télévision, affichage dans la rue, magazines, radio, médias
digitaux, etc.) pour diffuser leurs publicités, les jeunes, qui font
partie de cette audience, y sont alors exposés. Enfin, ces
recherches sur l’autorégulation mettent en lumière que les contenus
de certaines publicités ne respectent pas les chartes de la
profession. Alors que certains thèmes très attractifs pour les
mineurs sont déconseillés par la filière alcool, ils sont pourtant
utilisés dans les messages commerciaux : l’humour, des personnages
de bande dessinée, l’amitié, la masculinité, la relaxation, le
sport, le succès sexuel, etc. ) ont étudié l’impact, sur la consommation
d’alcool, des facteurs socio-économiques (niveau des revenus, taux
d’emploi des femmes, etc.) et de différentes mesures introduites en
France après 1970 (interdiction de la vente d’alcool aux moins de
16 ans, restrictions sur la publicité – loi Évin –, limitation
légale de l’alcoolémie à 0,5 g/l pour les conducteurs). Les auteurs
concluent qu’en comparaison avec les facteurs socio-économiques, les
mesures politiques ne semblent pas avoir eu d’impact majeur sur la
baisse de la consommation d’alcool. Toutefois, l’interdiction de la
vente d’alcool aux mineurs combinée aux restrictions publicitaires
prévues par la loi Évin auraient contribué à une baisse de la
consommation d’alcool sur le long terme.
) ont étudié l’impact, sur la consommation
d’alcool, des facteurs socio-économiques (niveau des revenus, taux
d’emploi des femmes, etc.) et de différentes mesures introduites en
France après 1970 (interdiction de la vente d’alcool aux moins de
16 ans, restrictions sur la publicité – loi Évin –, limitation
légale de l’alcoolémie à 0,5 g/l pour les conducteurs). Les auteurs
concluent qu’en comparaison avec les facteurs socio-économiques, les
mesures politiques ne semblent pas avoir eu d’impact majeur sur la
baisse de la consommation d’alcool. Toutefois, l’interdiction de la
vente d’alcool aux mineurs combinée aux restrictions publicitaires
prévues par la loi Évin auraient contribué à une baisse de la
consommation d’alcool sur le long terme.|
Encadré 7.2 : La loi Évin relative aux publicités pour les produits alcoolisés La loi Évin, qui s’applique à toutes boissons dont le
degré alcoolique est supérieur à 1,2 %, impose trois mesures
concernant la publicité :
1. Régulation des médias : l’esprit de la loi est
d’interdire la publicité en faveur de l’alcool dans les médias
ciblant les jeunes et d’autoriser les médias moins intrusifs.
Les supports autorisés pour promouvoir les boissons alcooliques
sont précisés : la presse écrite adulte, la radio (entre 12 h et
17 h les jours de semaine, entre minuit et 7 h le mercredi), les
affichages et enseignes, les publicités en ligne (internet et
applications, sauf lorsque les jeunes sont ciblés et sous
réserve que la publicité ne soit pas intrusive), les affichettes
et objets à l’intérieur des points de vente et magasins (la
dimension d’une affichette publicitaire ne peut dépasser
0,35 mètre carré) et lors de dégustations (foires aux vins,
etc.), les brochures et mailings commerciaux, les affiches sur
les véhicules utilisés pour les opérations de livraison des
boissons alcoolisées, les événements spéciaux (foires
traditionnelles, etc.), les musées du vin, les cadeaux/objets
utilisés pour consommer de l’alcool (verres, etc.). Les supports
de communication non listés dans la loi Évin sont interdits :
télévision, cinéma, sponsoring d’événements sportifs et
culturels, placement de marques d’alcool dans les films, sur les
T-shirts, casquettes, etc.
2. Régulation du contenu publicitaire : dans les cas où
la publicité est autorisée, les informations diffusées doivent
se limiter à des données informatives/factuelles et à des
critères de qualité objectifs sur le produit (degré alcoolique,
origine, composition et modes d’élaboration). Par conséquent,
les publicités attrayantes véhiculant des images et/ou des
textes évocateurs positifs associant l’alcool au plaisir, au
glamour, au succès social, au sport, au sexe, à la réussite, à
des leaders d’opinion, etc., ne sont pas autorisées.
3. Obligation d’information : toutes les publicités en
faveur de l’alcool doivent obligatoirement être assorties du
message sanitaire « l’abus d’alcool est dangereux pour la
santé »49.
|
 ) ont analysé l’exposition des mineurs
français à la publicité des produits alcooliques. 6 642 lycéens ont
été interrogés en 2015 dans le cadre de l’enquête ESPAD (European
School Survey Project on Alcohol and other Drugs) dans 198
établissements scolaires par le biais d’un questionnaire
auto-administré (moyenne d’âge : 17,3 ans, échantillon
représentatif). Les résultats révèlent qu’une majorité des élèves
déclare avoir été exposée au moins une fois par mois à des
publicités ou présentations promotionnelles en faveur de l’alcool
dans les supermarchés (73,2 %), dans les films (66,1 %), dans les
magazines et les journaux (59,1 %), sur les affiches dans la rue
(54,5 %) et sur internet (54,1 %). Concernant la dernière publicité
dont ils se souviennent, 27,8 % se rappellent du type de boisson,
18,2 % de la marque, 13 % ont eu envie de consommer une boisson
alcoolisée après l’avoir vue et 19,6 % l’ont trouvée attrayante (les
garçons étant nettement plus représentés que les filles sur tous ces
indicateurs). Dans le prolongement de cette étude, l’OFDT a mené une
enquête auprès de 10 591 Français âgés de 17 ans (Mutatayi et
Spilka, 2019
) ont analysé l’exposition des mineurs
français à la publicité des produits alcooliques. 6 642 lycéens ont
été interrogés en 2015 dans le cadre de l’enquête ESPAD (European
School Survey Project on Alcohol and other Drugs) dans 198
établissements scolaires par le biais d’un questionnaire
auto-administré (moyenne d’âge : 17,3 ans, échantillon
représentatif). Les résultats révèlent qu’une majorité des élèves
déclare avoir été exposée au moins une fois par mois à des
publicités ou présentations promotionnelles en faveur de l’alcool
dans les supermarchés (73,2 %), dans les films (66,1 %), dans les
magazines et les journaux (59,1 %), sur les affiches dans la rue
(54,5 %) et sur internet (54,1 %). Concernant la dernière publicité
dont ils se souviennent, 27,8 % se rappellent du type de boisson,
18,2 % de la marque, 13 % ont eu envie de consommer une boisson
alcoolisée après l’avoir vue et 19,6 % l’ont trouvée attrayante (les
garçons étant nettement plus représentés que les filles sur tous ces
indicateurs). Dans le prolongement de cette étude, l’OFDT a mené une
enquête auprès de 10 591 Français âgés de 17 ans (Mutatayi et
Spilka, 2019 ). Elle révèle que ces jeunes déclarent avoir été exposés une fois
par semaine à tous les jours à des publicités pour l’alcool pour
30,7 % d’entre eux sur internet, 30,2 % à la télévision
(probablement via la publicité pour des marques sans alcool
ou via la télévision regardée sur internet), 25 % dans les
films et les séries, 24 % sur des affiches dans la rue, 19,9 % dans
les supermarchés, 16,9 % dans les transports publics, 16,1 % dans
les magazines et les journaux, 11,8 % à la radio et 10,3 % lors d’un
événement sportif ou un concert.
). Elle révèle que ces jeunes déclarent avoir été exposés une fois
par semaine à tous les jours à des publicités pour l’alcool pour
30,7 % d’entre eux sur internet, 30,2 % à la télévision
(probablement via la publicité pour des marques sans alcool
ou via la télévision regardée sur internet), 25 % dans les
films et les séries, 24 % sur des affiches dans la rue, 19,9 % dans
les supermarchés, 16,9 % dans les transports publics, 16,1 % dans
les magazines et les journaux, 11,8 % à la radio et 10,3 % lors d’un
événement sportif ou un concert. ). La
justice condamne régulièrement des publicités en faveur de l’alcool
jugées illégales. Ainsi entre 1991 et 2019, l’Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) a engagé 97
actions judiciaires contre les producteurs d’alcool pour non-respect
de la loi Évin. Sur les 73 affaires définitivement jugées, elle en a
remporté 85 %. Par ailleurs, les observatoires des associations
Avenir Santé (le flash « alcoolator ») et de l’ANPAA (les fiches
« décryptages ») font régulièrement état de publicités qui ne
respectent pas la loi Évin sur internet, dans les festivals de
musique, de sport, sur le packaging, etc. Le contournement de la loi
porte sur les médias utilisés par les producteurs d’alcool alors
qu’ils sont interdits (sponsoring par exemple) et sur le contenu des
publicités et des packagings qui ne respecte pas les
caractéristiques autorisées par la loi (encadré 7.3). Le non-respect
de la législation concerne également « l’oubli » de la mention
obligatoire « l’abus d’alcool est dangereux » sur certaines
publicités.
). La
justice condamne régulièrement des publicités en faveur de l’alcool
jugées illégales. Ainsi entre 1991 et 2019, l’Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) a engagé 97
actions judiciaires contre les producteurs d’alcool pour non-respect
de la loi Évin. Sur les 73 affaires définitivement jugées, elle en a
remporté 85 %. Par ailleurs, les observatoires des associations
Avenir Santé (le flash « alcoolator ») et de l’ANPAA (les fiches
« décryptages ») font régulièrement état de publicités qui ne
respectent pas la loi Évin sur internet, dans les festivals de
musique, de sport, sur le packaging, etc. Le contournement de la loi
porte sur les médias utilisés par les producteurs d’alcool alors
qu’ils sont interdits (sponsoring par exemple) et sur le contenu des
publicités et des packagings qui ne respecte pas les
caractéristiques autorisées par la loi (encadré 7.3). Le non-respect
de la législation concerne également « l’oubli » de la mention
obligatoire « l’abus d’alcool est dangereux » sur certaines
publicités. ;
Benyamina et Samitier, 2017
;
Benyamina et Samitier, 2017 ; Benec’h,
2019
; Benec’h,
2019 ), ce
qui a eu pour conséquence d’affaiblir son impact. Ainsi deux médias
très puissants en termes d’audience, interdits en 1991, ont été de
nouveau autorisés au fil des années. Il s’agit de l’affichage qui
était seulement autorisé en 1991 près des lieux de production et de
vente d’alcool. Cette restriction a été levée en 1994. La publicité
est aujourd’hui autorisée en tout lieu (rues, métros, bus, etc.), ce
qui augmente l’exposition des plus jeunes aux campagnes
promotionnelles pour l’alcool. En 2009, sous la pression des
alcooliers, la loi Bachelot autorise la publicité en faveur de
l’alcool sur internet (à l’exception des sites dédiés aux sports et
qui ciblent la jeunesse), alors que ce média est très fréquenté par
les jeunes. En 2015, la loi Évin est une nouvelle fois assouplie,
malgré l’opposition forte des acteurs de la santé (Reynaud et coll.,
2015
), ce
qui a eu pour conséquence d’affaiblir son impact. Ainsi deux médias
très puissants en termes d’audience, interdits en 1991, ont été de
nouveau autorisés au fil des années. Il s’agit de l’affichage qui
était seulement autorisé en 1991 près des lieux de production et de
vente d’alcool. Cette restriction a été levée en 1994. La publicité
est aujourd’hui autorisée en tout lieu (rues, métros, bus, etc.), ce
qui augmente l’exposition des plus jeunes aux campagnes
promotionnelles pour l’alcool. En 2009, sous la pression des
alcooliers, la loi Bachelot autorise la publicité en faveur de
l’alcool sur internet (à l’exception des sites dédiés aux sports et
qui ciblent la jeunesse), alors que ce média est très fréquenté par
les jeunes. En 2015, la loi Évin est une nouvelle fois assouplie,
malgré l’opposition forte des acteurs de la santé (Reynaud et coll.,
2015 ) :
les boissons alcoolisées justifiant d’une appellation de qualité,
d’origine et de terroir ou d’un héritage culturel, gastronomique ou
régional ne sont désormais plus soumises aux restrictions
publicitaires prévues par la loi Évin. Ainsi les producteurs des
boissons ayant ces caractéristiques (c’est le cas du cidre, de la
bière, du vin, du whisky, de la vodka, etc.) peuvent diffuser leur
message commercial sur des médias autrefois interdits (télévision,
cinéma) ou soumis à des restrictions (radio, presse, etc.). On a
donc vu apparaître à la télévision à partir de 2017 des programmes
publicitaires financés par les producteurs (« 1 Minute 1 Vignoble »)
sur France Télévision par exemple. Citons enfin le projet visant à
établir un fonds spécial utilisant 10 % des dépenses publicitaires
de l’alcool pour financer la prévention, projet prévu dans la
version 1991 de la loi Évin
) :
les boissons alcoolisées justifiant d’une appellation de qualité,
d’origine et de terroir ou d’un héritage culturel, gastronomique ou
régional ne sont désormais plus soumises aux restrictions
publicitaires prévues par la loi Évin. Ainsi les producteurs des
boissons ayant ces caractéristiques (c’est le cas du cidre, de la
bière, du vin, du whisky, de la vodka, etc.) peuvent diffuser leur
message commercial sur des médias autrefois interdits (télévision,
cinéma) ou soumis à des restrictions (radio, presse, etc.). On a
donc vu apparaître à la télévision à partir de 2017 des programmes
publicitaires financés par les producteurs (« 1 Minute 1 Vignoble »)
sur France Télévision par exemple. Citons enfin le projet visant à
établir un fonds spécial utilisant 10 % des dépenses publicitaires
de l’alcool pour financer la prévention, projet prévu dans la
version 1991 de la loi Évin . Cette proposition ne s’est finalement
jamais concrétisée.
. Cette proposition ne s’est finalement
jamais concrétisée.|
Encadré 7.3 : Exemples de publicités/packagings
condamnés/signalés  (1) Coffret Piper-Heidsieck sorti en 2018 en France. Il a
été interdit au titre de la loi Évin (ordonnance de référé
rendue le 20 décembre 2018, Tribunal de Grande Instance de
Paris). Les références à la féminité, au glamour ne sont pas
admises concernant le packaging des boissons
alcooliques.
(2) Packaging Carslberg sorti en 2014 en France, lors de
la coupe du monde de football au Brésil. Le visuel présente des
joueurs officiant dans le championnat de football anglais
(Premier League) dont la marque Carlsberg était le sponsor.
Cette campagne publicitaire était assortie d’un jeu concours. Le
packaging des boissons alcooliques est une forme de publicité
devant respecter les limitations de contenu imposées par la loi
Évin. C’est à ce titre que cette cannette a été interdite (Cour
de cassation, 5 juillet 2017).
(3) Heineken a sorti en 2013 une bouteille en partenariat
avec le label musical Ed banger. Il ressort de l’ordonnance de
référé (TGI Paris 18 juillet 2013) que les mentions très
orientées sur la sensualité, voire la sexualité, ne pouvaient
figurer sur le packaging, ce dernier ayant vocation à être un
objet publicitaire.
(4) Le 20 mai 2020, la Cour de cassation a rappelé qu’une
publicité pour des marques d’alcool doit être strictement
informative. Or la campagne publicitaire « Phénix » de
Grimbergen ne l’est pas en raison de la référence 1/ à la série
Game of Thrones et 2/ au phénix, animal légendaire
doté de pouvoirs exceptionnels. Ces deux associations valorisent
ainsi la consommation d’alcool auprès d’un public jeune et n’est
pas conforme à ce qu’autorise la loi Évin.
|
 ).
).Formes, exposition et effet de la présence des marques
et des produits alcoolisés sur internet et les réseaux
sociaux
Présence de l’alcool sur internet : de quoi parle-t-on ?
Messages commerciaux des producteurs d’alcool
 ; Winpenny et coll., 2014
; Winpenny et coll., 2014 ), des « like », des
commentaires, des partages, etc. (Carah,
2014
), des « like », des
commentaires, des partages, etc. (Carah,
2014 ).
). ; Winpenny et coll., 2014
; Winpenny et coll., 2014 ; Atkinson et coll.,
2016
; Atkinson et coll.,
2016 ;
Gupta et coll., 2018
;
Gupta et coll., 2018 ). Par ces différents procédés,
l’objectif est de provoquer une « viralité » maximale des
contenus produits pour en augmenter l’audience et d’obtenir un
engagement de la part des internautes (Lipsman et coll.,
2012
). Par ces différents procédés,
l’objectif est de provoquer une « viralité » maximale des
contenus produits pour en augmenter l’audience et d’obtenir un
engagement de la part des internautes (Lipsman et coll.,
2012 ; Carah, 2014
; Carah, 2014 ).
). ; Carah et coll.,
2014
; Carah et coll.,
2014 ; Jernigan et coll., 2017b
; Jernigan et coll., 2017b ). Ils peuvent également s’immiscer
dans les « stories »24
des utilisateurs : lorsque des vidéos ou photos
de « story » personnelle sont postées, leurs amis qui les
visionnent voient apparaître une vidéo supplémentaire qui peut
être une publicité pour une marque d’alcool. L’agence de
publicité belge (Isobar) en charge d’une campagne de publicité
sur les « stories » Instagram en 2017 pour la bière
Cubanisto explique l’intérêt de mobiliser ce format très en
vogue : « Instagram est un très bon moyen de donner plus de
personnalité à la marque. En plaçant la story au milieu des
messages des autres utilisateurs Instagram et grâce aux vastes
capacités de ciblage, nous sommes à même d’amener ce contenu
sans perturber le consommateur. Nous savons qu’en moyenne 70 %
des stories sont vues avec le son ce qui nous permet d’être très
créatif dans notre manière de transmettre ce message » (Jehtro
Calomme, Head of Digital Creation chez
Isobar)25
. Les producteurs d’alcool peuvent également
créer des « stories » entièrement consacrées à leur
marque (encadré 7.4).
). Ils peuvent également s’immiscer
dans les « stories »24
des utilisateurs : lorsque des vidéos ou photos
de « story » personnelle sont postées, leurs amis qui les
visionnent voient apparaître une vidéo supplémentaire qui peut
être une publicité pour une marque d’alcool. L’agence de
publicité belge (Isobar) en charge d’une campagne de publicité
sur les « stories » Instagram en 2017 pour la bière
Cubanisto explique l’intérêt de mobiliser ce format très en
vogue : « Instagram est un très bon moyen de donner plus de
personnalité à la marque. En plaçant la story au milieu des
messages des autres utilisateurs Instagram et grâce aux vastes
capacités de ciblage, nous sommes à même d’amener ce contenu
sans perturber le consommateur. Nous savons qu’en moyenne 70 %
des stories sont vues avec le son ce qui nous permet d’être très
créatif dans notre manière de transmettre ce message » (Jehtro
Calomme, Head of Digital Creation chez
Isobar)25
. Les producteurs d’alcool peuvent également
créer des « stories » entièrement consacrées à leur
marque (encadré 7.4).|
Encadré 7.4 : Exemple d’extraits de « stories » officielles des marques d’alcool Absolutelyx*, Greenroom# (marque alibi d’Heineken), Piper-Heidsieck• et Unepetitemousse≠ 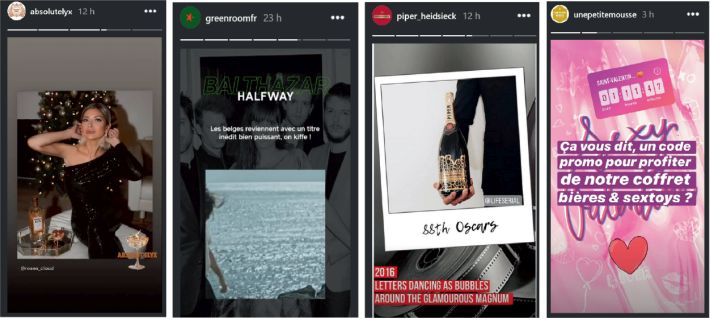
* Reçu le 20 décembre 2019 sur un compte
Instagram français à l’occasion des fêtes de
Noël.
# Reçu le 8 février 2020 sur un compte
Instagram français.
• Reçu le 9 février 2020 sur un compte
Instagram français. La marque Piper-Heidsieck fait, dans
cette story, la promotion de son engagement dans
le cinéma (partenariat avec la cérémonie des Oscars aux
États-Unis) à travers les bouteilles éditions limitées
sorties ces dernières années pour célébrer cet
événement.
≠ Reçu le 12 février 2020 sur un compte
Instagram français. Campagne promotionnelle
« unepetitemousse » pour la Saint-Valentin. La
story renvoie vers le site https://unepetitemousse.fr/biere-saint-valentin?popup=1
(consulté le 12 février 2020) qui propose à la vente un
coffret « 8 bières et 4 sextoys » (avec 20 % de
réduction).
|
 ;
Lobstein et coll., 2017
;
Lobstein et coll., 2017 ). Ceux-ci sont créés par les
producteurs d’alcool (la Heineken Champions Cup par
exemple26
), ou sont organisés par des organisations
tierces qui bénéficient d’une aide financière en contrepartie de
la visibilité de la marque d’alcool sur la communication, le
site et les réseaux sociaux liés à l’événement. En France, le
sponsoring des marques d’alcool pour soutenir des événements
musicaux, festifs, etc. étant interdit par la loi Évin, des
marques « alibis » sont créées par les alcooliers. Par exemple,
Carlsberg a lancé la marque alibi temporaire « Probably » (aux
couleurs et design de la marque mère) pour l’insérer sur
les panneaux publicitaires des matchs de football de l’Euro qui
se déroulait en France en 2016 (Murray et coll.,
2018
). Ceux-ci sont créés par les
producteurs d’alcool (la Heineken Champions Cup par
exemple26
), ou sont organisés par des organisations
tierces qui bénéficient d’une aide financière en contrepartie de
la visibilité de la marque d’alcool sur la communication, le
site et les réseaux sociaux liés à l’événement. En France, le
sponsoring des marques d’alcool pour soutenir des événements
musicaux, festifs, etc. étant interdit par la loi Évin, des
marques « alibis » sont créées par les alcooliers. Par exemple,
Carlsberg a lancé la marque alibi temporaire « Probably » (aux
couleurs et design de la marque mère) pour l’insérer sur
les panneaux publicitaires des matchs de football de l’Euro qui
se déroulait en France en 2016 (Murray et coll.,
2018 ). Sur internet, Kronenbourg et Heineken ont mis en place les
événements Pression Live27
et Green Room28
, plateformes digitales musicales (également
physiquement présentes dans les festivals) proposant des
interviews d’artistes, des chroniques de disques et des
événements musicaux. Aucune référence directe à Kronenbourg et
Heineken ne figure sur ces sites événementiels, mais les logos
et codes couleurs évoquent de façon flagrante les deux marques
d’alcool (tableau 7.II
). Sur internet, Kronenbourg et Heineken ont mis en place les
événements Pression Live27
et Green Room28
, plateformes digitales musicales (également
physiquement présentes dans les festivals) proposant des
interviews d’artistes, des chroniques de disques et des
événements musicaux. Aucune référence directe à Kronenbourg et
Heineken ne figure sur ces sites événementiels, mais les logos
et codes couleurs évoquent de façon flagrante les deux marques
d’alcool (tableau 7.II ).
).Tableau 7.II Exemples de marques alibis visibles sur internet et lors d’événements musicaux
|
Logos officiels des marques
« Heineken/Kronenbourg »
|
 |
|
Logos « alibis » des événements
musicaux « Green Room/Pression Live »
|
 |
 ). Ils rémunèrent des « influenceurs » aux milliers (voire
millions) d’abonnés sur les réseaux sociaux, pour qu’ils fassent
la promotion de leurs marques. Le rapport annuel 2018/2019 de
Pernod Ricard raconte le succès d’un tel dispositif utilisé pour
la marque Absolut Vodka : « dépassant les frontières du marché
chinois, Hong-sik, influenceur et acteur sud-coréen très
populaire, a relayé l’événement (AbsolutNights100) auprès de ses
1,6 million de followers sur Instagram (@hongsick). Une vaste
campagne en ligne et sur les médias traditionnels a également
été mise en place. L’initiative AbsolutNights100 a porté Absolut
à des niveaux record sur les réseaux sociaux. Certaines soirées
ont été retransmises en direct sur Yizhibo, principale
plateforme de streaming en Chine, enregistrant plus de 61
millions de vues et 52 millions de likes. La marque a
ainsi bénéficié d’une couverture médiatique exceptionnelle et a
considérablement renforcé sa visibilité. Ces initiatives avaient
pour ambition de faire écho aux aspirations et aux attentes des
jeunes générations. Plus qu’une marque de vodka, Absolut est
devenue une marque à suivre sur les réseaux sociaux, associée à
des événements et expériences
exceptionnels. »31
.
). Ils rémunèrent des « influenceurs » aux milliers (voire
millions) d’abonnés sur les réseaux sociaux, pour qu’ils fassent
la promotion de leurs marques. Le rapport annuel 2018/2019 de
Pernod Ricard raconte le succès d’un tel dispositif utilisé pour
la marque Absolut Vodka : « dépassant les frontières du marché
chinois, Hong-sik, influenceur et acteur sud-coréen très
populaire, a relayé l’événement (AbsolutNights100) auprès de ses
1,6 million de followers sur Instagram (@hongsick). Une vaste
campagne en ligne et sur les médias traditionnels a également
été mise en place. L’initiative AbsolutNights100 a porté Absolut
à des niveaux record sur les réseaux sociaux. Certaines soirées
ont été retransmises en direct sur Yizhibo, principale
plateforme de streaming en Chine, enregistrant plus de 61
millions de vues et 52 millions de likes. La marque a
ainsi bénéficié d’une couverture médiatique exceptionnelle et a
considérablement renforcé sa visibilité. Ces initiatives avaient
pour ambition de faire écho aux aspirations et aux attentes des
jeunes générations. Plus qu’une marque de vodka, Absolut est
devenue une marque à suivre sur les réseaux sociaux, associée à
des événements et expériences
exceptionnels. »31
.Messages en faveur de l’alcool émis par des tiers et/ou des internautes
 ). À titre d’illustration, sur Facebook, la page « Ricard
club » se présente comme « une page pour les amateurs, les
collectionneurs et les fans du produit Ricard !!!!! à la
vôtre !!!! »36
, et le groupe « J’peux pas j’ai Apéro »
(138 000 « likes ») publie des contenus pro-alcool, des
messages sur des marques et vend des T-shirts qui vantent la
consommation excessive d’alcool37
. Sans lien officiel déclaré entre les
administrateurs de ces pages et les marques d’alcool, il est
impossible de dire si le contenu publié est réalisé dans un
cadre strictement personnel ou dans le contexte d’un parrainage
rémunéré.
). À titre d’illustration, sur Facebook, la page « Ricard
club » se présente comme « une page pour les amateurs, les
collectionneurs et les fans du produit Ricard !!!!! à la
vôtre !!!! »36
, et le groupe « J’peux pas j’ai Apéro »
(138 000 « likes ») publie des contenus pro-alcool, des
messages sur des marques et vend des T-shirts qui vantent la
consommation excessive d’alcool37
. Sans lien officiel déclaré entre les
administrateurs de ces pages et les marques d’alcool, il est
impossible de dire si le contenu publié est réalisé dans un
cadre strictement personnel ou dans le contexte d’un parrainage
rémunéré. )
ainsi que Moraes et coll. (2013
)
ainsi que Moraes et coll. (2013 ) estiment que ces messages diffusés
par des tiers ou des internautes sont largement sous-estimés.
Étant donné que les producteurs d’alcool ne portent pas plainte
contre ces usages illicites de leur marque, on peut considérer
qu’il existe une forme d’approbation tacite de leur part à la
propagation de ces messages qui contribuent gratuitement à
l’image positive de leurs produits (Cranwell et coll.,
2017
) estiment que ces messages diffusés
par des tiers ou des internautes sont largement sous-estimés.
Étant donné que les producteurs d’alcool ne portent pas plainte
contre ces usages illicites de leur marque, on peut considérer
qu’il existe une forme d’approbation tacite de leur part à la
propagation de ces messages qui contribuent gratuitement à
l’image positive de leurs produits (Cranwell et coll.,
2017 ; Lobstein et coll., 2017
; Lobstein et coll., 2017 ). À ce titre, il est nécessaire de les
comptabiliser dans le marketing de l’alcool présent sur
internet.
). À ce titre, il est nécessaire de les
comptabiliser dans le marketing de l’alcool présent sur
internet. ; Primack et coll., 2015
; Primack et coll., 2015 ; Cranwell et coll.,
2017
; Cranwell et coll.,
2017 ). Critchlow et coll. (Critchlow et coll.,
2015
). Critchlow et coll. (Critchlow et coll.,
2015 ; Critchlow et coll., 2017
; Critchlow et coll., 2017 ; Critchlow et coll.,
2019
; Critchlow et coll.,
2019 )
en distinguent deux formes :
)
en distinguent deux formes : ). Concernant ce dernier point, il est
établi dans la littérature qu’un des facteurs qui incitent les
jeunes à commencer à boire est l’influence des pairs et la
consommation des autres jeunes (Borsari et Carey,
2001
). Concernant ce dernier point, il est
établi dans la littérature qu’un des facteurs qui incitent les
jeunes à commencer à boire est l’influence des pairs et la
consommation des autres jeunes (Borsari et Carey,
2001 ). Propager des contenus pro-alcool via des internautes
qui diffusent ces messages vers leurs pairs est donc
certainement plus efficace que des formats publicitaires
classiques pour inciter les jeunes à boire (le message devient
alors plus crédible, il attire plus l’attention, il est plus
apprécié, etc.).
). Propager des contenus pro-alcool via des internautes
qui diffusent ces messages vers leurs pairs est donc
certainement plus efficace que des formats publicitaires
classiques pour inciter les jeunes à boire (le message devient
alors plus crédible, il attire plus l’attention, il est plus
apprécié, etc.).Exposition des jeunes au marketing de l’alcool sur internet
 )
ont demandé à 1 192 mineurs (13 à 20 ans) et 1 124 majeurs (21 ans
et plus) leur exposition, au cours des 30 derniers jours, à de la
publicité pour de l’alcool ou à du contenu promotionnel en faveur
des boissons alcooliques sur différents médias. Concernant internet
en particulier, les mineurs étaient près de deux fois plus enclins
(29,7 %) à rapporter avoir vu de la publicité pour l’alcool que
leurs ainés (16,8 %). Parmi les 13-20 ans exposés au cours du mois
précédent (29,7 %), 17,3 % ont déclaré voir quotidiennement des
messages pro-alcool sur internet.
)
ont demandé à 1 192 mineurs (13 à 20 ans) et 1 124 majeurs (21 ans
et plus) leur exposition, au cours des 30 derniers jours, à de la
publicité pour de l’alcool ou à du contenu promotionnel en faveur
des boissons alcooliques sur différents médias. Concernant internet
en particulier, les mineurs étaient près de deux fois plus enclins
(29,7 %) à rapporter avoir vu de la publicité pour l’alcool que
leurs ainés (16,8 %). Parmi les 13-20 ans exposés au cours du mois
précédent (29,7 %), 17,3 % ont déclaré voir quotidiennement des
messages pro-alcool sur internet. ) proposent de distinguer l’exposition aux
messages pro-alcool selon le caractère actif ou passif des
internautes. Les internautes sont dits « actifs » s’ils s’engagent
personnellement, c’est-à-dire s’ils tweetent, re-tweetent,
« likent », commentent, postent et partagent du contenu
pro-alcool sur les réseaux sociaux, sont abonnés à des pages faisant
la promotion d’alcool, etc. À l’inverse, les internautes sont dits
« passifs » s’ils ne font que recevoir des contenus pro-alcool
(via les messages de leurs pairs, des publicités sur leur
fil d’actualités, etc.), mais n’interagissent pas avec ces messages.
Leur typologie, appliquée à Twitter, est pertinente pour l’ensemble
des réseaux sociaux car il est probable qu’en fonction du niveau
d’engagement des jeunes, le niveau de persuasion et l’exposition aux
messages pro-alcool diffèrent. Li et coll.
(2014
) proposent de distinguer l’exposition aux
messages pro-alcool selon le caractère actif ou passif des
internautes. Les internautes sont dits « actifs » s’ils s’engagent
personnellement, c’est-à-dire s’ils tweetent, re-tweetent,
« likent », commentent, postent et partagent du contenu
pro-alcool sur les réseaux sociaux, sont abonnés à des pages faisant
la promotion d’alcool, etc. À l’inverse, les internautes sont dits
« passifs » s’ils ne font que recevoir des contenus pro-alcool
(via les messages de leurs pairs, des publicités sur leur
fil d’actualités, etc.), mais n’interagissent pas avec ces messages.
Leur typologie, appliquée à Twitter, est pertinente pour l’ensemble
des réseaux sociaux car il est probable qu’en fonction du niveau
d’engagement des jeunes, le niveau de persuasion et l’exposition aux
messages pro-alcool diffèrent. Li et coll.
(2014 )
puis Niland et coll. (2016
)
puis Niland et coll. (2016 ) ont en effet montré que l’engagement des
internautes et la co-construction des messages altèrent les
frontières entre contenu commercial et privé et influencent de façon
positive le processus de persuasion.
) ont en effet montré que l’engagement des
internautes et la co-construction des messages altèrent les
frontières entre contenu commercial et privé et influencent de façon
positive le processus de persuasion. )
menée sur Twitter. En réalisant une recherche par mots-clés entre
mars et avril 2014 (« drunk », « beer », « alcohol », etc.),
ces chercheurs ont collecté près de 12 millions de tweets relatifs à
l’alcool. Parmi ces tweets, 5 000 ont été extraits de pages
d’internautes dont l’audience était estimée élevée (elle était
mesurée au nombre d’abonnés). Ces messages ont été codés selon le
thème et la valence du tweet (pro- ou anti-alcool) puis leur source.
Au total, 4 800 (96 %) des tweets étaient relatifs à l’alcool, 3 813
(79 %) d’entre eux étaient pro-alcool, 346 (7 %) anti-alcool, et 641
(13 %) neutres. Concernant la source, 87 % des tweets provenaient
d’utilisateurs lambda (sans célébrité) et 10 % des industriels de
l’alcool ou d’organisations tierces (bars, restaurants, pages
indéterminées faisant la promotion d’alcool). Ce dernier chiffre
reflète la présence non négligeable des producteurs parmi les
comptes twitter les plus influents (probablement via leur
community manager).
)
menée sur Twitter. En réalisant une recherche par mots-clés entre
mars et avril 2014 (« drunk », « beer », « alcohol », etc.),
ces chercheurs ont collecté près de 12 millions de tweets relatifs à
l’alcool. Parmi ces tweets, 5 000 ont été extraits de pages
d’internautes dont l’audience était estimée élevée (elle était
mesurée au nombre d’abonnés). Ces messages ont été codés selon le
thème et la valence du tweet (pro- ou anti-alcool) puis leur source.
Au total, 4 800 (96 %) des tweets étaient relatifs à l’alcool, 3 813
(79 %) d’entre eux étaient pro-alcool, 346 (7 %) anti-alcool, et 641
(13 %) neutres. Concernant la source, 87 % des tweets provenaient
d’utilisateurs lambda (sans célébrité) et 10 % des industriels de
l’alcool ou d’organisations tierces (bars, restaurants, pages
indéterminées faisant la promotion d’alcool). Ce dernier chiffre
reflète la présence non négligeable des producteurs parmi les
comptes twitter les plus influents (probablement via leur
community manager). ).
Sur 110 vidéos musicales les plus célèbres au Royaume-Uni, 45 %
faisaient au moins une fois référence à l’alcool, et 7 % montraient
une marque de boisson alcoolique. Ensuite, 2 068 adolescents
britanniques (11-18 ans) étaient interrogés via un
questionnaire en ligne. Il s’avère que les 32 clips musicaux les
plus populaires (parmi les 110) et qui contenaient des références à
l’alcool ou au tabac ont été vus par 81 % des jeunes interrogés, et,
parmi eux, 95 % les avaient visionnés plusieurs fois.
).
Sur 110 vidéos musicales les plus célèbres au Royaume-Uni, 45 %
faisaient au moins une fois référence à l’alcool, et 7 % montraient
une marque de boisson alcoolique. Ensuite, 2 068 adolescents
britanniques (11-18 ans) étaient interrogés via un
questionnaire en ligne. Il s’avère que les 32 clips musicaux les
plus populaires (parmi les 110) et qui contenaient des références à
l’alcool ou au tabac ont été vus par 81 % des jeunes interrogés, et,
parmi eux, 95 % les avaient visionnés plusieurs fois. ).
Parmi les 70 vidéos retenues (qui cumulaient 333 millions de vues),
presque la moitié d’entre elles montraient une marque d’alcool et
79 % dépeignaient avec humour la consommation excessive d’alcool.
Les alcools les plus représentés dans ces clips étaient les
spiritueux, suivis de la bière, du vin et du champagne.
).
Parmi les 70 vidéos retenues (qui cumulaient 333 millions de vues),
presque la moitié d’entre elles montraient une marque d’alcool et
79 % dépeignaient avec humour la consommation excessive d’alcool.
Les alcools les plus représentés dans ces clips étaient les
spiritueux, suivis de la bière, du vin et du champagne. ) ont interrogé 405 Britanniques
(18-25 ans) sur leur exposition perçue au marketing de l’alcool et
leur participation (le « user-generated branding »). Sur les
11 supports commerciaux présentés dans le questionnaire (fonds
d’écran, jeux, boutiques en ligne, sites internet de marques, pages
des marques sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vidéos
virales, concours en ligne), les jeunes ont rapporté être conscients
du marketing de l’alcool sur 4,3 d’entre eux en moyenne. Concernant
les réseaux sociaux, 84 % étaient au courant de l’existence de
vidéos virales impliquant du contenu commercial pour l’alcool, 65 %
de la présence des marques d’alcool sur Facebook et Twitter, et 57 %
de l’existence de concours en ligne. À propos de leur participation
à ces dispositifs marketing, ils déclaraient s’être engagés sur 2,34
supports (54 % pour les vidéos virales, 20 % via les pages
Facebook et/ou Twitter des marques et 16 % pour les concours en
ligne).
) ont interrogé 405 Britanniques
(18-25 ans) sur leur exposition perçue au marketing de l’alcool et
leur participation (le « user-generated branding »). Sur les
11 supports commerciaux présentés dans le questionnaire (fonds
d’écran, jeux, boutiques en ligne, sites internet de marques, pages
des marques sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vidéos
virales, concours en ligne), les jeunes ont rapporté être conscients
du marketing de l’alcool sur 4,3 d’entre eux en moyenne. Concernant
les réseaux sociaux, 84 % étaient au courant de l’existence de
vidéos virales impliquant du contenu commercial pour l’alcool, 65 %
de la présence des marques d’alcool sur Facebook et Twitter, et 57 %
de l’existence de concours en ligne. À propos de leur participation
à ces dispositifs marketing, ils déclaraient s’être engagés sur 2,34
supports (54 % pour les vidéos virales, 20 % via les pages
Facebook et/ou Twitter des marques et 16 % pour les concours en
ligne). ).
Cinq formes de participation (et donc d’exposition) se sont
dégagées : « liker » la page d’une marque sur Twitter,
Facebook ou Instagram ; partager un contenu relatif à une marque ;
s’abonner à une marque d’alcool sur les réseaux sociaux ; participer
à un concours organisé par une marque d’alcool sur les réseaux
sociaux ; rechercher des publicités pour les visionner sur YouTube.
Sur l’ensemble des jeunes interrogés, 13,2 % ont déclaré avoir
participé à au moins une de ces formes de marketing.
).
Cinq formes de participation (et donc d’exposition) se sont
dégagées : « liker » la page d’une marque sur Twitter,
Facebook ou Instagram ; partager un contenu relatif à une marque ;
s’abonner à une marque d’alcool sur les réseaux sociaux ; participer
à un concours organisé par une marque d’alcool sur les réseaux
sociaux ; rechercher des publicités pour les visionner sur YouTube.
Sur l’ensemble des jeunes interrogés, 13,2 % ont déclaré avoir
participé à au moins une de ces formes de marketing.Effet, sur les jeunes, du marketing de l’alcool sur internet
Revues de la littérature
 ). Ils ont réalisé une revue systématique à partir des
critères d’inclusion suivants : des recherches sur des jeunes
âgés de 12 à 25 ans, mobilisant des méthodes longitudinales,
transversales, expérimentales ou qualitatives, analysant le
marketing alcool sur internet généré par les producteurs
d’alcool et/ou les internautes eux-mêmes, mesurant les attitudes
à l’égard de la consommation d’alcool, les intentions de
comportement et/ou de comportements déclarés, publiées en
anglais dans des journaux académiques et la littérature
grise.
). Ils ont réalisé une revue systématique à partir des
critères d’inclusion suivants : des recherches sur des jeunes
âgés de 12 à 25 ans, mobilisant des méthodes longitudinales,
transversales, expérimentales ou qualitatives, analysant le
marketing alcool sur internet généré par les producteurs
d’alcool et/ou les internautes eux-mêmes, mesurant les attitudes
à l’égard de la consommation d’alcool, les intentions de
comportement et/ou de comportements déclarés, publiées en
anglais dans des journaux académiques et la littérature
grise. ) concluent que l’exposition aux messages pro-alcool sur les
réseaux sociaux augmentent les problèmes liés à l’alcool, la
consommation d’alcool dans les 30 derniers jours et la
consommation excessive du produit en une seule occasion (âge
moyen des répondants : 21,4 ans). Jones et Magee
(2011
) concluent que l’exposition aux messages pro-alcool sur les
réseaux sociaux augmentent les problèmes liés à l’alcool, la
consommation d’alcool dans les 30 derniers jours et la
consommation excessive du produit en une seule occasion (âge
moyen des répondants : 21,4 ans). Jones et Magee
(2011 ) montrent que sur des jeunes de 12-17 ans, l’exposition à la
publicité pour l’alcool sur internet augmente la probabilité de
boire de l’alcool dans une période proche, mais n’augmente pas
l’initiation à l’alcool ni leur consommation sur les 12 derniers
mois.
) montrent que sur des jeunes de 12-17 ans, l’exposition à la
publicité pour l’alcool sur internet augmente la probabilité de
boire de l’alcool dans une période proche, mais n’augmente pas
l’initiation à l’alcool ni leur consommation sur les 12 derniers
mois. ) montrent que la participation au marketing online de
l’alcool augmente les risques de devenir buveur d’alcool pour
des 12-14 ans et de boire pendant l’année. Une étude américaine
s’est penchée sur l’effet de l’exposition de lycéens (âgés de
15 ans en moyenne) à des photos d’amis sur Facebook et Myspace
qui font la fête (Huang et coll.,
2014
) montrent que la participation au marketing online de
l’alcool augmente les risques de devenir buveur d’alcool pour
des 12-14 ans et de boire pendant l’année. Une étude américaine
s’est penchée sur l’effet de l’exposition de lycéens (âgés de
15 ans en moyenne) à des photos d’amis sur Facebook et Myspace
qui font la fête (Huang et coll.,
2014 ). Après avoir interrogé 1 563 lycéens, les auteurs concluent
que l’exposition à des photos d’amis qui font la fête et boivent
entraîne des comportements de consommation plus risqués.
Alhabash et coll. (2015
). Après avoir interrogé 1 563 lycéens, les auteurs concluent
que l’exposition à des photos d’amis qui font la fête et boivent
entraîne des comportements de consommation plus risqués.
Alhabash et coll. (2015 ) mettent par ailleurs en évidence que
l’engagement sur Facebook (« liker », faire des
commentaires, partager du contenu, etc.) est prédicteur de
l’intention de consommer de l’alcool.
) mettent par ailleurs en évidence que
l’engagement sur Facebook (« liker », faire des
commentaires, partager du contenu, etc.) est prédicteur de
l’intention de consommer de l’alcool. ) est narrative. Ces chercheurs se focalisent sur les
communications digitales émises officiellement par les marques
d’alcool et se posent 3 questions à cet égard : ces messages
ont-ils une influence sur la consommation d’alcool ? (Q1) ; quel
type de marketing online est déployé par les producteurs
d’alcool ? (Q2) ; est-ce que les formes déployées sont conformes
aux codes déontologiques de protection des mineurs (Q3) ? Leur
synthèse intègre les recherches publiées en anglais entre 2000
et 2015 dans des journaux académiques et dans la littérature
grise (rapports des gouvernements, des ONG, des chercheurs,
etc.).
) est narrative. Ces chercheurs se focalisent sur les
communications digitales émises officiellement par les marques
d’alcool et se posent 3 questions à cet égard : ces messages
ont-ils une influence sur la consommation d’alcool ? (Q1) ; quel
type de marketing online est déployé par les producteurs
d’alcool ? (Q2) ; est-ce que les formes déployées sont conformes
aux codes déontologiques de protection des mineurs (Q3) ? Leur
synthèse intègre les recherches publiées en anglais entre 2000
et 2015 dans des journaux académiques et dans la littérature
grise (rapports des gouvernements, des ONG, des chercheurs,
etc.). ). Ils montrent tous que l’exposition au marketing en ligne
est associée, chez les jeunes, à une intention d’achat accrue, à
une consommation générale plus importante, et à une consommation
ponctuelle excessive. Pour répondre à la Q2, 22 recherches sont
retenues et montrent que les marques déploient différentes
méthodes pour faire de la publicité sur internet, dont des
méthodes qui encouragent la participation des internautes, leur
engagement, la co-création de contenus favorables aux marques et
à la consommation d’alcool en général. Enfin la réponse à la Q3
est négative, puisque 9 études mettent en exergue que les
mineurs sont exposés à des messages commerciaux attractifs
diffusés sur internet par les marques d’alcool, ce qui n’est pas
conforme aux codes déontologiques proposés par la filière. De
plus, des sites n’hésitent pas à vendre de l’alcool quel que
soit l’âge et/ou ne contrôlent pas l’âge des internautes.
). Ils montrent tous que l’exposition au marketing en ligne
est associée, chez les jeunes, à une intention d’achat accrue, à
une consommation générale plus importante, et à une consommation
ponctuelle excessive. Pour répondre à la Q2, 22 recherches sont
retenues et montrent que les marques déploient différentes
méthodes pour faire de la publicité sur internet, dont des
méthodes qui encouragent la participation des internautes, leur
engagement, la co-création de contenus favorables aux marques et
à la consommation d’alcool en général. Enfin la réponse à la Q3
est négative, puisque 9 études mettent en exergue que les
mineurs sont exposés à des messages commerciaux attractifs
diffusés sur internet par les marques d’alcool, ce qui n’est pas
conforme aux codes déontologiques proposés par la filière. De
plus, des sites n’hésitent pas à vendre de l’alcool quel que
soit l’âge et/ou ne contrôlent pas l’âge des internautes. ), est plus large que les précédentes car elle porte sur
l’impact du marketing digital des produits nocifs pour la santé
(alcool, tabac et malnutrition). Concernant l’alcool,
17 recherches sont intégrées dans cette revue de la littérature
systématique. Les critères d’inclusion étaient les suivants :
recherches sur des jeunes âgés de 12 à 30 ans, publiées dans des
journaux académiques entre 1990 et 2017 (pour l’alcool elles ont
été publiées entre 2001 et 2017) ou sur des sites de référence,
mobilisant des méthodes quantitatives et/ou qualitatives,
analysant le marketing sur internet au sens large (sites,
réseaux sociaux, etc.), mesurant des variables d’attitudes
(croyances, perceptions) et/ou d’intentions de comportement
et/ou de comportements réels (achat, consommation du
produit).
), est plus large que les précédentes car elle porte sur
l’impact du marketing digital des produits nocifs pour la santé
(alcool, tabac et malnutrition). Concernant l’alcool,
17 recherches sont intégrées dans cette revue de la littérature
systématique. Les critères d’inclusion étaient les suivants :
recherches sur des jeunes âgés de 12 à 30 ans, publiées dans des
journaux académiques entre 1990 et 2017 (pour l’alcool elles ont
été publiées entre 2001 et 2017) ou sur des sites de référence,
mobilisant des méthodes quantitatives et/ou qualitatives,
analysant le marketing sur internet au sens large (sites,
réseaux sociaux, etc.), mesurant des variables d’attitudes
(croyances, perceptions) et/ou d’intentions de comportement
et/ou de comportements réels (achat, consommation du
produit). ) montrent un lien significatif entre
l’exposition des jeunes européens interrogés (âge moyen 14 ans ;
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne) au marketing online
puis l’initiation à l’alcool et l’alcoolisation ponctuelle
excessive pendant les 30 jours précédant l’étude. Certaines
études montrent que la participation et la co-construction des
messages pro-alcool par les jeunes exercent un impact plus
important que les formes classiques de publicité en ligne
(bannières, publicités sur les fils d’actualités, etc.). Ainsi,
Jones et coll. (2016
) montrent un lien significatif entre
l’exposition des jeunes européens interrogés (âge moyen 14 ans ;
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne) au marketing online
puis l’initiation à l’alcool et l’alcoolisation ponctuelle
excessive pendant les 30 jours précédant l’étude. Certaines
études montrent que la participation et la co-construction des
messages pro-alcool par les jeunes exercent un impact plus
important que les formes classiques de publicité en ligne
(bannières, publicités sur les fils d’actualités, etc.). Ainsi,
Jones et coll. (2016 ) mettent en évidence que la
participation de jeunes de 16-24 ans à la création ou à la
diffusion de messages pour des marques d’alcool sur Facebook
augmente la fréquence et le volume d’alcool consommé et les
alcoolisations ponctuelles excessives. De même, Critchlow et
coll. (2015
) mettent en évidence que la
participation de jeunes de 16-24 ans à la création ou à la
diffusion de messages pour des marques d’alcool sur Facebook
augmente la fréquence et le volume d’alcool consommé et les
alcoolisations ponctuelles excessives. De même, Critchlow et
coll. (2015 ) concluent à l’existence d’une association entre la
participation au marketing en ligne et la fréquence des
consommations ponctuelles excessives des 18-25 ans. Concernant
les plus jeunes (13-14 ans), Lin et coll. (2011
) concluent à l’existence d’une association entre la
participation au marketing en ligne et la fréquence des
consommations ponctuelles excessives des 18-25 ans. Concernant
les plus jeunes (13-14 ans), Lin et coll. (2011 ) montrent que la
participation à du marketing online pro-alcool augmente
la probabilité d’être buveur, d’avoir bu dans les 12 derniers
mois, mais aucun lien n’a été montré avec l’intention de boire
ou la fréquence de consommation d’alcool. Carrotte et coll.
(2016
) montrent que la
participation à du marketing online pro-alcool augmente
la probabilité d’être buveur, d’avoir bu dans les 12 derniers
mois, mais aucun lien n’a été montré avec l’intention de boire
ou la fréquence de consommation d’alcool. Carrotte et coll.
(2016 ) révèlent par ailleurs que suivre et/ou « liker » des
sites pro-alcool augmente les risques de commencer à boire jeune
(étude réalisée sur des 15-29 ans).
) révèlent par ailleurs que suivre et/ou « liker » des
sites pro-alcool augmente les risques de commencer à boire jeune
(étude réalisée sur des 15-29 ans). ) mettent en évidence que la réceptivité au marketing de
l’alcool sur internet augmente la probabilité de devenir un
buveur excessif (« binge drinker »), mais n’augmente pas
les risques de s’initier à l’alcool.
) mettent en évidence que la réceptivité au marketing de
l’alcool sur internet augmente la probabilité de devenir un
buveur excessif (« binge drinker »), mais n’augmente pas
les risques de s’initier à l’alcool. ). Des jeunes de 18-25 ans estiment quant à eux que partager
des contenus sur des marques d’alcool les aide à construire leur
identité virale, à exprimer leur goût et leurs préférences et à
créer des liens avec les autres (Lyons et coll.,
2017
). Des jeunes de 18-25 ans estiment quant à eux que partager
des contenus sur des marques d’alcool les aide à construire leur
identité virale, à exprimer leur goût et leurs préférences et à
créer des liens avec les autres (Lyons et coll.,
2017 ).
). ), sur les 7 études recensées, 5 ont trouvé un lien positif et
significatif entre l’exposition au marketing de l’alcool sur
internet et les intentions de boire de l’alcool. Sur les 10
recherches qui ont étudié les comportements réels, 8 trouvent un
lien entre l’exposition aux messages online pro-alcool et
la consommation de boissons alcooliques.
), sur les 7 études recensées, 5 ont trouvé un lien positif et
significatif entre l’exposition au marketing de l’alcool sur
internet et les intentions de boire de l’alcool. Sur les 10
recherches qui ont étudié les comportements réels, 8 trouvent un
lien entre l’exposition aux messages online pro-alcool et
la consommation de boissons alcooliques. ) ont réalisé une méta-analyse des
articles publiés jusqu’en janvier 2017 sur l’effet du marketing
de l’alcool online sur les jeunes. Les recherches (en
anglais) retenues portaient sur les réseaux sociaux, mesuraient
une forme d’engagement des jeunes par rapport aux messages sur
l’alcool (« liker », poster des commentaires, regarder
des vidéos sur l’alcool, publier des photos avec de l’alcool,
etc.) et évaluaient avec des échelles fiables la consommation
d’alcool et les problèmes liés à l’alcool (Alcohol use
disorders test – AUDIT, etc.). Les études qualitatives,
d’analyse de contenu, d’effet des publicités alcool au sens
large sur les jeunes, etc. n’ont pas été intégrées dans cette
synthèse.
) ont réalisé une méta-analyse des
articles publiés jusqu’en janvier 2017 sur l’effet du marketing
de l’alcool online sur les jeunes. Les recherches (en
anglais) retenues portaient sur les réseaux sociaux, mesuraient
une forme d’engagement des jeunes par rapport aux messages sur
l’alcool (« liker », poster des commentaires, regarder
des vidéos sur l’alcool, publier des photos avec de l’alcool,
etc.) et évaluaient avec des échelles fiables la consommation
d’alcool et les problèmes liés à l’alcool (Alcohol use
disorders test – AUDIT, etc.). Les études qualitatives,
d’analyse de contenu, d’effet des publicités alcool au sens
large sur les jeunes, etc. n’ont pas été intégrées dans cette
synthèse. ). Elle est relativement similaire à la précédente en termes
de période de requête (les articles en anglais intégrés ont été
publiés entre 2010 et 2017) et d’objectifs. En effet, les
auteurs avaient pour but d’évaluer l’effet, sur des adolescents
et des jeunes adultes, de : i) l’exposition au marketing
digital (sites internet et réseaux sociaux des marques d’alcool,
bannières publicitaires, forums, chats, e-mails,
applications, contenus téléchargeables, messages d’internautes
en lien avec les campagnes marketing des marques) ; et
ii) la réceptivité à ce marketing online (cliquer
sur une publicité alcool, visiter un site, participer à un
concours, « liker », partager, etc.) sur les intentions,
la consommation et les attitudes par rapport à l’alcool. Sur les
25 articles recensés, la très forte majorité des études montre
un lien entre l’exposition et la réceptivité au marketing
digital des marques d’alcool puis la fréquence de la
consommation d’alcool et l’alcoolisation ponctuelle importante
des jeunes. L’effet de la réceptivité semble jouer un rôle plus
important sur les comportements et attitudes que celui de
l’exposition.
). Elle est relativement similaire à la précédente en termes
de période de requête (les articles en anglais intégrés ont été
publiés entre 2010 et 2017) et d’objectifs. En effet, les
auteurs avaient pour but d’évaluer l’effet, sur des adolescents
et des jeunes adultes, de : i) l’exposition au marketing
digital (sites internet et réseaux sociaux des marques d’alcool,
bannières publicitaires, forums, chats, e-mails,
applications, contenus téléchargeables, messages d’internautes
en lien avec les campagnes marketing des marques) ; et
ii) la réceptivité à ce marketing online (cliquer
sur une publicité alcool, visiter un site, participer à un
concours, « liker », partager, etc.) sur les intentions,
la consommation et les attitudes par rapport à l’alcool. Sur les
25 articles recensés, la très forte majorité des études montre
un lien entre l’exposition et la réceptivité au marketing
digital des marques d’alcool puis la fréquence de la
consommation d’alcool et l’alcoolisation ponctuelle importante
des jeunes. L’effet de la réceptivité semble jouer un rôle plus
important sur les comportements et attitudes que celui de
l’exposition.Recherches non intégrées dans les revues de la
littérature et publiées
depuis 2017
 ; Atkinson et coll., 2016
; Atkinson et coll., 2016 ).
). ) ont interrogé 405 jeunes britanniques (18-25 ans) qui en
diffusent sans lien commercial avéré avec des marques d’alcool
(« user-created promotion » : par exemple poster sur
ses pages Instagram ou Facebook des photos de soi ou d’amis qui
boivent). Les résultats révèlent une association positive et
forte entre la participation à la promotion de l’alcool sur les
réseaux sociaux et une consommation à risque.
) ont interrogé 405 jeunes britanniques (18-25 ans) qui en
diffusent sans lien commercial avéré avec des marques d’alcool
(« user-created promotion » : par exemple poster sur
ses pages Instagram ou Facebook des photos de soi ou d’amis qui
boivent). Les résultats révèlent une association positive et
forte entre la participation à la promotion de l’alcool sur les
réseaux sociaux et une consommation à risque. ). Les auteurs rapportent également une association
significative et supérieure avec la consommation à risque dans
le cas d’un engagement de type « user-created
promotion ». Ces résultats suggèrent que s’engager soi-même
dans la diffusion de messages pro-alcool aurait un impact plus
important sur la consommation que de participer au marketing des
producteurs.
). Les auteurs rapportent également une association
significative et supérieure avec la consommation à risque dans
le cas d’un engagement de type « user-created
promotion ». Ces résultats suggèrent que s’engager soi-même
dans la diffusion de messages pro-alcool aurait un impact plus
important sur la consommation que de participer au marketing des
producteurs. ) ont constaté sur Facebook que lorsque
des jeunes (21-24 ans) sont exposés à des messages commerciaux
d’alcool associés à des commentaires pro-consommation et à des
« likes » d’autres internautes, ceux-ci déclarent une
envie de boire élevée (3,5 fois supérieure par rapport à ceux
exposés à des commentaires anti-consommation). De plus, les
commentaires pro-consommation augmentent également l’envie de
s’engager des jeunes qui y sont exposés (« liker »,
poster des commentaires, etc.).
) ont constaté sur Facebook que lorsque
des jeunes (21-24 ans) sont exposés à des messages commerciaux
d’alcool associés à des commentaires pro-consommation et à des
« likes » d’autres internautes, ceux-ci déclarent une
envie de boire élevée (3,5 fois supérieure par rapport à ceux
exposés à des commentaires anti-consommation). De plus, les
commentaires pro-consommation augmentent également l’envie de
s’engager des jeunes qui y sont exposés (« liker »,
poster des commentaires, etc.). ) ont exploré les raisons qui incitent les jeunes à diffuser
des messages pro-alcool. Pour ce faire, ils ont mené une étude
longitudinale sur 4 ans (la moyenne d’âge des 316 jeunes
recrutés au début de la recherche était de 17,9 ans). Ces
chercheurs ont montré que leur propre consommation d’alcool
(plus on boit et plus on participe), le temps (plus les jeunes
vieillissent et moins ils participent), puis la perception que
leurs amis approuvent les comportements d’alcoolisation (plus
cette perception est forte et plus on participe) incitent les
jeunes à poster des messages pro-alcool sur Facebook.
) ont exploré les raisons qui incitent les jeunes à diffuser
des messages pro-alcool. Pour ce faire, ils ont mené une étude
longitudinale sur 4 ans (la moyenne d’âge des 316 jeunes
recrutés au début de la recherche était de 17,9 ans). Ces
chercheurs ont montré que leur propre consommation d’alcool
(plus on boit et plus on participe), le temps (plus les jeunes
vieillissent et moins ils participent), puis la perception que
leurs amis approuvent les comportements d’alcoolisation (plus
cette perception est forte et plus on participe) incitent les
jeunes à poster des messages pro-alcool sur Facebook. ) ont interrogé 60 australiens (18-21 ans). Ces derniers ont
déclaré que la consommation d’alcool et les réseaux sociaux font
partie de leur identité et que ce sont des moyens jugés
pertinents pour faciliter, établir et consolider leurs relations
sociales. Ils combinent dès lors volontiers les deux en
communiquant sur les réseaux sociaux à propos de leur
consommation d’alcool (qui fait partie de leur identité) pour
montrer qu’ils sont « cools ». D’autres jeunes déclarent
également que poster des photos avec des amis qui boivent les
aident à montrer leur appartenance à un groupe de pairs
particuliers. Le fait de voir leurs amis commenter et
« liker » leurs photos ou publications leur procure
également le sentiment d’avoir une vie sociale épanouie.
) ont interrogé 60 australiens (18-21 ans). Ces derniers ont
déclaré que la consommation d’alcool et les réseaux sociaux font
partie de leur identité et que ce sont des moyens jugés
pertinents pour faciliter, établir et consolider leurs relations
sociales. Ils combinent dès lors volontiers les deux en
communiquant sur les réseaux sociaux à propos de leur
consommation d’alcool (qui fait partie de leur identité) pour
montrer qu’ils sont « cools ». D’autres jeunes déclarent
également que poster des photos avec des amis qui boivent les
aident à montrer leur appartenance à un groupe de pairs
particuliers. Le fait de voir leurs amis commenter et
« liker » leurs photos ou publications leur procure
également le sentiment d’avoir une vie sociale épanouie. ) ont exploré, dans des entretiens de
groupe auprès de jeunes (14-17 ans), l’idée qu’afficher son
comportement d’alcoolisation sur les réseaux sociaux peut être
bénéfique. Ils découvrent que cela dépend en fait de la marque
avec laquelle on s’affiche. Ainsi s’associer à certaines marques
sur les réseaux sociaux peut valoriser la personne mais, à
l’inverse, peut aussi comporter des risques en termes d’image
vis-à-vis des pairs si la marque n’a pas une bonne image.
) ont exploré, dans des entretiens de
groupe auprès de jeunes (14-17 ans), l’idée qu’afficher son
comportement d’alcoolisation sur les réseaux sociaux peut être
bénéfique. Ils découvrent que cela dépend en fait de la marque
avec laquelle on s’affiche. Ainsi s’associer à certaines marques
sur les réseaux sociaux peut valoriser la personne mais, à
l’inverse, peut aussi comporter des risques en termes d’image
vis-à-vis des pairs si la marque n’a pas une bonne image. ). Les auteurs montrent que les étudiants non buveurs dont les
publications pro-alcool d’amis sont très « likées » ont
une plus forte tendance à considérer que les comportements
d’alcoolisation sont la norme dans les soirées étudiantes. Ainsi
les représentations des non-buveurs semblent également être
impactées par la présence de message favorables à l’alcool sur
les réseaux sociaux.
). Les auteurs montrent que les étudiants non buveurs dont les
publications pro-alcool d’amis sont très « likées » ont
une plus forte tendance à considérer que les comportements
d’alcoolisation sont la norme dans les soirées étudiantes. Ainsi
les représentations des non-buveurs semblent également être
impactées par la présence de message favorables à l’alcool sur
les réseaux sociaux.Dispositifs de protection des mineurs au marketing
de l’alcool
sur internet
Barrières d’âge
 ) ont testé ce dispositif sur 25 sites
de marques d’alcool populaires chez les jeunes et concluent à
une inefficacité de ce système car il est possible de fournir
n’importe quelle date de naissance. En renseignant différents
âges sur 10 comptes fictifs, Barry et coll. (2016) ont évalué
l’accès des mineurs aux contenus promotionnels des marques
d’alcool sur Twitter et Instagram. Sur Twitter, si les comptes
mineurs ne pouvaient pas s’abonner aux pages officielles des
marques d’alcool, il était néanmoins possible d’avoir accès à
leurs contenus et de pouvoir interagir avec. Sur Instagram,
aucune protection n’existait, et les community managers
des marques interagissaient même directement avec des profils de
mineurs. D’autres recherches se sont intéressées aux contenus
visibles sur YouTube par des mineurs aux États-Unis (Barry et
coll., 2015
) ont testé ce dispositif sur 25 sites
de marques d’alcool populaires chez les jeunes et concluent à
une inefficacité de ce système car il est possible de fournir
n’importe quelle date de naissance. En renseignant différents
âges sur 10 comptes fictifs, Barry et coll. (2016) ont évalué
l’accès des mineurs aux contenus promotionnels des marques
d’alcool sur Twitter et Instagram. Sur Twitter, si les comptes
mineurs ne pouvaient pas s’abonner aux pages officielles des
marques d’alcool, il était néanmoins possible d’avoir accès à
leurs contenus et de pouvoir interagir avec. Sur Instagram,
aucune protection n’existait, et les community managers
des marques interagissaient même directement avec des profils de
mineurs. D’autres recherches se sont intéressées aux contenus
visibles sur YouTube par des mineurs aux États-Unis (Barry et
coll., 2015 ). Trois profils fictifs masculins de 14, 17 et 19 ans ont été
créés afin d’évaluer leur capacité à accéder aux contenus sur
YouTube des 16 marques de bières et de spiritueux les plus
populaires chez les mineurs américains. Quels que soient leurs
âges, les trois profils ont pu s’abonner aux chaînes des 16
marques d’alcool.
). Trois profils fictifs masculins de 14, 17 et 19 ans ont été
créés afin d’évaluer leur capacité à accéder aux contenus sur
YouTube des 16 marques de bières et de spiritueux les plus
populaires chez les mineurs américains. Quels que soient leurs
âges, les trois profils ont pu s’abonner aux chaînes des 16
marques d’alcool.Lois et réglementations
Codes d’autodiscipline proposés par les industriels de l’alcool
Contrôle parental
Conclusion
Références


































































































→ Aller vers SYNTHESE