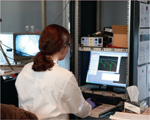
Vignette (Photo © Yehezkel Ben-Ari/https://leblogdebenari.com/).
Le financement de la recherche souffre de maux connus mais incompris par des générations de politiques. Nous sommes toujours loin des 3 % du PIB requis pour nous remettre en selle et qui sont épisodiquement promis avant telle ou telle échéance électorale. Pourtant, ceux-là même qui se plaignent que le rang de la France baisse en termes de publications, omettent de dire que le rapport budget/nombre de publications est strictement linéaire. Les pays qui ont des pourcentages d’investissement plus élevés (Japon, Allemagne, Suède, Corée du sud, Taiwan) progressent rapidement voire nous dépassent. Il faut dire qu’avec seulement 4 ou 5 députés à l’Assemblée nationale ayant une certaine expérience dans le domaine des sciences et des élites sorties de l’école nationale d’administration (ENA), qui souvent n’en n’ont aucune, le monde de la recherche est peu/mal défendu auprès des décideurs et le budget de la recherche sert souvent de variable d’ajustement.
De plus, la répartition des maigres ressources pose problème. Lors de la création de l’Agence nationale de la recherche (ANR), suite au mouvement « Sauvons la recherche » (janvier 2004), il s’agissait au départ de financer des projets sans toucher aux budgets de fonctionnement des institutions. Les autorités ont décidé de centrer les financements sur « l’excellence » de projets sélectionnés, et ce au détriment des financements récurrents ! Les méfaits du financement exclusivement sur projet sont connus : l’augmentation des contrats à durée déterminée, qui rend ce métier invivable pour les jeunes, « l’administrativité aiguë », qui, comme le disait si bien le regretté André Brahic, avec « la moitié des chercheurs passe son temps à remplir des demandes que l’autre moitié perd beaucoup de temps à lire » avec un taux de financement de l’ordre de 10-15 %, ce qui est simplement insensé sur le plan économique. Il y a ensuite le cumul des richesses, avec quelques équipes qui ont tous les financements (ERC + ANR, etc.) et d’autres rien, dans une approche (faussement) darwinienne chère au patron du CNRS.
Le souci ici n’est pas moral mais relève du domaine de l’utilisation de l’argent du contribuable. Les équipes « d’excellence » continuent à faire avec plus de moyens ce qu’elles faisaient auparavant et ne prennent pas de risques, afin de rester en adéquation avec les sujets du moment. De plus, la définition de « l’excellence », c’est comme dans la mode : il arrive que cela se démode ! Les vraies découvertes, celles qui permettent des sauts conceptuels, viennent de la convergence de travaux à bas retentissement, effectués par des équipes qui, sans publier forcément dans des journaux dits d’excellence, fournissent des données de base, à partir desquelles certains vont ouvrir de nouvelles avenues. L’histoire nous apprend que les découvertes majeures qui font un saut conceptuel, comme les traitements de maladies pharmaco-résistantes, viennent de l’imprévu.
Étonnamment, Boris Johnson semble avoir compris l’importance du risque, son chancelier de l’échiquier ayant déclaré que 1 milliard de livres sterling du budget serait réservé à des projets « à haut risque » (https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/12/le-royaume-uni-tourne-la-page-de-l-austerite_6032744_3234.html). Comme quoi, il arrive que des bonnes décisions ne viennent pas de là où on les attend !
Il y a aussi du déjà-vu dans cette fascination des politiques pour les grands plans, lancés pour résoudre une maladie ou permettre de comprendre le fonctionnement du cerveau humain – plans cancer, Alzheimer, Human Brain Project, etc… –, avec un rapport qualité/prix largement discutable. Il y a, enfin, l’importance de comprendre que la recherche opère avec une cinétique longue, l’action en urgence ne lui sied jamais. Les exemples du financement en yoyo de la recherche en virologie, excellemment décrit par le virologue Bruno Canard, directeur de recherche CNRS à Aix-Marseille, les décideurs, réalisant l’importance des travaux en virologie au moment du déclenchement d’une pandémie et l’oubliant ensuite pour faire des économies… Il nous faut espérer que cela ne sera pas le cas quand la pandémie du Covid-19 sera vaincue ! Les derniers discours du Président de la République laissent entrevoir cette possibilité, et la nomination d’un haut conseil scientifique (enfin !) semble indiquer un infléchissement du financement de la recherche scientifique. Le soutien de la population aux médecins et chercheurs a été crucial. La décision de mettre 5 milliards d’euros supplémentaires en 10 ans dans la recherche va dans la bonne direction, même si on est encore loin des 3 % du PIB. Il faut espérer que ces promesses seront tenues et suivies d’effets et que cette manne ne sera pas restreinte à des domaines particuliers.
Enfin, un sujet largement débattu et critiqué à juste titre par nos collègues concerne le crédit impôts recherche (CIR), qui dépasse les 6 milliards d’euros par an. Apprendre que des supermarchés reçoivent, à ce titre, des dizaines de millions pose deux problèmes : celui de l’évaluation de ce qui a été réalisé comme travail de recherche avec le CIR obtenu et on est ébahi de découvrir la faiblesse de cette évaluation lorsque l’on connaît les évaluations multiples auxquelles sont soumis les chercheurs de la recherche publique. Le second problème est celui de l’incapacité à séparer les petites start-up (et PME) des mastodontes, qui ont trouvé une façon facile de faire des économies payées par nos impôts ! Mais que l’on ne se trompe pas sur mon propos : il faut ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Les petites entreprises, comme celles que j’ai créées (voir ci-dessous) recrutent des chercheurs et des ingénieurs en contrats à durée indéterminée, pour faire souvent de la recherche fondamentale. La solution serait donc de limiter les sommes versées (de 1 à 5 millions d’euros ?) et de vérifier que l’entreprise fait bien de la R&D et contribue à réduire le chômage des chercheurs et ingénieurs, souvent sans débouché dans les filières publiques.

