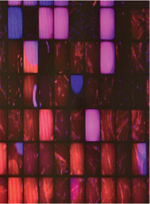La loi française autorise le DPI mais sous des conditions très strictes, comme le souligne l’étude réalisée par le Sénat, car « il entraîne une sélection des embryons » [4]. Les conditions de la loi sont les suivantes : « Le code de la santé publique autorise le diagnostic préimplantatoire “à titre exceptionnel” lorsque “le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic”. La réalisation du diagnostic préimplantatoire est subordonnée à l’identification préalable “chez l’un des parents ou l’un de ses ascendants immédiats dans le cas d’une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, [de] l’anomalie ou [d]es anomalies responsables d’une telle maladie”. En outre, le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir pour objet que la recherche de l’affection considérée et les moyens de la prévenir ou de la traiter ».
Cela signifie donc qu’on ne peut mener un test que pour une pathologie précise : la plupart du temps, lorsqu’un premier enfant en a déjà souffert, soit dans une intention thérapeutique si la maladie est « actionnable »1, soit – et c’est le cas habituel – pour écarter les embryons porteurs de la modification testée qui ne seront alors pas transférés dans l’utérus.
La même Étude du Sénat compare la situation française à celle d’autres pays, notamment la Belgique et la Suisse. On y lit que la Belgique autorise le DPI à des conditions proches de celles qui prévalent en France (loi du 6 juillet 2007), alors que la Suisse l’interdit explicitement (loi du 18 décembre 1998, qui stipule sans ambiguïté : « Le prélèvement d’une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse sont interdits »). À l’instar de la loi française, la loi belge prohibe encore expressément « la sélection à visée eugénique et la sélection exclusivement fondée sur le sexe de l’enfant à naître ».
L’Étude du Sénat mentionne aussi que le débat continue en Suisse et que la loi pourrait changer. C’est désormais chose faite. En effet, le 5 juin 2016, le peuple suisse a accepté, lors d’une votation2,, le DPI pour des situations bien précises, comme on le lit sur le site du Conseil fédéral3 : « La loi n’admet l’analyse génétique d’embryons conçus artificiellement que dans deux cas : d’une part, pour les couples porteurs d’une maladie héréditaire grave, d’autre part, pour les couples qui ne peuvent pas procréer par voie naturelle. Toute autre application du DPI demeure interdite » [5]. La procréation médicalement assistée (PMA) (désignée également sous le terme de « Assistance médicale à la procréation » [AMP]) a deux finalités : permettre à des parents d’avoir un enfant « à eux » et d’avoir, si possible, un enfant en bonne santé, finalités auxquelles le DPI peut contribuer, mais exclusivement dans ces cas. À la différence du droit français, ni le droit belge ni le droit suisse ne limitent le diagnostic à une seule pathologie, génétique ou chromosomique.
Voilà donc pour le droit. Mais le processus législatif est partout précédé de débats publics et d’interventions d’experts. Parmi les participants à ces débats, certains jouent un rôle particulièrement important : les comités d’éthique. S’ils représentent une éthique institutionnelle, leur liberté de parole est grande, car ils n’ont qu’un rôle consultatif dans les trois pays concernés ici. Plusieurs de leurs avis (France et Belgique) et prises de positions (Suisse) concernent le DPI. Que lit-on dans ces avis et prises de position ?
En France, le DPI a fait l’objet de deux avis du CCNE : Réflexions sur l’extension du diagnostic préimplantatoire (avis n° 72) en juillet 2002 [6], et Avis sur les problèmes éthiques liés aux diagnostics anténatals (avis n° 107) en octobre 2009 [7]. Tout dernièrement encore, dans son avis n° 129, Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019 [8], le CCNE a consacré quelques développements à la question. L’avis n° 72 [6] est une réponse à deux saisines concernant un élargissement des indications légales du DPI. La loi française considère en effet exclusivement le bien de l’enfant, et non celui des parents ou de la famille : il s’agit d’éviter la naissance d’un enfant dont la vie sera une souffrance insupportable pour lui. Or, la première saisine concerne le cas de la conception d’un enfant dont le sang, tiré du cordon ombilical, serait utilisé afin de soigner un frère ou une sœur aîné(e) gravement malade. C’est ce que l’on nomme le « bébé-médicament » ou l’« enfant du double espoir », à propos duquel le CCNE pose cette question : « Si l’extension des indications génétiques du DPI pour l’enfant lui-même ne pose pas de problème juridique ou éthique en soi, elle soulève des questions juridiques et éthiques majeures lorsqu’elle concerne l’intérêt d’un tiers » [6]. En effet, un enfant ne doit pas être instrumentalisé à des fins qui ne sont pas les siennes, aussi bonnes soient-elles. Le CCNE penche toutefois en faveur de l’extension de l’autorisation du DPI dans le cas examiné, car il n’y a pas ici d’instrumentalisation proprement dite : « L’enfant naîtra pour lui-même. Il aura sa vie à lui. Il ne sera pas devenu uniquement un moyen » [6] (voir également [9]). Le législateur a suivi cette proposition.
Le second avis du CCNE est postérieur à la loi de 2004. Il se veut une réflexion plus générale sur les diagnostics anténatals. Concernant le DPI, le CCNE observe deux attitudes dans la société française : « Certains insistent sur la contrepartie négative, qui est l’élimination des embryons porteurs d’une maladie génétique lors de la procédure de tri ; d’autres mettent davantage l’accent sur la souffrance liée à l’IMG4, que le DPI peut permettre d’éviter » [7]. Il souligne que cette différence vient du statut qui est accordé à l’embryon : pour les uns, l’embryon a la même dignité qu’une personne (il est une personne proprement dite), ce qui exclut qu’on puisse le détruire intentionnellement (ce serait alors un meurtre) ; alors que pour les autres, c’est la question de la qualité de la vie qui compte, celle de l’enfant d’abord, mais aussi celle de sa famille.
Le CCNE souligne fortement l’importance de la finalité du DPI, à savoir éviter une maladie grave à un futur enfant, et donc les souffrances qui y sont liées : « La seule finalité éthique incontestable du DPI est celle de permettre à des couples d’avoir un enfant, alors que leur passé familial ou le handicap sévère d’un premier-né les aurait conduits à y renoncer » [7]. Dans la foulée, il écarte explicitement d’autres finalités : le DPI ne peut avoir ni de but préventif, du moins prioritairement (il ne s’agit pas d’une mesure de santé publique), ni de but eugéniste, ce que la loi condamnerait. Toutefois, « le sens du terme eugénisme retenu par le législateur est celui d’un programme politique, hygiéniste et idéologique, visant à améliorer l’espèce humaine ». Et dans le DPI, il ne s’agit pas de cela : « Les professionnels de santé ne sont pas astreints par des directives imposées par les pouvoirs publics incitant les femmes à recourir à une IMG ou à un tri embryonnaire, lorsqu’elles ont une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une affection grave et incurable » [7]. Il reste que si l’État n’exerce ici aucune contrainte, la pression sociale peut se révéler pernicieuse. Un moyen de la contrer est d’améliorer la prise en charge des handicapés, comme cela a été le cas pour le syndrome de Down (ou trisomie 21)5, : « Au cours des dernières années, la trisomie a fait l’objet d’une prise en charge qui a augmenté la qualité de vie des personnes qui en sont affectées » [7].
On reconnaît ici ce qui est parfois appelé « l’argument expressiviste » (expressivist argument) : la pratique du DPI, et des tests anténatals en général, exprimerait (express) une attitude stigmatisante, non seulement du handicap, mais aussi des handicapés, dont la vie serait perçue comme ayant moins de valeur [10]. Le CCNE souligne, avec raison, que le remède à cette dérive n’est pas l’interdiction des tests – dont la finalité est justement de faire diminuer les souffrances –, mais une meilleure prise en charge.
À la fin de son avis de 2009, le CCNE se pose encore la question de l’usage d’un diagnostic préconceptionnel (DPC) dans des populations entières, afin de dépister certaines maladies comme cela a été le cas pour la thalassémie à Chypre6,. En France, cela pourrait concerner la mucoviscidose. Le CCNE n’y est pas favorable, vu la gravité variable de cette maladie - il aurait aussi pu dénoncer une finalité préventive, voire eugéniste -, mais il ne se prononce pas sur le DPC en général. Les progrès dans le séquençage du génome rendant cette option relativement aisée, le CCNE est revenu sur le sujet dans son dernier avis, celui de 2018, dans lequel il propose que l’on autorise le DPC à toutes les personnes en âge de procréer qui le souhaitent [8]. Relevons que ce test est d’autant plus intéressant sur le plan éthique qu’il évite la destruction d’embryons, contrairement au DPI [11].
Retrouve-t-on les mêmes préoccupations en Belgique ? Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCBB) a consacré, en 2009, un avis « relatif à l’utilisation du diagnostic génétique préimplantatoire pour détecter les porteurs sains d’une mutation causant une affection héréditaire grave qui peut entraîner un risque élevé pour les descendants ». Le sujet ne concerne pas d’abord des enfants pouvant souffrir d’une maladie grave, mais ceux qui sont porteurs d’un gène délétère et qui, eux-mêmes, ne seront pas malades (ce sont des porteurs sains). Ce cas pose au CCBB une difficulté juridique : « D’un point de vue médico-éthique, il semblait jusqu’ici généralement admis que le DPI n’est autorisé que s’il a une finalité proprement médicale, en ce sens qu’il a pour objectif de transférer un embryon sain pour éviter la naissance d’un enfant malade ou handicapé. Sur un plan strictement juridique, aucun des textes applicables ne permet de répondre de manière tranchée à la question de savoir si le recours au DPI est autorisé ou admissible, en vue d’éviter la naissance d’un enfant porteur sain d’une maladie génétique sévère » [12]. Toutefois, comme la loi belge autorise le DPI, y compris dans le cas du bébé-médicament, sauf s’il est de caractère eugéniste, c’est-à-dire s’il porte sur des caractères non pathologiques [13], il s’ensuit « que, dès lors que le diagnostic révélera quelque “imperfection” que ce soit, une sélection pourra s’ensuivre, puisque telle est la finalité de cette technique » [12]. Par conséquent, un DPI ayant pour but d’écarter un porteur sain est licite. Le CCBB examine notamment le cas de la mucoviscidose, une affection grave, pour laquelle le CCNE envisageait justement la possibilité d’un DPC.
En Suisse, le DPI a été examiné dans trois prises de positions par la Commission nationale d’éthique (CNE) [14-16]. Comme nous l’avons rappelé précédemment, jusqu’en 2016 le DPI était interdit, mais la majorité des membres du CNE a été, depuis le début, d’un avis différent en cas de pathologie grave, en excluant, toutefois, le cas des bébés-médicaments et des porteurs sains. En effet, le DPI permet d’éviter un DPN suivi d’un avortement, ce qui, d’une part, constitue un lourd fardeau pour le couple et, d’autre part, détruit un être humain (fœtus) à un stade de développement plus avancé. Pour la minorité, un des problèmes principaux du DPI est que la notion de maladie grave est floue, d’où le risque de pente glissante : « La définition pourrait, à terme, s’étendre à des défauts génétiques graves aux handicaps qu’il est possible de traiter, voire même aux dispositions corporelles contrevenant au sens esthétique du moment » [14]. La CNE est également très soucieuse d’éviter tout risque eugéniste, ce qu’elle comprend en un sens plus large que le CCNE et le CCBB, en le définissant comme « l’application de différents critères pour sélectionner certains êtres humains et en éliminer d’autres » [15], ce qui inclut un « eugénisme doux », « c’est-à-dire la discrimination des personnes handicapées via l’autorisation des procédés de sélection » [14]. On reconnaît ici l’argument expressiviste, et « une forme libérale d’eugénisme »7, fondée sur l’autonomie des parents (leur droit à avoir un enfant en bonne santé), parfois plus apparente que réelle, vu la pression sociale.